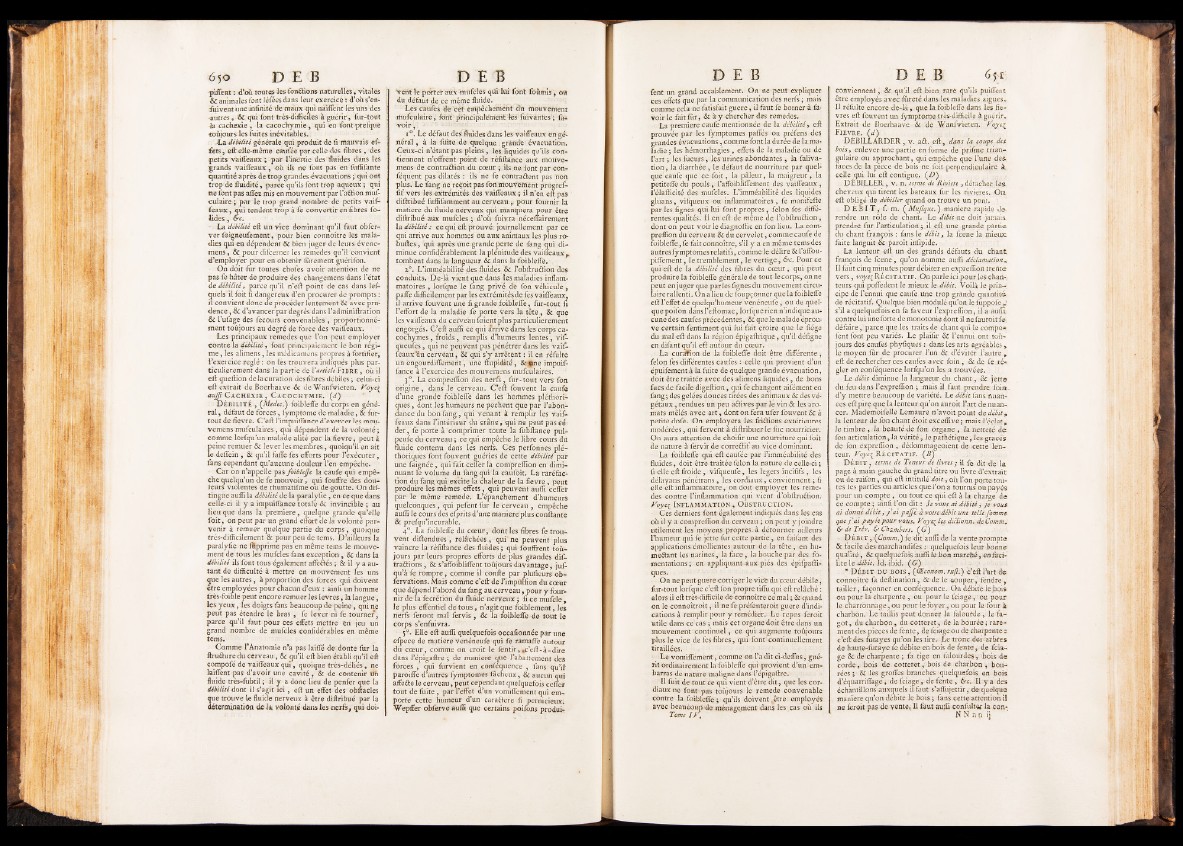
-piffeat : xgSùfii toutes lès fondions naturelles, vitales
& animales font léfées dans leur exercicé ï d’où s’en*
ifuivent «une infinité de maux gui nàüfont les uns des
-autres, &c qui font très-difficiles à guérir, fiir-tout
-la cachexie, la cacochymie , qui en font prefque
-toujours les fuites inévitables» I
L a débilité générale qui produit de fi mauvais effets
, eft elle-même caufée par celle des fibres , des
•petits vàifleaux ; par l’inertie des fluides dans les
grands vaiffeaux, -où ils ne font pas en fiiffifante
quantité après de trop grandes évacuations ;■ qui ont
trop de fluidité, parce qu’ils font trop aqueux ; qui
ne lbnt pas affez mis en mouvement par l’a&ion muf-
•culaire ; par le trop grand nombre de petits vaifo
féaux, -qui tendent trop à fie convertir en fibres fond
es, &c.
- La débilité eft un vice dominant qu’il faut obfer-
ver foigneufoment, pour bien connoître les maladies
qui en. dépendent & bien juger de leurs évene-
mens, & pour difcerner les remedes qu’il convient
d’employer pour en obtenir fûrement gùérifon.
On doit fiir toutes chofes avoir attention de ne
pas. fe hâter de produire des changemens dans l’état
de débilité, parce qu’il n’éft point de cas dans lesquels
il foit li dangereux d’en procurer de prompts :
il convient donc de procéder lentement & avec prudence
, & d’avancer par degrés dans l’adminiftration
& l’ufage des fecours convenables , proportionné-
rnent toujours au degré dé force des vaiffeaux.
Les principaux remedes que l’on peut employer
contre la débilité, font principalement le bon régime
, les alimens, les médicamens propres à fortifier,
l ’exercice réglé : on les trouvera indiqués plus particulièrement
dans la partie de Yarticle Fibre , où il
eft queftion de la curation des fibres débiles ; celui-ci
eft extrait de Boerhaave & deWanfwieten. Voye£
aujji Cachexie , Cacochymie, (d)
D ébilité , ('Medec.'j foibleffe du corps en général
, défaut de forces, lÿmptome de maladie, & fur-
tout de fievre. C ’eft l’impuiffance d’exercer les mou*
vemens mufculaires, qui dépendent de la volonté;
comme lorfqu’un malade alité par là fievre, peut à
peine remuer & lever les membres, quoiqu’il en ait
le deffein , & qu’il faite fes efforts pour l’exécuter,
fans cependant qu’aucune douleur l’en empêche.
- Car on n’appelle pas foiblejje la caufe qui empêche
quelqu’un de fe mouvoir , qui fouffre des douleurs
violentes de rhumatifme ou de goutte. On dif-
tingue aufli la débilité de la paraiyfie, en ce que dans
celle-ci il y a impuiffance totale & invincible ; au
lieu que dans la première, quelque grande qu’elle
lb it , on peut par un grand effort de la volonté parvenir
à remuer quelque partie du corps, quoique
très-difficilement & pour peu de tems. D ’ailleurs la
paraiyfie ne Æpprime pas en même tems le mouvement
de tous les mufcles fans exception, & dans la
débilité ils font tous également affeétés ; & il y a autant
de difficulté à mettre en mouvement les uns
gue les autres, à proportion des forces qui doivent
etre employées pour chacun d’eux : ainfi un homme
très-foible peut encore remuer les levres, la langue,
les yeux, les doigts fans beaucoup de peine, qui ne
peut pas étendre le bras , fe lever ni fe tourner,
parce qu’il faut pour ces effets mettre en jeu un
grand nombre de mufcles confidérables en même
tems.
Comme l’Anatomie n’a pas laide de doute fur la
ftru&ure du cerveau, & qu’il eft bien établi qu’il eft
compofé de vaiffeaux qui, quoique très-déliés, ne
laiffent pas d’avoir une cavité , & de contenir üh
fluide très-fubtil ; il y a donc lieu de penfer que la
débilité dont il s’agit i c i , eft un effet des obftacles
que trouve le fluide nerveux à être diftribué par la
détermination de la volonté dans les nerfs, qui doi*
Vent ïe porter â\ïx mufclëS qiîi-lfti font fournis, ôft
du défaut de ce même fluide.
Les caufox dë 'céf empêchement dit mouvement
-mufculaire, font pfmcipale'frieriflës fuivantfes'; fa*
V o ir ,: J
i° . Le défaut des mudes dans lésvaiffeaux en général
, à la fitke de quelque.. grande évacuation.
-Ceux-ci n?étant pas pleins , le5. liquides qu’ils con-
-tiennent n’offrent point de réfiftance aux moùve-
mens de contraÔiOn.du coeur ;• ils ne. font par con-
féquent pas dilatés : ils ne fe contrarient pas non
plus. Le fang ne reçoit pas foii hiouvëfrtént progref-
fif vers les extrémités des vaiffeaux ; il n’en elt pas
diftribué fuffifamment au cerveau ,. pour fournir là.
matière du fluide nerveux qui manquera pour .être
diftribué aux mufcles ;■ d’où fuivra néceffairement
la débilité : ce qui eft prouvé: journellement par ce
qui arrive aux hommes Ou aux animaux les plus ro*
buftes, qui après une.grande perte de fang qui diminue
confid^ràblement la plénitude des vaifleaux,.
tombent dans la langueur &: dans la foibleffe.
a0. L’imméabilité des fluides & fobftruftion des
conduits. De-là vient que dans les maladies inflammatoires
, iorfque le fang privé de fon véhicule,
paffe difficilement par les extrémités de les vaiffeaux.
il arrive fouvent une fi grande foibleffe, fur-tout fi
l’effort de ia maladie ,fe porte vers la tête, & que
les vaiffeaux du cerveau foient plus particulièrement
engorgés. C ’eft aufli ce qui Arrive dans les cOrps ca-
cochymes, froids, remplis d’humeurs lentes, vif-
queufes, qui ne peuvent pas péftétrer dans les Vaif-
1 eaux ^1 u cerveau, & qui s’y arrêtent ; il en réfülte
un ëngburdiffeméntVune ftupidité, &^ûne impuiflance
à l’exercice des mouvemens mufculaires.
3°. La compreflion des nerfs, fur-tout vers fon
origine, dans le cerveau. C’eft fouvent la caufe
d’une grande foibleffe dans lèif hommes pléthoriques
, dont les' humeurs ne pechent que par l’abondance
du bon fang, qui venant à remplir les vaif-
feaux dans l’intérieur du crâne, qui île peut pas céder,
fé porté à'comprimer toute' ia fubftance piil-
peufe du cerveau ; ce qui empêche le libre cours du
fluide contenu dans les nerfs. Ces perfonnes pléthoriques
font fouvent guéries de Cette débilité par
une faignée, quifait ceffer là compreflion en diminuant
le volume du fang qui lâ c'àùfoit. La raréfaction
du fang qui excite la chaleur de la fievre, peut
produire les mêmes effets, qui peuvent aufli ceffer
par le même remede. L’épanehement d’humeurs
quelconques, qui pefent fur le cerveau , empêche
aufli le cours des efprits d’une maniere'plus confiante
& prefqu’incurable.
4°. La foibleffe du coeur, dont les fibres fe trouvent
diftendues , relâchées , qui'ne peuvent plus
vaincre la réfiftance des fluides; qui fouffrent toujours
par leurs propres efforts de plus grandes dif-
iraftions, 8t s’affoibliffent toujours davantage, juf-
qu’à fe rompre, comme il confie par plufieurs ob-
ïervations. Mais conune c’eft: de l’impiulion du coeur
que dépend l’abord du fang au cerveau, pour y fournir
de la fecrétion du fluide nerveux ; fi ce mufcle ,
le plus effentiel de tous, n’agit que foiblement, les
nerfs feront mal fervis, & la foibleffe-de tout le
corps s’enfuivra.
'‘-• 5®. Elle eft âufli quelquefois occafionnée par une
efpece de matière venéneufe qui fe ramaffe autour
du coeur, comme on croit le fentir,*c’eft-à-dire
dans l’épigaftre ; de maniéré que l’abattement des
forces , qui furvient en conféquence , fans qu’il
paroiffe d’autres fymptomes fâcheux, & aucun qui
affefte le cerveau, peut cependant quelquefois ceffer
tout de fuite, par l’effet d’un vomiffement qui emporte
cette humeur d’un caraélere fi pernicieux.
"Wepffer obforve aufli que certains poifons produit
font un grand accablement. On ne peut expliquer
ces effets que par la communication des nerfs ; mais
comme cela ne fatisfait guere, il faut fe borner à Lavoir
le fait fur, & à y chercher des remedes.
La première caufe mentionnée de la débilité, eft
prouvée par les fymptomes paffés ou préfens des
grandes évacuations, comme font la durée de la ma-
ladie ; les hémorrhagies, effets de la maladie ou de
l’art ; les fueurs, les urines abondantes , la faliva-
tion, la diarrhée, le défaut de nourriture par quelque'caufe
que ce foit, la pâleur, la maigreur, la
petiteffe du pouls, l’affoibliffement des vaiffeaux,
l ’élafticité des mufcles. L’imméabilité des liquides
gluans, vilqueux ou inflammatoires, fe manifefte
par les lignes qui lui font propres, félon fes différentes
qualités. Il en eft de même de l’obllruélion,
dont on peut voir le diagnollic en fon lieu. La compreflion
du cerveau & du cervelet, comme caufe de
foibleffe, fe fait connoître, s’il y a en même tems des
autres fymptomes relatifs, .comme le délire & l’affou-
piffement, le tremblement, le vertige, &c. Pour ce
qui eft de la débilité des fibres du coeur, qui peut
produire la foibleffe générale de tout le corps, on ne
peut en juger que par les lignes du mouvement circulaire
rallenti. On a lieu dé loupçonner que la foibleffe
eft l’effet de quelqu’humeur venéneufe, ou de quelque
poifon dansl’eftomac, lorfquerien n’indique au-
cunedes caufes précédentes , & que le malade éprouve
certain fentiment qui lui fait croire que le fiége
du mal eft dans la région épigaftrique, qu’il.défigne
en difant qu’il eft autour du coeur.
La cursffion dé la foibleffe doit être différente ,
félon fes différentes caufes : celle qui provient d’un
épuifement à la fuite de quelque grande évacuation,
doit être traitée avec-des alimens liquides, de bons
fucs de facile digeftion, qui fe changent aifément en
fang; des gelées douces tirées des animaux & des végétaux
, rendues un peu aâives-parle vin & les aro-
mats mêlés avec art, dont on fera ufer fouvent & a
petite dofe. On employera les friéliohs extérieures
modérées, qui fervent à diftribuer le fuc nourricier.
On aura attention de choifir une nourriture qui foit
de nature à férvir de correâif au vice dominant.
- La foibleffe qui eft caufée par l’imméabilité des
fluides, doit être traitée félon la nature de cellerci ;
fi elle eft froide , vifqueufe, les légers incififs , les
délayans pénétrans , les cordiaux , conviennent ; fi
elle eft inflammatoire, on doit employer les remedes
contre l’inflammation qui vient d’obftruâion;
Foye^ In f l a m m a t i o n , O b s t r u c t i o n .
Ces derniers font également indiqués dans les cas
où il y a compreflion du.cerveau ; on peut y joindre
utilement les moyens propres, à détourner ailleurs
l’humeur qui fe jette fur cette partie, en.faifant des
applications émollientes autour, de la tête, en hu-
meélant les narines, la face, la bouche par des fo-
mentations"; en appliquant-aux piés. des épifpafti-
qües.
- On ne peut guere corriger le vicè du coeur débile,
fur-tout Iorfque c’eft fon propre tiffu qui eft relâché :
alors il eft très-difficile de connoître ce mal ; & quand
on le connoîtroit, il ne fe préfenteroit guere d'indications
à remplir pour y remédier. Le repos feroit
utile dans ce cas ; mais cet organe'doit être dans un
mouvement continuel, ce qui augmente toûjours
plus le vicè de fes fibres, qui font continuellement
tiraillées.
Le vomiffement , comme ôn l’a dit ci-deffus , guérit
ordinairement la foibleffe qui provient d’un embarras
de natiire maligne dans Fépigaftre.
Il fuit de fout ce qui vient d’être dit, que les cordiaux
ne font pas toûjours le remede convenable
contre la foibleffe ; qu’ils doivent ^être employés
avec beaucoup de ménagement dans les cas où ils
Tome I F~,
conviennent & qu’il eft bien rare qu’ils puiffent
être employés avec fureté dansdes maladies aigues.
Il réfuite encore de-là, que la foibleffe dans les fièvres
eft fouvent un fymptQme très-difficile à guérir.
Extrait de Boerhaave & de W anfwieten. ^oye^
F i e v r e . (d)
- DÉBILLARDER, v. a£t. eft, dans la çgupe des
bois, enlever une partie en forme de prifine triangulaire
ou approchant, qui empêche que l’une des
faces de la piece de bois ne foit perpendiculaire à
celle qui lui eft contiguë.. (.Z))
DÉBILLER, v. n. terme de Rivière , détacher, les
chevaux qui tirent les bateaux fur les rivières. Ont
eft obligé de débiller quand on trouve un pont. '
D É B I T , f. m. ( Mujïque, ) maniéré rapide de,
rendre un rôle de chant. Le débit no. doit jamais
prendre fur.l’articulation;.il eft une grande partie
du chant françois : fans le débit, la fçene la fiiieux
faite languit & jüaroît irffîpide.
La lenteur eft un des grands défauts du chant
françois de feene , qu’on nomme aufli déclamation*
Il faut cinq minutes poiir débiter en expreflion trente
vers, voye^ R é c i t a t i f . On parle ici pour les chan-,
teurs qui poffedent le mieux le débit. Voilà le principe
de l’ennui que caufe une trop grande quantité
de récitatif. Quelque bien modulé qu’on le fuppofe ^
s’il a quelquefois en fa faveur l’expreflion, il a aufli
contre lui une forte de monotonie dont il ne fauroit fe.
défaire, parce:que les traits de chant qui le cortipo*
font font peu variés. Le plaifir & l’ennui ont toujours
des caufes phyfîques : dans les arts agréables ,
le moyen fur de procurer l’un & d’éviter l ’autre %
eft de rechercher ces caufes avec foin, & de fe.régler
en conféquence lorfqu’on les a trouvées.
Le débit diminue la langueur du chant, & jette
du feu dans l’expreflïon ; mais il faut prendre; foin>
d’y mettre beaucoup de variété. Le débit fans nuances
eft pire que la lenteuriqu’on auroit l’art de nuancer.
Mademoifelle Lemaure n’a voit point de débit,
la lenteur de fon chant étoitexceflîve; mais l ’éclat,
le timbre , la beauté de fon organe , la netteté de
fon articulation, la vérité, le pathétique j le&'gracës
de fon expreflion , dédommageoient de .cette lenteur.
f'ôytq; R é c i t a t i f . (5)
D É B I T , terme de Teneur dé livres ; il fe dit de la
page à main gauche du grand titre ou livre d’extrait
ou deiraifon, qui eft intitulé’Lori, où l’on porte toutes
les parties ©u articles.que l’on a fournis ou-payés
pour un compte , ou tout ce qui eft à la charge de
ce compte ; ainfi l’on dit : Je vous ai débité ; je vous
ai donné débit, j'a i pajfi à votre débit une telle.fomme-
que j 'a i .payée pour vous. Voyc^ les dictionn. de Comtn,
& de Trév. & Chzmbers. (G)
- D é b i t * (Gommj) fo ditrauflî de la vente prompte
& tacile:des marchandifes : quelquefois leur bonne
qualité, & quelquefois aufli le bon marché , en facilite
le débit. Id. ibid. (G)
* D é b i t d u b o i s , (jEconom. ruftj) c’eft l’art de
connoître fa deftination, & de'le aouper, fendre ,
tailler, façonner en conféquence. On débite le bois
ou pour la charpente, ou pour le feiage ,;'ou pour
le charronnage, ou pour le foyer ; ou pour le four à
charbon. Le taillis peut donner la faloufde , le fagot
, du charbon, du cotteret; de la bourée ; rarement
des pièces de fente, de feiage ou de charpente 5
c’eft des futayes qu’on les tire. Ée tronc des arbres
de haute-futaye fe débite en bois de fente, de feiage
& de charpente ; fa tige en falourdes , bois de
corde,- bois de-eottefet, bois de charbon, bou-
rées ; & les groffes branches quelquefois en bois
d’équarriffage ; de feiage, de fente , 6*c. Il y a des
échantillons auxquels il faut s’affujettir, de quelque
maniéré qu’on débite le bois ; fans cette attention il
ne feroit pas de vente, Il fout aufli confultaj- la con*
N N n n ij