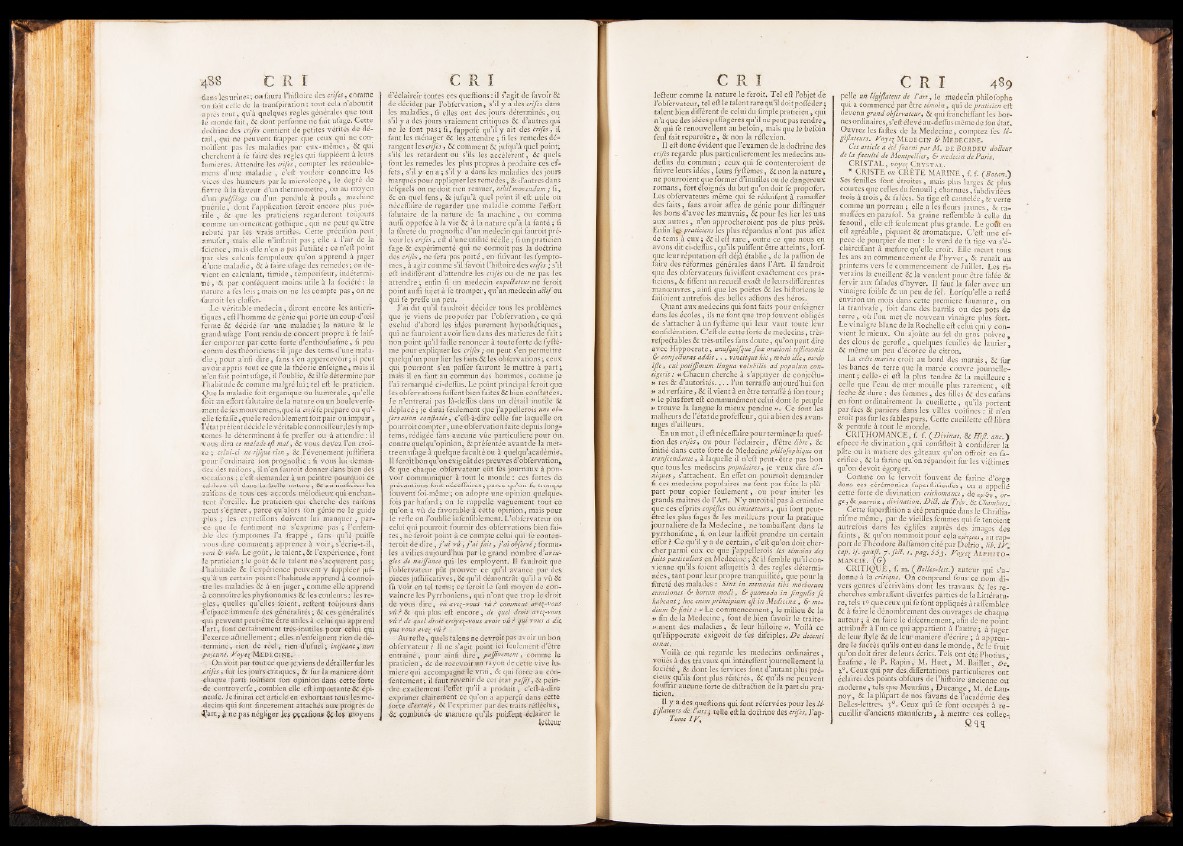
•dans lès urïnes ; on {aura l’hiftoire des crifes, comme .
on lait celle de la tranfpiration : tout cela n’aboutit
•après tout, qu’à quelques réglés générales que tout
le monde fait, & dont perfonne île fait ufage. Cette
■ do&rine des crifes contient de petites vérités de détail
, qui ne peuvent frapper que ceux qui ne con-
noiffent pas les maladies par eux - mêmes, & qui
cherchent à fe faire des réglés qui fuppléent à leurs
lumières. Attendre les crifts, compter les redouble-
>mens d’une maladie , c’eft vouloir connoître les
•vices des humeurs par le microfçope, le degré de
fievre 4 la faveur d’un thermomètre, ou au moyen
d’un puljiloge ou d’un pendule à pouls , machine
puérile, dont l’application feroit encore plus^ pué-
-rile , Sc que les praticiens regarderont toujours
-comme un ornement gothique, qui ne peut qu’être
rebuté par les vrais artiftes. Cette précifion.peut ^
amufer, mais elle n’inftruit pas; elle a l’air de la
fcience, mais elle n’en a pas l’utilité : ce n’eft point
par des calculs {'crapuleux qu’on apprend à juger
d ’une maladie, Sc à faire ufage des remedes ; on devient
en calculant, timide, temporifeur, indéterminé
i & par conféquent moins utile à la fociété : la
nature a fes lois ; mais on ne les compte pas, on 11e
•fautoit les claffer.
Le véritable médecin, diront encore les anticri-
-itiques, eft l’homme de génie qui porte un coup-d’oeil
ferme & décidé fur une maladie ; la nature & le
grand ufage l’ont rendu de concert propre à fe laif-
•i'er emporter par cette forte d’enthoufiafme, fi peu
-connu des théoriciens ; il juge des tems d’une maladie
, pour a’nfi dire, fans s’en appercevôir ; il peut
avoir appris tout ce que la théorie enfeigne, mais il
n ’en fait point ufage, il l’oublie, Sc il fe détermine par 4’habitude& comme malgré lui; tel eft le praticien.
Que la maladie foit organique ou humorale, qu’elle
Toit un effort falutaire delà nature ou un bouleverfe-
ment de fes mouvemens,que la crifeie prépare ou qu’-
élle fe faite, que le redoublement foit pair ou impair,
l ’état préfent décide le véritable connoifleur;lesfymp-
tomes le déterminent à fe preffer ou 4 attendre.: il
vous dira ce malade efi mal, & vous devez l’en croire
; celui-ci ne rifque rien, Sc l’évenement juftifiera
pour l’ordinaire fon prognoftic : fi vous lui demandez
des raifons, il n’en fauroit donner dans bien des
•occafions ; c’eft demander à un peintre pourquoi ce
-tableau eft dans la-belle nature ,& au müficien les
raifons de tous ces accords mélodieux qui enchantent
l’oreille. Le praticien qui cherche des raifons
.peut s’égarer, parce qu’alors fon génie ne le guide
plus ; les exprefîions doivent lui manquer , par-
-ce que -le fentiment ne s’exprime pas -; I’enfem-
ble des fymptomes l’a frappé , fans qu’il puiffe
vous dire comment; apprenez à voir, s’écrie-t-il,
■ yeni & vide. Le goût, le talent, & l’expérience, font
le praticien ; le goût Sc le talent ne s’acquerent pas;
l ’habitude Sc l’expérience peuvent y fuppléer juf-
• q if à‘ un certain point : l’habitude apprend à connoî-
-tre les maladies & à en juger, comme elle apprend
à connoître les phyfionomies Sc les couleurs :: les rel
i e s , quelles qu’elles foient, reftent toûjours dans 4’efpace immenfe des généralités ; & ces généralités
-qui peuvent peut-être‘être utiles à celui qui apprend
-l’a r t fo n t certainement très-inutiles pour celui qui
l ’exerce, aûuellement ; elles n’enfeignent rien dedé-
-terminé, rien de réel , rien d’iifuel ; inefeant, 'non
■ pafeunt. Voye^"MiEDEGI-N'E.-1 -
- On voit par tout-ce que-jeyiensde détailler fur les
<•crifis, fur les jours critiques, & fur la maniéré dont
-chaque parti, foûtient lbn opinion dans Cette forte .
-de controyerfe, combien elle eft importante & épi-
-neufe. Jefinirai cet article en exhortant toUs'les me- !
-decins-qui font fincerement attachés aux progrès de j
^ r t , 4 ne pas négliger le$ pçcalions $cie$ jrioyens ;
d'éclaircir toutes ces queftions : il s’ agit dé favoit Si
de décider par l’obfervation, s’il y a des crifes dans
les maladies, fi elles ont des jours déterminés, ou
s’il y a des jours vtaiement critiques Sc d’autres qui
ne le font pas ; f i, fuppofé qu’il y ait des crifes, il
faut les ménager & les attendre ; fi les remedes dérangent
les crifes, Sc comment Si jufqu’à quel point;
s’ils les retardent ou s’ils les accélèrent, Sc quels
font les remedes les plus propres à produire ces efi*
fets, s’il y en a ; s’il y a dans les maladies des jours
marqués pour appliquer les remedes, & d’autres dans
lefquels on ne doit rien remuer, nihilmovendum ; f i,
& en quel fens, & jufqu’à quel point il eft utile oit
nécefîaire de regarder une maladie comme l’effort
falutaire de la nature de la machine, Ou comme,
auffi oppofée à la vie & à la nature qu’à la fantéi ; fi
la fureté du prognoftic d’un médecin qui fauroit prévoir
les crifes, eft d’une utilité réelle ; fi un praticien
fage & expérimenté qui ne connoît pas la doctrine
des crifes, ne fera pas porté, en fuivant les fympto-
mes, à agir comme s’il favoit l’hiftoire des crifes ; s’il
eft indifférent d’attendre les crifes ou de ne pas les
attendre; enfin fi un médecin expectateur ne feroit
point aufîi fujet à fe tromper, qu’un médecin actif ou
qui fe preffe un peu.
J’ai dit qu’il faudrait décider tous les problèmes
que je viens de propofer par l’obfervation, ce qui
exclud d’abord les idées purement hypothétiques,
qui ne fauroient avoir lieu dans des matières de fait i
non point qu’il faille renoncer à toute forte de fyftè-
me pour expliquer les crifes ; on peut s’en permettre
quelqu’un pour lier les faits & les obfervations ; ceux
qui pourront s’en paffer fauront le mettre à part ;
mais il en faut au commun des hommes , comme je
l’ai remarqué ci-deffus. Le point principal feroit que
les obfervations fuffent bien faites & bien conftatées.
Je n’entrerai pas là-defîus dans un détail inutile &
déplacé ; je dirai feulement que j’appellerais une ob■ *
fervaùon confiatée, c’eft-à-dire celle fur laquelle on
pourroit compter, une obfervation faite depuis long-
tems, rédigée fans aucune vûe particulière pour ou.
contre quelqu’opinion, & préfentée avant de la mettre
en ufage à quelque faculté ou à quelqu’académie..
Il feroit bon qu’on exigeât des preuves d’obfervation*
& que chaque obfervateur eût fes journaux à pouvoir
communiquer à tout le monde : ces fortes de,
précautions font néceffaires, parce qu’on fe trompe
fouvent foi-même ; on adopte une opinion quelque-,
fois par hafard ; on fe rappelle vaguement tout ce
qu’ori a vû de favorable à cette opinion, mais pour
le refte on l’oublie infenfiblement. L’obfervateur ou
celui qui pourroit fournir des obfervations bien faites
, ne feroit point à ce compte celui qui fe Contenterait
dè dire, f a i vû, f a i fa it, ƒ ai obfervè ; formules
avilies, aujourd’hui par le grand nombre d’aveugles
de naijfance qui les employent. Il faudroit que
l’obfervateur pût prouver ce qu’il avance par des
pièces juftificatives, Si qu’il démontrât qu’il a vû Sc
lu voir en tel tems; ce feroit le feul moyen de convaincre
les Pyrrhoniens, qui n’ont que trop le droit
de vons dire, Ou aveç-vous vu? comment aveç-vous
vû ? Sc qui pliis eft encore, de quel droit; aveç-vous
vû? de quel droit croyer-vous avoir vu? qui vous a dit.
que vous ave '{ vû ?
Au-refte, quels tàlenS ne devroitpas avoir un bon
obfervateur ? Il ne s’agit point ici feulement d’êtrè
entraîné-, pour ainfi dire, pajjivement, comme le
praticien , & de recevoir un rayon de cette vive lu-
"miere qui accompagné le vrai, & qui force au consentement;
il faut revenir de cet état p'affif, & pein-
-dre exaâement- l’effet qu’il a produit, c’eft-à-dire
exprimer clairement ce qu’on a apperçu dans cetté
•forte d'extafe, & l’exprimer par des traits réfléchis ,
<k combiné* 4« manière qu’ils puiffent éclairer le
le&euç
leâeur comme la nature le feroit. Tel eft l’objet de
l’obfervateur, tel eft le talent rare qu’il doit pofféder ;
talent bien différent de celui du fimple praticien, qui
n ’a que des idées paffageres qu’il ne peut pas rendre,
& qui fe renouvellent au befoin, mais que le befoin
feul fait reparoître, & non la réflexion.
Il eft donc évident que l’examen de la doûrine des
crifes regarde plus particulièrement les médecins au-
deflus du commun ; ceux qui fe contenteroient de
fuivre leurs idées, leurs fyftèmes, & non la nature,
ne pourroient que former d’inutiles ou de dangereux
romans, fort éloignés du but qu’on doit fe propofer.
Les obfervateurs même qui fe réduifent à ramafler
des faits, fans avoir affez de génie pour diftinguer
les bons d’avec les mauvais, oc pour les lier les uns
aux autres, n’en approcheraient pas de plus près.
Enfin lqg praticiens les plus répandus n’ont pas affez
de tems à eux ; & il eft rare, outre ce que nous en
avons dit ci-deffus, qu’ils puiffent être atteints, lorf-
que leur réputation eft déjà établie, de la paflion de
faire des réformes générales dans l’Art. Il faudrait
que des obfervateurs fuiviffent exaftement ces praticiens,
& fîffent un recueil exaâ de leurs différentes
manoeuvres, ainfi que les poètes & les hiftoriens le
faifoient autrefois des belles aérions des héros.
Quant aux médecins qui font faits pour enfeigner
dans les écoles, ils ne font que trop fouvent obligés
de s’attacher à un fyftème qui leur vaut toute leur
•confidération. C ’eft de cette forte de médecins, très-
refpeétables & très-utiles fans doute, qu’on peut dire
avec Hippocrate, unufquifque fua orationi tef imonia
& conjecturas addit. . . vincitque hic, modo ille, modo
i f e , cui potijfmum Lingua volubilis ad populum con-
tigerit: « Chacun cherche à s’appuyer de conjeéhi-
» res & d’autorités.. . . l’un terraffe aujourd’hui fon
» adverfaire, & il vient à en être terraffé à fon tour ;
» le plus fort eft communément celui dont le peuple
» trouve la langue la mieux pendue ». Ce font les
malheurs de l’état deprofefleur, qui a bien des avantages
d’ailleurs.
En un mot, il eft nécefîaire pour terminer la quef-
tion des crifes, ou pour l’éclaircir, d’être libre , &
initié dans cette forte de Medecine philofophique ou
tranfeendante, à laquelle il n’eft peut-être pas bon
que tous les médecins populaires, je veux dire cliniques
, s’attachent. En effet on pourrait demander
fi ces médecins populaires ne font pas faits la plû—
part pour copier feulement , -oii pour imiter les
grands maîtres de l’Art. N’y auroit-il pas à craindre
que ces efprits copiftes ou imitateurs, qui font peut-
etre les plus fages & les meilleurs pour la pratique
journalière de la Medecine, ne tombaffent dans le
pyrrhonifme, fi on leur laiffoit prendre un certain
effor ? Ce qu’il y a de certain, c’eft qu’on doit chercher
parmi eux ce que j’appellerais les témoins des
faits particuliers en Medecine ; Sc il femble qu’il convienne
qu’ils foient affujettis à des réglés déterminées
, tant pour leur propre tranquillité, que pour la
fûreté des malades : Sint in memoria tibi morborum
curationes & horum modi , & quomodo in fngulis fe
habeant ; hoc enim principium efi in Medicina, & medium
& finis : v Le commencement, le milieu & la
» fin de la Medecine, font de bien lavoir le traite-
».ment des maladies, & leur hiftoire >j. Voilà ce
qu’Hippocrate exigeoit de fes difeiples. De decenti
ornât.
Voilà.ce qui regarde les médecins ordinaires,
voués à des travaux qui intéreflent journellement la
fociété ; & .dont les l'ervices font d’autant plus précieux
qu’ils font plus réitérés, & qu’ils ne peuvent
fouffrir aucune forte de diftraélion de la part du praticien.
,
U y a des queftions qui font réfervées pour les lé-
gifiateurs de l ’a r t telle eft la doûrine des crifes, J’ap-
To/qe 1
pelle un légifiateur de l'art, le médecin philofophe
qui a commencé par être témoin, qui de praticien eft
devenu grand obfervateur, & qui franchiffant les bornes
ordinaires, s’eft élevé au-deftiis même de fon état.
Ouvrez les faftes de la Medecine, comptez fes lé-
gifiateurs. Voye^ M é d e c in 6* MEDECINE.
Cet article a été fourni par M. DE BORDEU docteur
de la faculté de Montpellier, & médecin de Paris.
CRISTAL, voye^ C ry st al.
* CRISTE ou CRÊTE MARINE, f. f. (.Botan.)
Ses feuilles font étroites, mais plus larges & plus
courtes que celles du fenouil ; charnues, fubdivifées
trois à trais, & falées. Sa.tige eft cannelée, &-verte
comme un porreau ; elle a les fleurs jaunes, & ra-
maffées en parafol. Sa graine reffemble à celle dit
fenouil, elle eft feulement plus grande. Le gofft en
eft agréable, piquant & aromatique. C ’eft une ef-
pece de pourpier de mer : le verd de fa tige va s’é-
clairciffant à mefure qu’elle croît. Elle meurt tous
les ans au commencement de l’hyver, & renaît au
printems vers le commencement de Juillet. Les riverains
la cueillent ôc la vendent pour être falée &
fervir aux falades d’hyver. II faut la faler avec un
vinaigre foible & un peu de fel. Lorfqu’elle a refté
environ un mois dans cette première faumure, on
la tranfvafe, foit dans des barrils ou des pots de
terre, oii l’on met de nouveau vinaigre plus fort.
Le vinaigre blanc de la Rochelle eft celui qui y convient
le mieux. On ajoûte au fel du gros poivre ,
des clous de gerofle, quelques feuilles de laurier ,
& même un peu d’écorce de citron.
La crête marine croît au bord des marais, & fur
les bancs de terre que la marée couvre journellement;
celle-ci eft la plus tendre èc la meilleure :
celle que l’eau de mer mouille plus rarement, eft
fe ehe & dure : des femmes, des filles & des enfans
en font ordinairement la cueillette, qu’ils portent
parTacs & paniers dans les villes voifines : il n’en
croît pas fur les fablespurs. Cette cueillette eft libre
& permife à tout le monde.
CRITHOMANCE, f. f. ( Divinat. Sc Hifi. anc. )
efpece de divination, qui confiftoit à confidérer la
pâte ou la matière des gâteaux qu’on offrait en fa-
crifiee, & la farine qu’on répandoit fur les viûimes
qu’on devoit égorger.
Comme on fe lèrvoit fouvent de farine d’orge
dans ces cérémonies fuperftitieufes, on a appelle
cette forte de divination crithomance , de zpiSn , orge,
8c /Mumia.,-divination. Dict. de Trév. & Chambers.
Cette fuperftition a .été pratiquée dans le Chriftia-
nifme même, par de vieilles femmes qui fe tenoient
autrefois dans les églifes auprès des images des
faints, Sc cju’on nommoit pour cela y.pirptai, au rapport
de Theodore Balfamon cité par Delrio, lib. IKm
cap. ij. queefi. y.fecl. 1. pag. J J j . Pbyeç ALPHITO-
MANCIE; ( G )
CRITIQUE, f. m. ( Belles-lett.) auteur qui s’adonne
à la critique. On comprend fous-ce nom divers
genres d’écrivains dont les travaux Sc les recherches
embraflent diverfes parties de la Littérature,
tels i ° que ceux qui fe font appliqués àraffembler
Sc à faire le dénombrement des ouvrages de chaque
auteur ; à en faire le difeernement, afin de rie point
attribuer à l’un ce qui appartient à l’autre ; à juger
de leur ftylè Sc de leur maniere d’écrire ; à apprendre
le fuccès qu’ils ont eu dans lé monde, Sc le fruit
qu’on doit tirer de leurs écrits. Tels ont été Photius •
Erafme , -lé P. Rapin ,• M. Huet, M. Baillet &cu
z°. Ceux qui par des.differtations particulières ont
éclairci des points obfcurs de l’hiftoire ancienne ou
moderne, tels que Meurfius, Ducange, M. de Lau-
noy, & la pliipart de nos fàvaris de l’académie des
Belles-lettres. 3 °. Ceux qui fe font occupés à recueillir
d’anciens manuferits , à mettre ces collée^