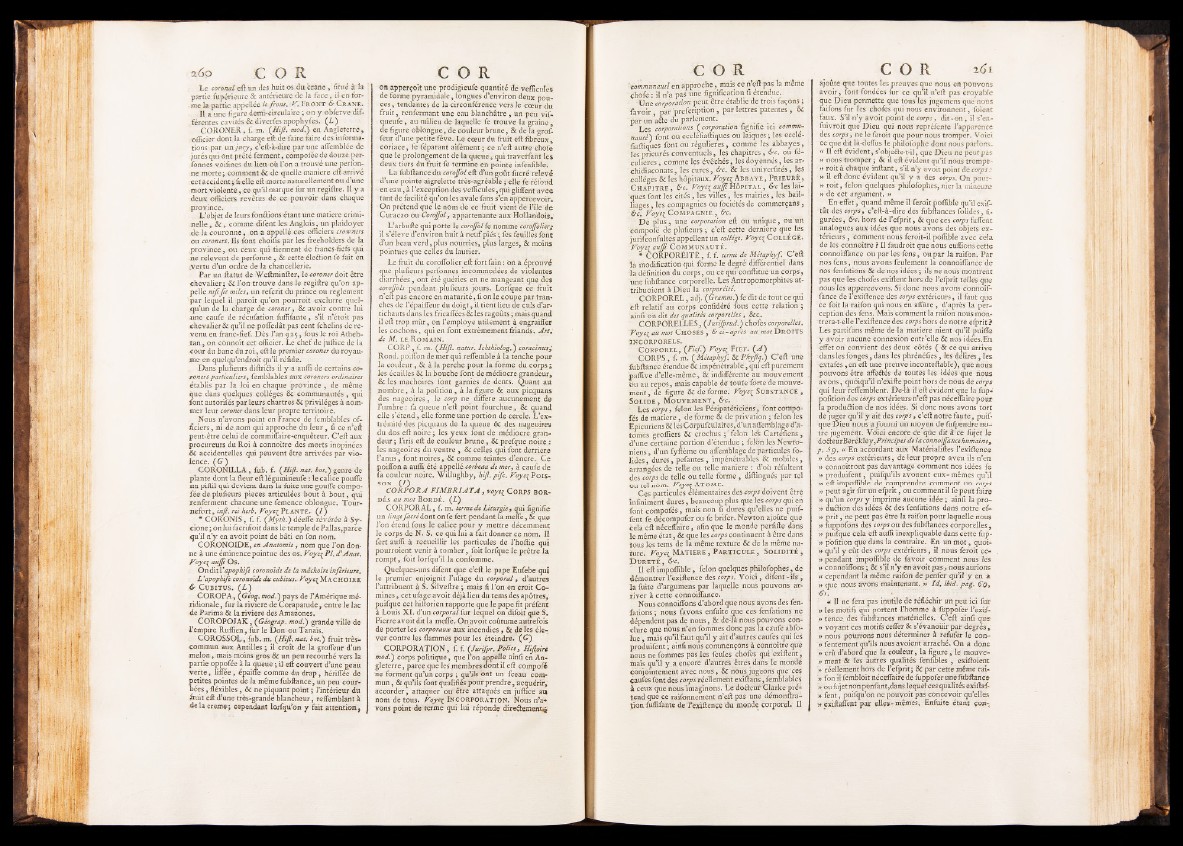
Le coronal eft un des huit os du crâne, fi tué. à fa
partie fupérieure & antérieure de la face, il en forme
la partie appellée le front, V. Front 6* Crâne.
Il a une figure demi-circulaire ; on y obferve différentes
cavités & diverfes apophyfes. (Z. )
CORONER, f. m. (Hifl. mod.} en Angleterre,
officier dont la charge efl: de faire faire des informations
par un;'juryy c’eft-à-dire par une affemblée de
jurés qui ont prêté ferment, compofée de douze, per-
fonnes v.oifines du lieu oh l’on a trouvé une perfon-
ne morte; comment 8c de quelle maniéré eft arrivé
cet accident elle eft morte naturellement ou d’une
mort violente, ce qu’il marque fur un regiflre. Il y a
deux officiers revêtus de ce pouvoir dans chaque
province.
L’objet de leurs fondions étant une matière criminelle
, & , comme difent les Anglais, un plaidoyer
de la couronne, on a appellé.ces officiers crowners
ou coroners. Ils font choifis par les freeholders de la
.province, ou ceux qui tiennent de francs-fiefs qui
-ne relevent de perfohne, & cette éleûion fe fait en
„Vertu d’un ordre de la chancellerie.
Par un Ratut de Weftminfter, le coroner doit être
chevalier; & l’on trouve dans le regiffire qu’on appelle
nijifit miles, un referit du prince ou reglement
par lequel il paroît qu’on pourroit exclurre quelqu’un
de la charge de coroner, 8c avoir contre lui
.une caufe de réeufation fuffifante, s’il n’étoit pas
chevalier & qu’il ne poffedât pas cent fehelins de revenu
en franc-fief. Dès l’an 9 15, fous le roi Atheh-
.tan, on connoît cet. officier. Le chef de juflice de la
cour du banc du roi, efl le premier coroner du royaume
en quelqu’endroit qu’il réfide.
, Dans plufieurs diftri&s il y a auffi de certains coroners
particuliers, femblables aux coroners ordinaires
établis par la loi. en chaque province , de même
que dans quelques collèges 8c communautés , qui
font autorifés par leurs Chartres 8c privilèges à nommer
leur coroner dans leur propre territoire.
Nous n’avons point en France de femblables officiers,
ni de, nom qui approche du leur, fi ce n’eft
peut-être celui de commiffaire-enquêteur. C’efi aux
procureurs du Roi à connoître des morts inopinées
8c accidentelles qui peuvent être arrivées par violence.
(G }
CORON1L L A , fub. f. (Hifl. nat. bot.} genre de
plante dont la fleur eR légumineufe : le calice pouffe
un piftil qui devient dans la fuite une gouffe compofée
de plufieurs pièces articulées bout à bout, qui
renferment chacune une femence oblongue. Tour-
Jiefort, infl. rei herb. Voyez PLANTE. ( / )
* CORONIS, f. f. (Myth.} déeffe révérée à Sy-
cione ; on lui facrifioit dans le temple de Pallas,parce
qu’il n’y en avoit point de bâti enfon nom.
CORONOIDE, en Anatomie , nom que l’on donne
à une éminence pointue des os. Voye^Pl. d’Anat.
f royeiauffiQ&.
On dit Yapophife coronoide de la mâchoire inférieure.
L ’apophife coronoide du cubitus. Voyez Ma C HOIRE
& Cubitus. (L }
COROPA, (Géog. mod.} pays de l’Amérique méridionale
, fur la riviere de Corapatude, entre le lac
de Parima & la riviere des Amazones.
COROPOJAK, (Géograp. mod.} grande ville de
l ’empire Ruffien, fur le Don ou Tanaïs.
COROSSOL, fub. m. (Hifl. nat. bot.} fruit très-
commun aux Antilles ; il croît de la groffeur d’un
melon ,.mais moins gros & un peu recourbé vers la
partie oppofée à la queue ; il eR couvert d’une peau
verte, liffée, épaiffe comme du drap, hériffée de
petites pointes de la même fubftance, un peu courbées
, fléxibles, 8c ne piquant point ; l’intérieur du
fruit efl d’une très-grande blancheur, reffemblant à
de la creme ; cependant lorfqu’on y fait attention ,
on apperçoit une prodigieufe quantité de vefficules
de forme pyramidale, longues d’environ deux pouces
, tendantes de la circonférence vers le coeur du
fruit, renfermant une eau blanchâtre , Un peu vif-
queufe, au milieu de laquelle fe trouve la graine,
de figure oblongue, de couleur brune, & de la groffeur
d’une petite fève. Le coeur du fruit efl fibreux,
coriace, fe féparant aifément ; ce n’efl autre chofe
que le prolongement de la queue I qui traveffaht les
deux tiers du fruit fe termine en pointe infenfible.
La fubRance du coroffol eR d’un goût fueré relevé
d’une pointe aigrelette très-agréable ; elle fe réfoûd
en eau , à l ’exception des vefficules, qui gliffent aVéc
tant de facilité qu’on les avale fans s’en apperce voir.
On prétend que le nom de ce fruit vient dé Pîle de
Curaçao ou Coroffol, appartenante aux Hollandois.'
L’arbufle qui porte le coroffol fe nomme coroffùïier;
il s’élève d’environ huit à neuf pies ; fes feuilles font
d’un beau verd, plus nourries, plus larges, & moins
pointues que celles du laurier.
Le fruit du coroffolier efl fortfain: On a éprouvé
que plufieurs perfonnes incommodées de violentes
diarrhées, ont été guéries en ne mangeant que des
coroflols pendant plufieurs jours. Lorfque ce fruit
n’eff pas encore en maturité, fi on le coupe par tranches
de l’épaiffeur du doigt, il tient lieu de culs d’artichauts
dans les fricaffées &les ragoûts ; mais quand
il efl trop mûr, on l’employe utilement à engraiffer
les cochons, qui en font extrêmement friands. Art«
de M. le Romain.
CORP , f. m. (Hifl. natur. Ichthiolog.} coracinus,
Rond, pôiffon de mer qui reffemble à la tenche pour
la couleur, & à la perche pour la forme du corps ;
les écailles 8c la bouche font de médiocre grandeur,
8c les mâchoires font garnies de dents. Quant au
nombre, à la pofition, à la figure & aux picquans
des nageoires, le corp ne différé aucunement de
l’umbre : fa queue n’eff point fourchue , 8c quand
elle s’étend, elle forme une portion de cercle. L’extrémité
des picquans de la queue 8c des nageoires
du dos efl noire ; les yeux font de médiocre grandeur
; l’iris efl de couleur brune, 8c prefque noire :
les nageoires du ventre , 8c celles qui font derrière
l’anus, font noires, 8c comme teintes d’encre. Ce
poiffon a auffi été appellé-corbeau de mer, à caufe de
la couleur noire. "W’illughby, hifl. pife. Voyez Poisson.
(/)
CORPORA F IM B R IA T A , voyez Corps bordés
au mot Bordé. (V)
CORPORAL , f. m. terme de Liturgie, qui lignifie
un linge facré dont on fe fert pendant la meffe, & que
l’on étend fous le calice pour y mettre décemment
le corps de N. S. ce qui lui a fait donner ce nom. Il
fert auffi à recueillir les particules de l’hoflie qui
pourroient venir à tomber, foit lorfque le prêtre la
rompt, foit lorfqu’il la confomme.
Quelques-uns difènt que c’eff le pape Eufebe qui
le premier enjoignit l’ufage du corporal, d’autres
l’attribuent à S. Silveffre ; mais fi l ’on en croit Comines
, cet ufage avoit déjà lieu du tems des apôtres,’
puifque cet hiflorien rapporte que le pape fit préfent
à Louis XI. d’un corporal fur lequel on difoit que S.
Pierre avoit dit la meffe. On avoit coûtume autrefois
de porteries corporaux aux incendies, & de les élever
contre les flammés pour les éteindre. (G)
CORPORATION, f. f . (Jürifpr. Police, Hifioirt
mod.} corps politique, que l’on appelle ainfi en Angleterre
, parce que les membres dont il efl compofé
ne forment qu’un corps ; qu’ils ont un fceau commun
, & qu’ils font qualifiés pour prendre, acquérir,
accorder, attaquer ou- être attaqués en juflice an
nom de tous. Voyez Incorporation. Nous n’a*
yons point de terne qui lui réponde direfrement^
■ tommunaütl en approche, raais-ce p’eït pas la fiiêriié
çhofe : il n’ a pas une lignification fi étendue.
Une corporation peut être établie de trois façons ;
favoir, par 'prefeription, par lettres patentes , 8c
par itn afte du parlement. _ ■ , .
Les corporations ( corporation figmfie ici communauté}
font ott eccléfiaftiques ou laïques ; les ecclé-
fiaftiques font ou régulières, comme les abbayes,
les prieurés conventuels, les chapitres, &c. où fé-
culief es ; comme les évêchés, les doyennés, les ar-
chidiaconats, les cures, &c. 8c les univerfités, les
Collèges & ies hôpitaux. Voyez Abbaye, Prieuré;
Chapitre, & c. Voyez auffi Hôpital , &c les laïques
font les cités, les villes’, les mairies, les bailliages,
les.compagnies ou fociétésde commerçans,
Oc. Voyez Compagnie, & c.
De plus, une corporation efl ôii unique, ou uh
compofé de plufieurs ; c’eft cette derniere que les
jufifconfultes appellent un collège. Voye{ C ollege*
Voyez auffi Communauté.
* CORPORÉITÉ, f. f. terme de Mètaphyf. C ’eft
la modification qui forme le degré différentiel dans
la définition du corps, ou ce qui conflitue un corps,
une fubftance corporelle. Les Antropomorphites at-
tribuoient à Dieu la corporèitè.
CORPOREL, âdj. (Grammifie dit de tout Ce qui
efl relatif au corps confidéré fous cette relation ;
ainfi on dit des qualités corporelles, :8cc.
CORPORELLES, ( Jurifpmd.) chofés corporelles.
Voyez au mot CHOSES , & ci-apiès au mot Droits
incorporels.
Corporel, ( F i e f } Voye^ Fief . (A~}
CORPS , f. m. ( Mètaphyf. 8c Phyfiqf C ’eft une
fubftance étendue 8c impénétrable, qui eft purement i
paffive d’elle-même, & indifférente au mouvement .
bu aii repos, mais capable dé toute forte de mouvement,
de figure 8c déformé. Voyez Substance ,
Solide, Mouvement, & c.
Les corps, félon les PéripàtétfciériS, font compo-
fés de matière, de forme & de privation ; félon les
Epicuriens 8c lesCorpufculaifés, d’un affembla^ed’a-
toifiés groffiers 8c crochus ; ' félon lé l Cartefiehs,
d’une certaine portion d’étendue ; felôn les Newtoniens,
d’un fyftème ou affemblage de partieulés for ■
lides, dures, pefantes, impénétrables & mobiles,
arrangées de telle ou telle maniéré : d’oîi réfultent ;
des corps de telle ou telle forme , diftingués par tel
Ou tel nom. Voyez Atome.
Ces particules élémentaires des edrps doivent être
infiniment dures, beaucoup plus que les corps qui en !
font compofés, mais non fi dures qu’elles ne puif-
fent fe décompofer ou fe brifer. Newton ajoûte que
bêla eft néceffaife, afin que le monde perfifte dans
le même état, & que les corps continuent à être dans
tous les tems de la même texture & de la même nature.
Voyez Matière, Particule, Solidité,
D ureté, & c. - ,
Il eft împoffiblë, félon quelques philofophes, de i
démontrer l’exiftence des corps. V o ic i, diïent -ils ,
la fuite d’argùmens par laquelle nous pouvons arriver
à cette connoiffance.
Nous connoiffons d’abord que nous avons des feri-
fations; nous (avons enfuite que ces fenfations ne ;
dépendent pas de nous, & de-lâ nous pouvons cdn- ;
dure que nous n’en fommes donc pas la caufe abfo-
lu e , mais qu’il faut qu’il y ait d’autres caufes qui feS
produifent ; ainfi nous commençons à connoître que
nous ne fommes pas les feules chofes qui exiftent ^
mais qu’il y a encore d’autres êtres dans le monde
conjointement avec nous , 8c nous jugeons que ces
çaufes font des corps réellement exiftans, femblables
à ceux que nous imaginons. Lé dofreuf Clarke pré-* j
tend que ce raifonnement n’eft pas une démonftrâ- I
lion fuffifante de Texiftence du inonde corporel. 11 I
ajouté que toutes les preuves que nous en pouvons
avoir, font fondées fur ce qu’il n’eft pas croyable
que Dieu permette que tous les jugemens que nous
faifons fur les chofes qui nous environnent ; foient
faux. S’il n’y avoit point de corps, dit-on ; il s’en-
fuivroit que Dieu qui nous repréfente l’apparence
des corps, ne le feroit que pour nous tromper. Voici
ce que dit là-deffus le philofophe dont nous parlons,
« Il eft évident, s’obje&e-t-il, que Dieu ne peut pas
>> nous tromper ; & il eft évident qu’il nous trompe-
» roit à chaque inftant, s’il n’y avoit point de corps r
» il eft donc évident qu’il y a des corps. On pour"
» roit, félon quelques philofophes, nier la mineure
» de cet argument. »
En effet, quand même il feroit poffible qu’il éxif-
tât des corps, c’eft-à-dire dés fubftances folides, figurées,
'&c. hors de l’efprit, & que ces corps fuffent
analogues aux idées que nous avons des objets extérieurs
, Comment nous feroit-il poffible avec cela
de les connoître ? Il faudroit que nôus euffions cette
connoiffance où par les fens, ou par la raifort. Par
nos fens, nous avons feulement la connoiffance de
nos fenfations & de nos idées ; ils ne nous montrent
pas que les chofes exiftent hors de l’efprit telles que
nous les appereevons. Si donc noiis avons cbnnoif*
fance de l’exiftence des corps extérieurs; il faut que
ce foit la raifon qui nous en affûre , d’après la perception
des fens. Mais comment la raifon nous mon-
'trera-t-elle.l’exifténce des corps hors de notre efprit ?
Les partifàns même de la matière nient qu’il puiffe
y avoir aucune connexion entr’elle & nos idées.En
effet on convient des deux côtés ( & eé qui arrive
dans les fonges, dans lés phrénéfies, le f délires, les
extafés ,en eft une preuve inconteftable), que nous
^pouvons être affefrés de toutes les idées que nous
avons, quoiqu’il n’éxifte point hors de nôus dë corps
qui leur reffemblent. De-là il eft évident que la fup-
pofition des cotps extérieurs ri*eft pas néceffaire pour
la produ&ioft de nos idées. Si donc noiis avons tort
dé juger qu’il y ait des corps, ç’eft notre faute , puif
que Dieu nous a fourni un moyen de fufpendre notre
jugèmérit. Vdici encore de que dit à Ce fujet le
doCteurBèrCklèy,Principes de la cônnoiffahCehumaine>
p. 5g . « En accordant aiix Matérialiftes l’exiftence
des corps extérieurs, de leur propre aveu ils n’en
>> connoîtront pas davantage comment nos idées fe
» produifent, puifqu’ils avouent eux-mêmes qu’il
» eft impoffible de comprendre comment un corps
» petit agir fur un efprit, ou comment il fe peut faire
» qu’un corps y imprime aucune idée ; ainfi la pro-
y, duCtion des idées & des fenfations dans notre ef-
» prit, ne peut pas être la raifon pour laquelle nous
» fuppofons des corps ou des fubftances corporelles,
» puifque cela eft auffi inexpliquable dans cette fup-
» pofition que dans la contraire. En un m ot, quoi-
» qu’il y eût des corps extérieurs, il nous feroit ce-
» pendant impoffible de favoir comment nous les
» connoiffons ; 8c s’il n’y en avoit pas , nous aurions
« Cependant la même raifon de penfer qu’il y en a
» que noirs avons maintenant. » Id. ïbid. pag. Çq0
'Gt. f '. , t
« Il ne fera pas inutile de réfléchir un peu ici fur
» les motifs qui portent l’homme à fuppofer l’exif-
» tence. des fubftances matérielles. C ’eft ainfi que
» voyant ces motifs ceffer & s’évanoiiir par degrés ,
» nous pourrons nous déterminer à refufer le con-
» fentemént qu’ils nousavoierit arraché. On à donc
» crû d’aÊord que la couleur, la figure, le mouve-
» ment & les autres qualités fenïibles , exiftoierit
» réellement hors de l’efprit; 8t par cette même rai-
» fon il fémbloit nécefiaire de fuppofer une fubftance
» ou fuj et non penfant,dâns lequel ces qualités exiftaf-
» fent, puisqu’on ne pOüvoit pas concevoir qu’elles
» exiflaffent par elles-mêmes, Enfuite étant çon-,