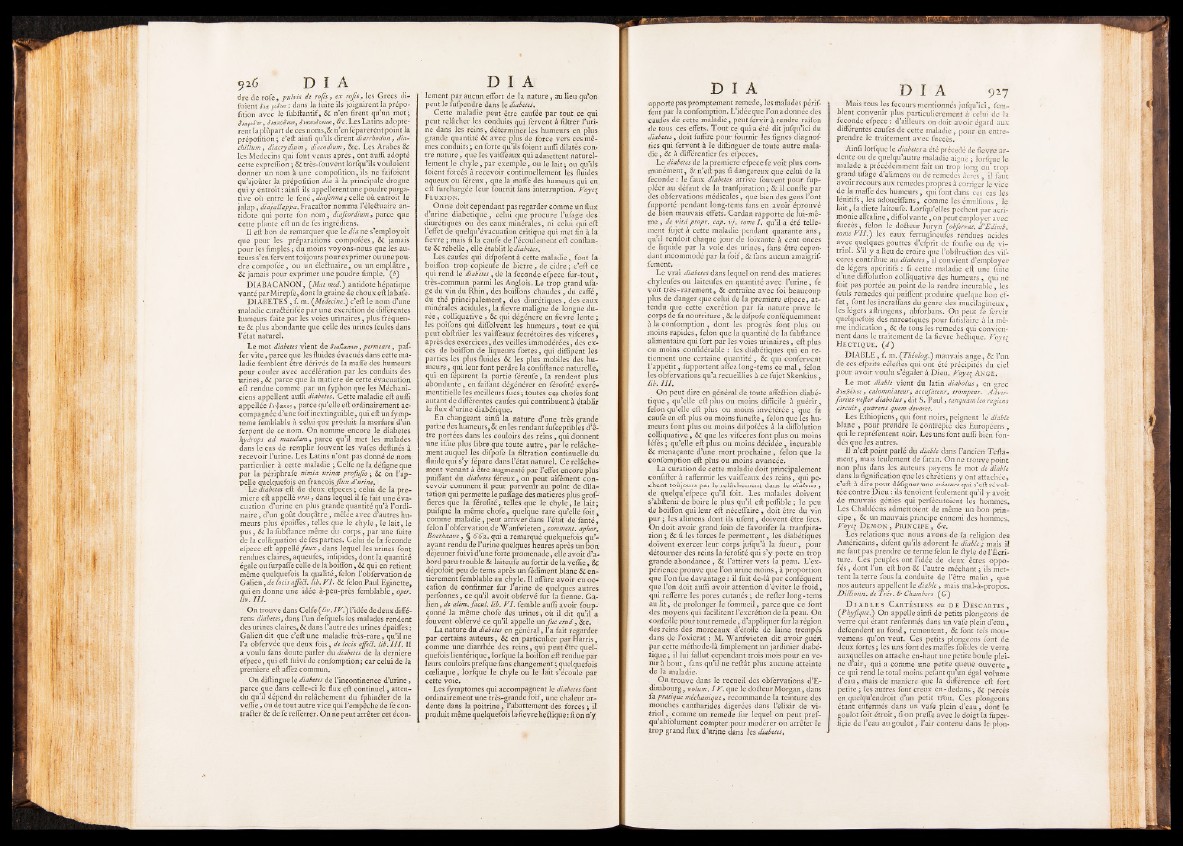
tire de rofe, pulvis de rofls, ex rojjs , les Grecs^ di-
foient S'tct poS'm : dans la fuite ils joignirent la prépo-
fïtion avec le fubftantif, & n’en firent qu’un mot ;
J'iapoS'ov, hanohav, S'ia.x.uS'omtv, &c. Les Latins adoptèrent
la plupart de ces noms,& n’en féparerent point la
prépofition ; c’eft ainfi qu’ils dirent diarfh.od.-on , dia-
chïllum, diacrydiurn, diacodium, &c» Les Arabes &
les Médecins qui font venus après, ont aufli adopté
cette expreflion ; & très-fouvent lorfqu’ils vouloiènt
donner un nom à une compofition, ils ne faifoient
qu’ ajouter la prépofition dia à la principale drogue
qui y entroit : ainfi ils appelèrent une poudre purgative
où entre le fené, diafenna; celle où entroit le
jalap, diajallappa. Fracaftor nomma l’éleûuaire antidote
qui porte fon nom, diafeordium, parce que
cette plante eft un de fes ingrédiens.
Il ell bon de remarquer que le dia ne s’employoit
que pour les préparations compofées, & jamais
pour les fimples ; du moins voyons-nous que les auteurs
s!en fervent toujours pour exprimer ou une pour
dre compofée, ou un éleâuaire, ou un emplâtre,
& jamais pour exprimer une poudre fimple. (’b)
DIABACANON, (Matmed.) antidote hépatique
vanté par Mirepfe, dont la graine de choux eft labafe.
DIABETES , f. m. (Médecine.') c’eft le nom d’une
maladie caraétérifée par une excrétion de différentes
humeurs faite par les voies urinaires, plus fréquente
& plus abondante que celle des urines feules dans
l’état naturel.
Le mot diabètes vient de ha.Ca.miv, ptrmeare, paf-
fer v ite , parce que les fluides évacués dans cette maladie
femblent être dérivés de la maffe des humeurs
pour couler avec accélération par les conduits des
urines, & parce que la matière de cette évacuation
eft rendue comme par un fyphon que les Méchani-
ciens appellent aufli diabètes. Cette maladie eft aufli
appellée h-^&y-oç, parce qu’elle eft ordinairement accompagnée
d’une ioif inextinguible, qui eft un fymp-
tome femblable à celui que produit la morfure d’un
ferpent de ce nom. On nomme encore le diabètes hydrops ad matulam, parce qu’il met les malades
dans le cas de remplir fouvent les vafes deftinés à
recevoir l’urine. Les Latins n’ont pas donné de nom
particulier à cette maladie ; Celfe ne la défigne que
par la périphrafe nimia urines profujîo ; & on l’appelle
quelquefois en françois flux <C urine.
Le diabètes eft de deux efpeces ; celui de la première
eft appellé vrai, dans lequel il fe fait une évacuation
d’urine en plus grande quantité qu’à l’ordinaire
, d’un goût douçâtre, mêlée avec d’autres humeurs
plus epaiffes, telles que le chyle, le lait, le
pus, & la fubftance même du corps, par une fuite
de la colliquation de fes parties. Celui de la fécondé
efpece eft appellé faux, dans lequel les urines font
rendues claires, aqueufes, infipides, dont la quantité
égale oufurpaffe celle de la boiflon, & qui en retient
même quelquefois la qualité,, félon l’obfervation de
Galien, de locis affect. Lib. V I. & félon Paul Eginette,
qui en donne une idée à-peu-près femblable, oper.
liv. III.
On trouve dans Celfe (liv. IV.) l’idée de deux différent
diabètes, dans l’un defquels les malades rendent
des urines claires, & dans l’autre des urines épaiffes:
Galien dit que c’eft une maladie très-rare, qu’il ne
l’a obfervée que deux fois, de locis affect, lib. III. Il
a voulu fans doute parler du diabètes de la derniere
efpece, qui eft fuivi de confomption; car celui de la
première eft affez commun.
On diftingue le diabètes de l’incontinence d’urine,
parce que dans celle-ci le flux eft continuel, attendu
qu’il dépend du relâchement du fphinéler de la
veflie, ou de tout autre vice qui l ’empêche de fe contracter
& de fe refferrer. On ne peut arrêter cet écoulement
par aucun effort de la nature, au lieu qu’on
peut le fufpendre dans le diabètes.
Cette maladie peut être caufée par tout ce qui
peut relâcher les conduits qui fervent à filtrer l’urine
dans les reins-, déterminer les humeurs en plus
grande quantité & avec plus de force vers ces mêmes
conduits) en forte qu’ils foient aufli dilatés contre
nature , que les vaiffeàux qui admettent naturellement
le ch yle, pair exemple, ou le lait ; ou qu’ils
foient forcés à recevoir continuellement les fluides
aqueux Ou féfeUx, que la mafle des humeurs qui en.
eft furchargée leur fournit fans interruption. Voye£
F l u x i o n .
On ne doit Cependant pas regarder comme un flux
d’urine diabétique, celui que procure l’ufage des
diurétiques Ou des eaux minérales, ni celui qui eft:
l’effet de quelqu’évacuation critique qui met fin à la
fievre ; mais fi la caufe de l’écoulement eft confiante
& rébelle, elle établit 11 diabètes.
Les caufes qui difpofentà cette maladie, font la
boiflon trop copieufe de biefre , de cidre ; c’eft ce
qui rend le diabètes , de la fécondé efpece fur-tout,
très-commun parmi les Anglois. Le trop grand ufa-
ge du vin du Rhin, des boiflbns chaudes , du caffé,
du thé principalement, des diurétiques, des eaux
minérales acidulés, la fievre maligne de longue durée
, colliquative, &c qui dégénéré en fievre lente ;
les poifôns qui diffolvent les humeurs, tout ce qui
peut obftriier les vaifleaux fecrétoires des vifeeres ,
après des exercices, des veilles immodérées, des excès
de boiflon de liqueurs fortes, qui diflipent les
parties les plus fluides & les plus mobiles des humeurs
, qui leur font perdre la confiftance naturelle,
qui en féparent la partie féreufe, la rendent plus
abondante, en faifant dégénérer en férofité excré-
mentitielle les meilleurs fucs ; toutes ce? chofes font
autant de différentes caufes qui contribuent à établir
le flux d’urine diabétique.
En changeant ainfi la nature d’une très-grande
partie de? humeurs, & en les rendant fufceptibles d’être
portées dans les couloirs des reins, qui donnent
une ifTue pliis libre que toute autre, par le relâchement
auquel lés difpofe la filtration continuelle du
fluide qui s’y fépare dans l’état naturel. Ce relâchement
venant à être augmenté par l’effet encore plus1
puiflant du diàbetes féreux, on peut aifément concevoir
comment il peut parvenir au point de dilatation
qui permette le paftage des matières plus grof-
fieres que la férofité, telles que le chyle, le lait;
puifque la même chofe, quelque rare qu’elle foit,
comme maladie, peut arriver dans l’état de fanté,
félon l’obfervation de Wanfwieten, comment, aphor.
Boerhaave, § 6Gx. qui a remarqué quelquefois qu’ayant
rendu de l’urine quelques heures après un bon
déjeuner fuivi d’une forte promenade, elle avoit d’abord
paru trouble & laiteufe au fortir de la veflie, &
dépofoit peu de tems après un fédiment blanc & entièrement
femblable au chyle. Il aflïire avoir eu oc-
cafion de confirmer fur l’urine de quelques autres
perfonnes, ce qu’il avoit obfervé fur la fienne. Galien,.^
alim. facul. lib. VI. femble aufli avoir foup-
çonné la même chofe des urines, où il dit qu’il a
fouvent obfervé ce qu’il appelle un fuc crud, &c.
La nature du diabètes en général, l’a fait regarder
par certains auteurs, & en particulier par Harris,
comme une diarrhée des reins, qui peut être quelquefois
lientérique, lorfque la boiflon eft rendue par
leurs couloirs prefque fans changement ; quelquefois
coeliaque, lorfque le chyle ou le lait s’écoule par
cette voie.
Les fymptomes qui accompagnent le diabètes font
ordinairement une très-grande foif, une chaleur ardente
dans la poitrine, l’abattement des forces ; il
produit même quelquefois la-fievre heétique : fi on n’y
SBSKÎ5
apporté pas promptement remede, les malades périf-
ient par la confomption. L’idée que l’on a donnée des
•caufes de cette maladie, peutfervirà rendre raifon
de tous çes effets. Tout ce qui a été dit jufqu’ici du
diabètes, doit fuffire pour , fournir les Agnes diagnof-
tics qui fervent à le diftinguer de toute autre maladie,
& à différentier fes efpeces.
Le diabètes de la première efpece fe voit plus communément
, & n’eft pas fi dangereux que celui de la
fécondé ; le faux diabètes arrive fouvent pour fup-
pléer au défaut de la tranfpiration ; & il confie par
des obfervations médicales, que bien des gens l’ont
fupporté pendant long-tems fans en avoir éprouvé
de bien mauvais effets. Cardan rapporte de lui-même
, de vitâ propr. cap. vj. tome I. qu’il a été tellement
fujet à cette maladie pendant quarante ans,
qu’il rendoit chaque jour de foixante à cent onces
de liquide par la voie des urines, fans être cependant
incommodé par la foif, & fans aucun amaigrif-
fement.
Le vrai diabètes dans lequel on rend des matières
chyleufés ou laiteufes en quantité avec l’urine, fe
voit très-rarement, & entraîne avec foi beaucoup
plus de danger que celui de la première efpece, attendu
que cette excrétion par fa nature prive le
corps de fa nourriture, & le difpofe conféquemment
à la confomption, dont les progrès font plus ou
moins rapides, félon que la quantité de la fubftance
alimentaire qui fort par les voies urinaires, eft plus
ou moins confidérable : les diabétiqües qui en retiennent
une certaine quantité , & qui confervent
l ’appétit, fupportent affez long-tems ce mal, félon
les obfervations qu’a recueillies à ce fujet Skenkius,
lib. III.
On peut dire en général de toute affeélion diabétique
, qu’elle eft plus ou moins difficile à guérir,
félon qu’elle eft plus Ou moins invétérée ; que fa
caufe en eft plus ou moins funefte, félon que les humeurs
font plus ou moins difpofées à la diffolption
colliquative, & que les vifeeres font plus ou moins
lefés ; qu’elle eft plus ou moins décidée, incurable
& menaçante d’une mort prochaine, félon que la
confomption eft plus ou moins avancée.
La curation de cette maladie doit principalement
confifter à raffermir les vaifleaux des reins, qui pèchent
toûjours par le relâchement dans le diabètes ,
de quelqu’efpece qu’il foit. Les malades doivent
s’abftenir de boire le plus qu’il eft poflible ; le peu
de boiflon qui leur eft néceffaire, doit être du vin
pur ; les alimens dont ils ufent, doivent être fecs.
On doit avoir grand foin de favorifer la tranfpiration
; & fi les forces le permettent, les diabétiques
doivent exercer leur corps jufqu’à la lueur, pour
détourner des reins la férofité qui s’y porte en trop
grande abondance, & l’attirer vers la peau. L’expérience
prouve que l’on urine moins, à proportion
que l’on fue davantage : il fuit de-là par conséquent
que l’on doit aufli avoir attention d’éviter le froid,
qui refferre les pores cutanés ; de refter long-tems
au lit , de prolonger le fommeil, parce que ce font
des moyens qui facilitent l ’excrétion de la peau. On
confeille pour tout remede, d’appliquer fur la région
des reins des morceaux d’étoffe de laine trempés
dans de l’oxicrat : M. "Wanfwieten dit avoir guéri
par cette méthode-là Amplement un jardinier diabétique
; il lui fallut cependant trois mois pour en venir
à bout, fans qu’il ne reliât plus aucune atteinte
de la maladie.
On trouve dans le recueil des obfervations d’Edimbourg
, volum. IV . que le doéleur Morgan, dans
{a. pratique méchanique, recommande la teinture des
mouches cantharides digérées dans l’elixir de vitriol
, comme un remede fur lequel on peut pref-
qu’abfolument compter pour modérer ou arrêter le
trop grand flux d’urine dans les diabètes,
Mais tous les fecours mentionnés jufqu’ic i, femblent
convenir plus particulièrement à celui de la
fécondé efpece : d’ailleurs on doit avoir égard aux
differentes caufes de cette maladie, pour en entreprendre
le traitement avec fuccès.
Ainfi lorfque le diabètes a été précédé de fievre ardente
ou de quelqu’autre maladie aiguë ; lorfque le
malade a précédemment fait un trop long ou trop
grand ufage d’alimens ou de remedes âcres , il faut
avoir recours aux remedes propres à corriger le vice
de la maffe des humeurs, qui font dans ces cas les
lénitifs, les adouciffans, comme les émulfions, le
lait, la diete laiteufe. Lorfqu’elles pechent par acrimonie
alkaline, diffol vante, on peut employer avec
fuccès, félon le doéleur Juryn (obfervat. d’Edimb.
tome VII.) les eaux ferrugineufes rendues acides
avec quelques gouttes d’efprit de foufre ou de vitriol.
S’il y a lieu de croire que Tobftruêtion des vifeeres
contribue au diabètes, il convient d’employer
de légers apéritifs : fi. cette maladie eft une fuite
d’une diffolution colliquative des humeurs , qui ne
foit pas portée au point de la rendre incurable, les
feuls remedes qui puiffent produire quelque bon effet
, font les incraffans du genre des mucilagineux,
les légers aftringens, abforbans. On peut fe fervir
quelquefois des narcotiques pour fatisfaire à la même
indication , & de tous les remedes qui conviennent
dans le traitement de la fievre heêtique. Voyeç
H e c t i q u e , , ( ^ )
DIABLE, f. m. ( Théolog.) mauvais ange, & l’un
de ces efprits céleftes qui qnt été précipités du ciel
pour avoir voulu s’égaler à Dieu. Vqyei A n g e .
Le mot diable vient du latin diabotus, en grec
hetfioXoç , calomniateury accufateur, trompeur, ddver-
fariusvefier diabolus, dit S. Paul, tanquamleorugienS
circuit, quoerens quem devoret.
Les Ethiopiens, qui font noirs, peignent le'diable
blanc , pour prendre le contrepié des Européens ,
qui le repréfentent noir. Les uns font aufli bien fondés
que les autres»
Il n’eft point parlé du diable dans l’ancien Tefta-
ment, mais feulement de fatan. On ne trouve point
non plus dans les auteurs payens le mot de diable
dans la lignification que les chrétiens y ont attachée,
c’eft-à-dire pour défigner une créature qui s’eft révoltée
contre Dieu : ils tenoient feulement qu’il y avoit
de mauvais génies qui perfécutoient les hommes»
Les Chaldéens admettoient de même un bon principe
, & un mauvais principe ennemi des hommes»
Voyeç D é m o n , P r i n c i p e , &c.
Les relations que nous avons de la religion des
Américains, difent qu’ils adorent le diable; mais il
ne faut pas prendre ce terme félon le ftyle de l’Écriture.
Ces peuples ont l’idée de deux êtres oppo-
fé s , dont l’un eft bon & l’autre méchant ; ils mettent
la terre fous la conduite de l’être xnalin , que
nos auteurs appellent le diable, mais mal-à-propos»
Diclionn. de Trév. & Chambers (G)
D i a b l e s C a r t é s i e n s ou d e D e s c a r t e s ,
(Phyflque.) On appelle ainfi de petits plongeons de
verre qui étant renfermés dans un vafe plein d’eau,
defeendent au fond, remontent, & font tels mou-
vemens qu’on veut. Ces petits plongeons font de
deux fortes ; les uns font des maffes folides de verre
auxquelles on attache en-haut une petite b.oule pleine
d’air, qui a comme une petite queue ouverte,
ce qui rend le total moins pefant qu’un égal volume
d’eau, mais de maniéré que la différence eft fort
petite; les autres font creux en-dedans, & percés
en quelqu’endroit d’un petit trou. Ces plongeons
étant enfermés dans un vafe plein d’eau, dont le
goulot foit étroit, fi on preffe avec le doigt la fuper-
fiçie de l’eau au goulot, l’air contenu dans le pion