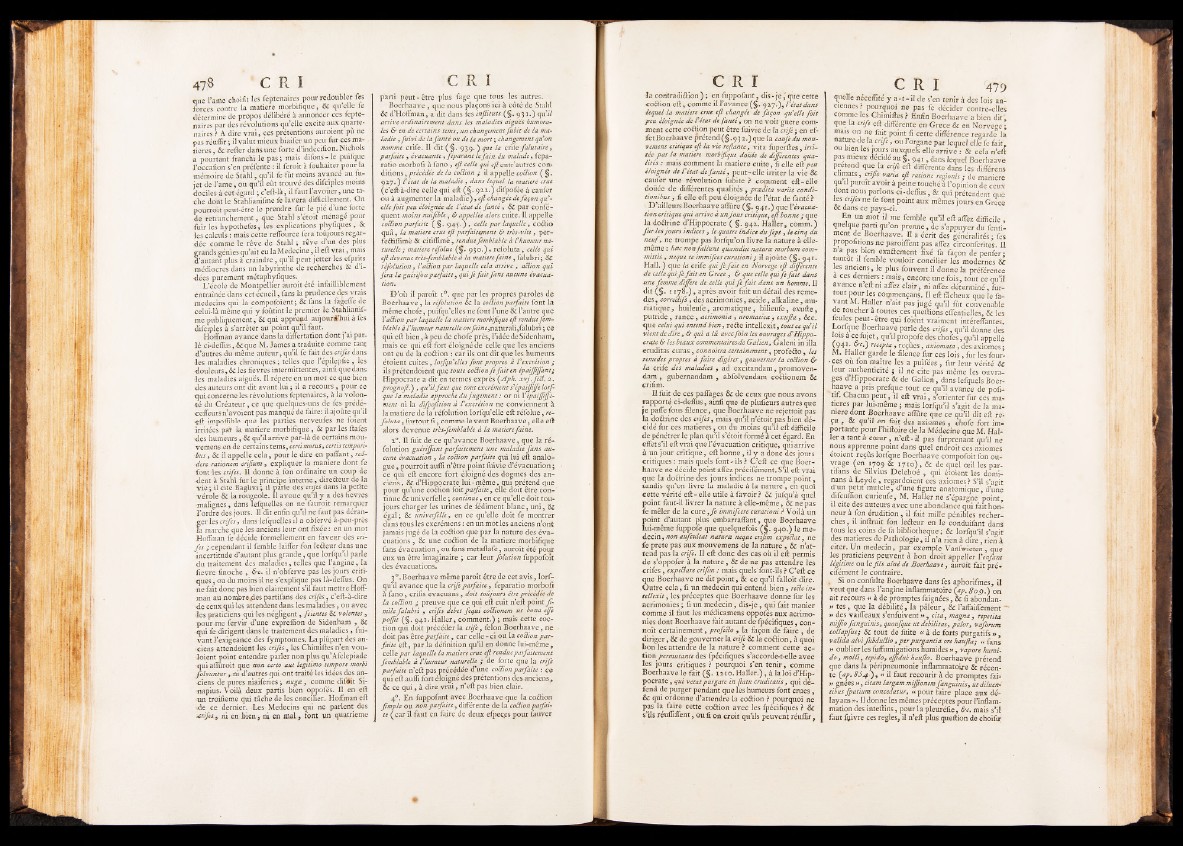
que l'ame choifït les feptenaires pour redoubler f e
forces contre la matière morbifique, & quelle le
détermine de propos délibéré à annoncer ces feptenaires
par des révolutions qu’elle excite aux quarte-
naires ? A dire vrai, ces prétentions auroient pu ne
pas réuffir ; il valut mieux biaifer un peu fur ces ma- ,
tieres, •& refter dans une forte d’indécifion. Nichois
a pourtant franchi le pas; mais difons-le puifque
l’occafion s’en préfente : il feroit à fouhaiter pour la
mémoire de Stahl, qu’il fe fût moins avancé au fu-
iet de l’ame, ou qu’il eût trouve des difciples moins
dociles à cet égard ; c’eft-là, il faut l’avoiïer, une tache
dont le Stahlianifme fe lavera difficilement. On
pourroit peut-être le prendre fur le pié d’une forte
de retranchement-, que Stahl s’étoit ménage pour
fuir les hypothefes, les explications phyfiques, &
les calculs : mais cette reffource fera toujours regardée
comme le rêve de Stahl ; rêve dun des plus
grands génies qu’ait eu la Medecine, il eft vra i, mais
d’autant plus à craindre, qu’il peut jetter les efprits
médiocres dans un labyrinthe de recherches & d i-
dées purement métapnyfiques,
L’ecole de Montpellier auroit été infailliblement
entraînée dans cet écueil, fans la prudence d p vrais
médecins qui la compofoient ; &c fans la fageffe de
celui-là même qui y foûtint le premier le Stahliaûif-
me publiquement, St qui apprend aujourd’hui a fes
difciples à s’arrêter au point qu’il faut.
Hoffman avance dans la diuertation dont j’ai parlé
ci-deffus, St que M. James a traduite comme tant
d’autres du même auteur, qu’il fe fait des crifes dans
•les maladies chroniques ; telles que l’épilepfie, les
douleurs, St les fievres intermittentes, ainfi que dans
•les maladies aiguës. Il répété en un mot ce que bien
des auteurs ont dit avant lui ; il a recours , pour ce
•qui concerne les révolutions feptenaires, à la volonté
du Créateur, ce que quelques-uns de fes prédé-
•ceffeursn’avoient pas manqué de faire: il ajoûte qu’il
*ft impoffible que les parties nerveufes ne foient
irritées pat la matière morbifique, St par les ftafes
des humeurs, St qu’il arrive par-là de certains mou-
vemens-ende certains tems, certimotus, certis tempori-
•bus , St il appelle cela, pour le dire en paffant, red-
dere rationem crifium , expliquer la maniéré dont fe
font les crifes. 11 donne à fon ordinaire un coup de
dent à Stahl fur le principe interne, direâeur de la
vie ; il cite Raglivi ; il parle des crifes dans la petite
vérole St la rougeole. Il avoue qu’il y a des fievres
-malignes, dans lefquelles on ne fauroit remarquer
l’ordre des jours. Il dit enfin qu’il ne faut pas déranger
les crifes, dans lefquelles il a obfervé à-peu-près
-la marche que les anciens leur ont fixée : en un mot
Hoffman fe décide formellement en faveur des crifes
; cependant il femble laiffer fon leâeur dans une
•incertitude d’autant plus grande, que lorfqu’il parle
du traitement des maladies, telles que l’angine, la
fievre finoche , 6*c. il n’obferve pas les jours critiques
, ou du moins il ne s’explique pas là-deffus. On
ne fait donc pas bien clairement s’il faut mettre Hoffman
au nombre/les partifans des crifes, c’eft-à-dire
d e ceux qui les attendent dans les maladies, ou avec
■ les praticiens qui les négligent, feientes & volentes ,
pour me fervir d’une expreffion de Sidenham , &
-qui fe dirigent dans le traitement des maladies , fui-
vantl.’exigeance des fymptomes. La plupart des anciens
attendoient les crifes, les Chimiftes n’en vou-
loient point entendre parler non plus qu’Afclepiade
qui affuroit que non certo aut legitimo tempore morbi
folvuntur ,.m d’autres qui ont traité les idées des anciens
de pures niaiferies ; nugee, comme diriSdt Si-
siapius. Voilà deux partis bien oppofés. Il en eft
-un troifieme qui tâche de les concilier. Hoffman eft
-de ce dernier. Les Médecins qui ne parlent des
jcrlfts^ ni en bien, ni en mal, font un quatrième
parti peut-être plus fage que tous les autres.
Boerhaave , que nous plaçons ici à côté de Stahl
& d’Hoffman, a dit dans les injlituts (§ . 931.) qu’i/
arrive ordinairement dans les maladies aiguës humorales
& en de certains tems, un changement fubit de la maladie
yfuivi de la fanté ou de la mort ; changement qu’on
nomme crife. Il dit ( § . 939.) que la crifè falutaire,
parfaite, évacuante, féparant le foin du malade , fepa-
ratio morbofi à fano, ejl celle qiù eft entr’autres conditions
, précédée de la coclion y il appelle coclion ( § .
927. ) l'état de la maladie , dans lequel la matière crue
(c’eft-à-dire celle qui eft (§ . 922.) difpofée à caufer
ou à augmenter la maladie) 3 ejl changée de façon qu'elle
foit peu éloignée de l'état de fanté , & par cohfé-
quent moins nuifible, & appellée alors cuite. Il appelle
coclion parfaite ( § . 945. ) , celle par laquelle, coûio
quâ, la matière crue ejl parfaitc/nent & trcs-vlte , per-
fe&iffimè & citiffimè, rendue fernblakle à l’humeur naturelle
; matière réj'olue (§“. 930.), refoluta, celle qui
ejl devenue très-femblable à la matière faine , falubri; Sc
réfolution , l'action par laquelle cela arrive , action qui
fera la guérifon parfaite, qui fe fait fans aucune évacuation.
D ’où il paroît i° . que par les propres paroles de
Boerhaave, la réfolution 8c la coaionparfaite font la
même chofe, puifqu’elles ne font l’une & l’autre que
Y action par laquelle la matière morbifique eft rendue ftm-
blable à l'humeur naturelle ouyâi/ze,naturali,falubri ; ce
qui eft bien, à peu de chofe près, l’idée de Sidenham,
mais ce qui eft fort éloigné de celle que les anciens
ont eu de la coûion : car ils ont dit que les humeurs
étoient cuites, lorfqu’elles font propres à l'excrétion y
ils prétendoient que toute coclion fe fait en épaiffiffant;
Hippocrate a dit en termes exprès (Aph. xvj.Jècl. z .
prognojl.) , qu'il faut que tout excrément s’èpaijjîffe lorf-
que la maladie approche du jugement : or ni l’épaiffiffe-
ment ni la difpojition à l'excrétion ne conviennent à
la matière de la réfolution lorfqu’elle eft réfolue, refoluta
, furtout fi, comme le veut Boerhaave, elle eft
alors devenue très-femblable à la matière faine.
2°. Il fuit de ce qu’avance Boerhaave, que la réfolution
guériffant parfaitement une maladie fans aucune
évacuation , la coclion parfaite qui lui eft analogue
, pourroit aufli n’être point fuivie d’évacuation;
ce qui eft encore fort éloigné des dogmes des anciens
, & d’Hippocrate lui - même, qui prétend que
pour qu’une coêfion foit parfaite, elle doit être continue
& univerfelle ; continue, en ce qu’elle doit toujours
charger les urines de fédiment blanc, uni, &
égal; & univerfelle y en ce qu’elle doit fe montrer
dans tous les excrémens : en un mot les anciens n’ont
jamais jugé de la coâion que par la nature des évacuations
, & une coftion de la matière morbifique
fans évacuation, ou fans metaftafe, auroit été pour
eux un être imaginaire ; car leur folution fuppofoit
des évacuations.
30. Boerhaave même paroît être de cet avis, lorfqu’il
avance que la crife parfaite, feparatio morbofi
à fano, crifis evacuans, doit toujours être précédée de
La coclion y preuve que ce qui eft cuit n’eft point Ji-
mile falubri , crifis debet fequi coctionem ut bona eJJe
poffit (§ . 941. Haller, comment.) ; mais cette coc-
tion qui doit précéder la crife, félon Boerhaave, ne
doit pas être parfaite, car celle-ci ou la coclion parfaite
eft, par la définition qu’il en donne lui-même,
celle par laquelle la matière crue ejl rendue parfaitement
femblable à l’humeur naturelle y de forte que la crife
parfaite n’eft pas précédée d’une coclion parfaite : ce
qui eft aufli fort éloigné des prétentions des anciens,
& ce q u i, à dire v ra i, ri*eft pas bien clair.
40. En fuppofant avec Boerhaave que la coftion
fimple ou non parfaite, différente de la coclion parfaite
(car il faut en faire de deux efpecjes pour fauver
•la coritradi&iôn ) ; en fuppofant, dis - j e , que cetté
•coérion eft, comme il l’avance (§ . 927.), l'état dans
lequel la matière crue eft changée de façon qu’elle foit
peu éloignée de Cétat de fanté, on ne voit guere comment
cette cottion peut être fuivie de la crife ; en effet
Boerhaave prétend(§.932.) que la caufedu mou-
vement critique ejl la vie rejlante, vita fuperftes, irritée
par la matière morbfique douée de différentes qualités
: mais comment la matière cuite, fi elle èftpeu
éloignée de l ’état de fanté, peut-elle irriter la vie &
caufer une révolution fubite ? comment eft-elle
douée de différentes qualités , preedita variis condi-
tionibus y fi elle eft peu éloignée de l’état de fanté ?
D ’ailleurs Boerhaave affûre ( § . 941.) que Y évacuation
critique qui arrive à un jour critique, ejt bonne ; que
la doûrine d’Hippocrate ( § . 942. Haller, comm.)
fur les jours indices , le quatre indice du fept, le cinq du
neuf y ne trompe pas lorfqu’on livre la nature à elle-
meme : hase non fallunt quamdiu natures morbum com-
■ mittisy neque te immifeescurationi; il ajoûte ( § .9 4 1 .
Hall. ) que la crife qui fe fait en Norvège ejl differente
■ de celle quife fait en Grece , & que celle qui fe fait dans
une femme, diffère de celle qui fe fait dans un homme. Il
dit ( § . 1 178 .), après avoir fait un détail des reme-
des, correctifs, des acrimonies, acide, alkaline, muriatique
, huileufe, aromatique, bilieufe, exufte,
putride, rance, acrimonia , aromatica , exufla , &c.
■ que celui qui entend bien, refte intellexit, tout ce qu’il
vient de dire , & qui a lu avec foin les ouvrages d?Hippocrate
& les beaux commentaires de Galien, Galeni in ilia
eruditas curas, connoitra certainement, profeâo, les
remedes propres à faire digérer, gouverner la coclion &
la crife des maladies , ad excitandam, promoven-
dam, gubernandam , abfolvendam coûionem &
crifim.
Il fuit de cesqjaffages & de ceux que nous avons
rapporté ci-deflus, ainfi que de plufieurs autres que
je pafle fous filence, que Boerhaave ne rejettoit pas
la doôrine des crifes, mais qu’il n’étoit pas bien décidé
fur ces matières, ou du moins qu’il eft difficile
de pénétrer le plan qu’il s’étoit formé à cet égard. En
effet s’il eft vrai que l’évacuation critique, qui arrive
à un jour critique, eft bonne, il y a donc des jours
critiques: mais quels font-ils? C ’eft ce que Boerhaave
ne décide point affez précifément. S’il eft vrai
que la do&rine des jours indices ne trompe point,
tandis qu’on livre la maladie à la nature , en quoi
cette vérité eft-elle utile à favoir? & jufqu’à quel
point faut-il livrer la nature à elle-même, & ne pas
fe mêler de la cure yfe immifeere curationi ? Voilà un
point d’autant plus embarraffant, que Boerhaave
lui-même fuppofe que quelquefois (§ . 940.) le médecin
, non aufcultat natures neque crifim expeclat. ne
fe prete pas aux mouvemens de la nature , & n’attend
pas la crife. Il eft donc des cas où il eft permis
de s’oppofer à la nature, & de ne pas attendre les
crifes, expeclare crifim : mais quels'font-ils ? C ’eft ce
que Boerhaave ne dit point y & ce qu’il falloit dire.
Outre cela, fi un médecin qui entend bien , recle intellexit
, les préceptes que Boerhaave donne fur les
acrimonies ; fi un médecin, dis-je, qui fait manier
comme il faut les médicamens oppofes aux acrimonies
dont Boerhaave fait autant de fpécifiques, con-
noît certainement, profeclo , la façon de faire , de
diriger, & de gouverner la crife & la coftion, à quoi
bon les attendre de la nature ? comment cette action
permutante des fpécifiques s’accorde-t-elle avec
les jours critiques ? pourquoi s’en tenir, comme
Boerhaave le fait (§ . 1210. Haller.), à la loi d’Hippocrate
, qui vetat purgare in Jlatu cruditatis , qui défend
de purger pendant que les humeurs font crues,
& qui ordonne d’attendre la cottion ? pourquoi ne
pas la faire cette coftion avec les fpécifiques ? &
s’ils reuffiffent, ou fi on croit qu’ils peuvent réuffir ,
quelle néceffité y a - t - i l de s’en tenu- à des lois anciennes
? pourquoi ne pas fe décider contre-elles
comme les Chimiftes ? Enfin Boerhaave a bien dit',
que la crife eft différente en Grece & en Norvège ;
mais on ne fait point fi cette différence regarde la
nature de la crife, du l’organe par lequel elle fe fait,
ou bien les jours auxquels elle arrive : & cela n’eft
pas mieux décidé au § . 9 41 , dans lequel Boerhaave
prétend que la crife eft différente dans les différens
climats, crçfts varia ejl ratione regionis; de maniéré
qu il paroit avoir à peine touché à l’opinion de ceux
dont nous parlons ci-deffus, & qui prétendent que
les crifes ne fe font point aux mêmes jours en Grèce
et dans ce pays-ci.
En un mot il me femble qu’il eft afîez difficile ,
quelque parti qu’on prenne, de s’appuyer du fenti-
ment de Boerhaave. Il a écrit des généralités ; fes
propofitions ne paroîflent pas affez circonfcrites. Il
n a pas bien exactement fixé fa façon de penfer ;
tantôt il femble vouloir concilier les modernes &
es anciens, le plus fouvent il donne la préférence
à ces derniers : mais, encore une fois, tout ce qu’il
avance n eft ni affez clair, ni affez déterminé, fur-
tout pour les coQimençans. Il eft fâcheux que le fa-
vant M. Haller n’ait pas jugé qu’il fût convenable
de toucher à toutes ces queftions effentielles, & les
leules peut-etre qui foient vraiment intéreffantes.
Lorfoue Boerhaave parle des crifes, qu’il donne des
lois à ce fujet, qu’il propofe des chofes, qu’il appellé
( 941* accepta , reçûes, axiomata, des axiomes ;
M. Haller garde le filence fur ces lo is , fur les four-
• ces ou fon maître les a puifées , fur leur vérité &
leur authenticité ; il ne cite pas même les ouvrages
d.Hippocrate & de Galien, dans lefquels Boer-
haave a pris prefque tout ce qu’il avance de pofi-
tir. Chacun peut, il eft v ra i, s’orienter fur ces matières
par lui-même ; mais lorfqu’il s’agit de la maniéré
dont Boerhaave affûre que ce qu’il dit eft re^
çu , & qu il en fait des axiomes , chofe fort importante
pour l’hiftoire de la Médecine que M. Haller
a tant à coeur, n’eft - il pas furprenant qu’il ne
nous apprenne point dans quel endroit ces axiomes
etoient. reçûs lorfque Boerhaave compofoit fon ouvrage
(en 1709 & 17 10 ), & de quel oeil les par-
tifans de Silvius Deleboé , qui étoient les dominons
à Leyde , regardoient ces axiomes ? S’il s’agit
d’un petit mufcle, d’une figure anatomique, d’une
difeuffion curieufe, M. Haller ne s’épargne point,
il cite des auteurs avec une abondance qui fait honneur
à fon érudition, il fait mille pénibles recherches
, il inftruit fon le&eur en le conduifant dans
tous les coins de fa bibliothèque; & lorfqu’il s’agit
des matières de Pathologie, il n’a rien à dire, rien à
citer. Un médecin, par exemple Vanfwieten, que
les praticiens peuvent à bon droit appeller Y enfant
légitimé pu le fils aîné de Boerhaave y auroit fait précifément
le contraire.
„ Si on confulte Boerhaave dans fes aphorifmes, il
veut que dans l’angine inflammatoire (ap. 8og.') on
ait recours « à de promptes faignées, & fi abondan-
» tes, que la débilité, la pâleur, & l’affaiffement ^
» des vaiffeaux s’enfuivent » , cita, magna , repetita
miffio fanguinisy quoufque ut débilitas, palort vaforum
collapfus; & tout de fuite « à de forts purgatifs »>,
valida alvi fubduBio , per purgantia ore haufia; « fans
» oublier les fuffiimigations humides » , vapore humi-
do y molli, tepidoy ajfiduè haufio. Boerhaave prétend
que dans la péripneumonie inflammatoire & récente
(ap. 854 J , « il faut recourir à de promptes fai=
» gnées », citam largam mijfionem fanguinis, ut diluen•'
tibus fpatium concedatur, « pour faire place aux dé-
layans ». Il donne les mêmes préceptes pour l’inflammation
des inteftins, pour la pleuréfie, &c. mais s’il
faut fyivre ces réglés, il n’eft plus queftion de choifir.