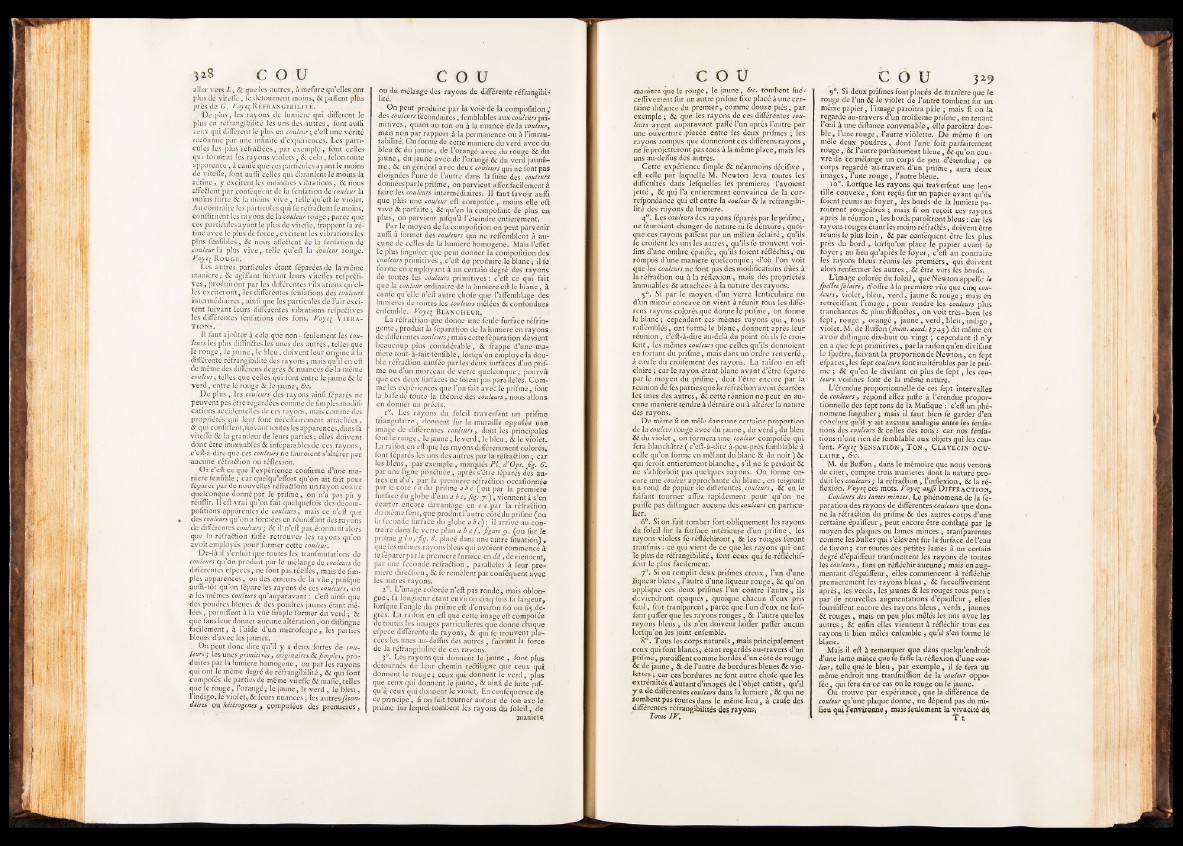
aller vers Z , 8c que les autres, à mefure qu’elles ont
plus de vîteffe, le détournent moins, &paffent plùs
près de G. Voye^ Réfrangibilité.
De plus, les rayons de lumière qui different le
plus en réfrangibilité lçs uns des autres , font auffi
ceux qui different le plus en couleur ; c’eft une vérité
reconnue par une infinité d’expériences. Les particules
les plus réfractées, par exemple , font celles
qui forment les rayons violets, & cela, félon toute
apparence, à caufe que ces particules ayant le moins
de vîteffe, font auffi celles qui ébranlent le moins la
rctine, y excitent les moindres vibrations, 8c nous
affeftent par conféquent de la fenfation de couleur la
moins forte 8c la moins v iv e , telle qu’eft le violet.
Au contraire les particules qui fe réfraétent le moins,
conftituent les rayons de la couleur rouge ; parce que
Ces particules ayant le plus de vîteffe, frappent la rétine
avec le plus de force, excitent les vibrations les
plus fenfibles, & nous affeCtent de la fenfation de
couleur la plus viv e, telle qu’eft la couleur rouge.
Voye^ Rouge.
Les autres particules étant féparées de la même
maniéré, & agiffant fuivant leurs vîteffes refpeéti-
ves, produiront par les différentes vibrations qu’elT
les exciteront, les différentes fenfations des couleurs
intermédiaires, ainfi que les particules de l’air excitent
fuivant leurs différentes vibrations refpeâives
les différentes fenfations des fons. Voye{ Vibrations.'
'
Il faut ajouter à cela que non - feulement les couleurs
les plus diftinCtes les unes des autres, telles qu.e
le rouge, le jaune, le bleu, doivent leur origine à la
différente réfrangibilité des rayons ; mais qu’il en eft
de même des différens degrés & nuances de la même
couleur, telles que celles qui font entre le jaune 8c le
verd, entre le rouge & le jaune, &c.
De plus , les couleurs des rayons ainfi féparés ne
peuvent pas être regardées comme de fimples modifications
accidentelles de ces rayons, mais comme des
propriétés qui leur font néceffairement attachées,
& qui confiftent,fui vant toutes les apparences,dans la
vîteffe & la grandeur de leurs parties; elles doivent
donc être immuables & inféparables de ces rayons,
c’eft-à-dire que ces couleurs ne fauroient s’altérer par
aucune réfra&ion ou réflexion.
Or c’ eft ce que l’expérience confirme d’une maniéré
fenfible ; car qiielqu’effort qu’on ait fait pour
féparer par de nouvelles réfra&ions un rayon coloré
quelconque donné par le prifme, on n’a pas pu y
réuffir. Il eft vrai qu’on fait quelquefois des décom-
pofitions apparentes de couleurs, mais ce n’eft que
des couleurs qu’on a formées en réunifiant des rayons
de différentes couleurs ; 8c il n’eft pas étonnant alors
que la réfraftion faffe retrouver les rayons qu’on
avoit employés pour former cette couleur.
De-là il s’enfuit que toutes les tranfmutations de
couleurs qu’on produit par le mélange de couleurs de
différentes efpeces, ne font pas réelles, mais de fim-
ples apparences, ou des erreurs de la vue, puifque
auffi-tôr qu’on fépare les rayons de ces couleurs, on
a les mêmes couleurs qu’auparavant : c’eft ainfi que
des poudres bleues & des poudres jaunes étant mêlées
, paroiffent à la vue fimple former \du verd ; &
que fans leur donner aucune altération ,'on diftingue
facilement, à l’aide d’un microfcope, les parties
bleues d’avec les jaunes.
On peut donc dire qu’il y a deux fortes de couleurs;
les unes primitives, originaires 8c Jimples, pro- '
duites par la lumière homogène, ou par les rayons
qui ont le même degré de réfrangibilité, 8c qui font
compofés de parties de même vîteffe 8c maffe, telles
que je rouge, l’orangé, le jaune, le verd , le bleu ,
l’indigo, le violet, & leurs nuances ; les autres fecon-
flaires ou hétérogènes , çompofées des premières,
ou du mélange des rayons de différente réfrartgibi-î
lité.
On peut produire par la voie de là compofition ,'
des couleurs fecqndaires, femblables aux couleurs primitives
, quant au ton ou à là nuance de la couleur,
mais.non par rapport à la permanence ou à l’immutabilité.
On forme de cette maniéré du verd avec du
bleu 8c du jaune, dé l’orangé avec du rouge 8c du
jaune, du jaune avec de l’orangé 8c du verd jaunâtre
; 8c en general avec deux couleurs qui ne font pas
éloignées l’une de l’autre dans la fuite des couleurs
données parle prifme, On parvient affez facilement à
faire les couleurs intermédiaires. Il faut favoir auffi
que plus une couleur eft compofée, moins elle eft
vive & parfaite ; & qu’en la compofant de plus en
plus, on parvient jufqu’à l’éteindre entièrement.
Par le moyen delà compofition on peut parvenir
auffi à former des couleurs qui ne reflemblent à aucune
de celles de la lumière homogène. Mais l’effet
le plus fingulier que peut donner la compofition des
couleurs primitives, c’eft de produire le blanc ; il fe
forme en employant à un certain degré des rayons
de toutes les couleurs primitives : c’eft ce qui fait
que la couleur ordinaire de la lumière eft le blanc, à caufe qu’elle n’eft autre chofe que Paffemblage des
lumières de toutes les couleurs mêlées & confondues
enfemble. Voye^ Blancheur.
La réfraftion que donne une feule furface réfringente
, produit la féparation de la lumière en rayons
de differentes couleurs; mais cette féparation devient
beaucoup plus çonfidérable, & frappe d’une maniéré
tout-à-fait fenfible, lorsqu’on employé la double
réfra&ion caufée par les deux fiirfaces d’un prif*
me ou d’un morceau de verre quelconque, pourvû
que ces deux furfaces ne foient pas parallèles. Comme
les expériences que l’on fait avec le prifme, font
la bafede toute la théorie des couleurs, nous allons
en donner un précis.
i° . Les rayons du foleil traverfant un prifme
triangulaire, donnent fur la muraille oppofée une
image de différentes couleurs, dont les principales
font le rouge, le jaune, le verd, le bleu, & le violet.
La raifon en eft que les. rayons différemment colorés,'
font féparés les uns des autres par la réfra&ion ; car
les bleus, par exemple , marqués/’/. d'Opt.fig. G.
par une ligne ponduée, après s’être féparés des autres
en d d , par la première réfraûion occafionnée
par lé cote c a du prifme a b c ( ou par la première
furface du globe d’eau abc, jig. y.)., viennent à s’en
écarter encore davantage en e e par la réfraftion
du même fens, que produit l’autre côté du prifme (ou
la fécondé furface du globe a b c) : il arrive au contraire
dans le verre plan a b c f , figure $. (ou fur le
prifme g l o,fig. 8. placé dans une autre fituation) ,
que les memes rayons bleus qui a voient commencé à
fe féparer par la première furface en dd, deviennent,
par une fécondé réfrafrion, parallèles à leur première
direction, & fe remêlent par conféquent avec
les autres rayons.
2°. L’image colorée n’eft pas ronde, mais oblon-
gue, fa longueur étant environ cinq fois fa largeur,
lorfque l’angle du prifme eft d’environ 6o ou 65 degrés.
La raifon en eft que cette image eft compofée
de toutes les images particulières que donne chaque
elpece différente de rayons, & qui fe trouvent placées
les unes au-deffus des autres , fuivant la force
de la réfrangibilité de ces rayons. ...
30. Les rayons qui donnent le jaune , font plus
détournés de leur chemin reéliligne que ceux quî
donnent le rouge ; ceux qui donnent le verd, plus
que ceux qui donnent le jaune, & ainfi de fuite jufqu’à
ceux qui donnent le violet. En conféquence de
ce principe, fi on fait tourner autour de Ion axe le
priime fur lequel tombent les rayons du foleil, de
maniéré.
maniéré que lé rouge, le jaune, &c. tombent filé-
ceffivement fur un autre prifme fixe placé à une certaine
diftance du premier, comme douze piés, par
exemple ; 8c que les rayons de ces différentes couleurs
ayent auparavànt pàffé l’un après l’autre par
une ouverture placée entre les deux prifmes ; les
rayons rompus que donneront ces différens rayons,
ne fe projetteront pas tous à la même place, mais les
uns au-deflus des autres.
Cette expérience fimple & néanmoins décifive ,
eft. celle par laquelle M. Newton leva toutes les
difficultés dans lefquelles les premières l’avoient
jetté , & qui l’a entièrement convaincu de la epr-
refpondance qui eft entre la couleur & la réfrangibilité
des rayons de lumière.
40. Les couleurs des rayons féparés par le prifme,
ne fàuroient changer dé nature ni fe détruire, quoique
ces rayons paffent par un milieu éclairé, qu’ils
fe croilent les uns les autres, qu’ils fe trouvent voi-
lins d’une ombre épaiffe, qu’ils foient réfléchis, ou
rompus d’une maniéré quelconque ; d’oîi l’on voit
que les couleurs ne font pas des modifications dues à
la réfra&ion ou à la réflexion •, mais des propriétés
immuables 8c attachées à la nature des rayons.
50. Si par le moyen d’un verre lenticulaire ou
d’un miroir concave on vient à réunir tous les différens
rayons colorés que donne le prifme, on forme
le blanc ; cependant ces mêmes rayons q u i, tous
raflèmblés, ont formé le blanc, donnent après leur
réunion, c’eft-à-dire au-delà du point où ils fe croi-
fent, les mêmes couleurs que celles qu’ils donnoient
en fortant du prifme, mais dans un ordre renverfé,
à caufe du croifement des rayons. La raifon en eft
claire ; car le rayon étant blanc avant d’être féparé
par le moyen du prifme, doit l’être encore par la
réunion de fes parties que la réfraftion avoit écartées
les unes des autres, 8c cette réunion ne peut en aucune
maniéré tendre à détruire ou à altérer la nature
des rayons.
De même fi on mêle dans une certaine proportion
de la couleur rouge avec du jaune, du verd, du bieu
oc du v iolet, on formera une couleur compofée qui
fera blanchâtre ( c ’eft-à-dire à-peu-près femblable à
celle qu’on forme en mêlant du blanc & du noir ) 8c
qui feroit entièrement blanche , s’il ne fe perdoit 8c
ne s’abforboit pas quelques rayons. On forme encore
une couleur approchante du blanc, en teignant
un rond de papier de différentes couleurs, 8c en .le
faifant tourner affez rapidement pour qu’on ne
puiffe pas diftinguer aucune des couleurs en particulier.
6°. Si on fait tomber fort obliquement les rayons
du foleil fur la furface intérieure d’un prifme , les
rayons violets fe réfléchiront, & les rouges feront
tranfmis : ce qui vient de ce que les rayons qui ont
le plus de réfrangibilité, font ceux qui fe réfléchif-
fent lé plus facilement.
70. Si on remplit deux prifmes Creux, l’un d’une
liqueur bleue, l’autre d’une liqueur rouge, 8c qu’on
applique ces deux prifmes l’un contre l’autre, ils
deviendront opaques, quoique chacun d’eux pris
feu l, foit tranlparent, parce que l’un d’eux ne laif-
fant paffer que les rayons rouges, & l’aiitre que les
rayons bleus, ils n’en doivent laiffer paffer aucun
lorfqu’on les joint enfemble.
8°. Tous les corps naturels, mais principalement
ceux qui font blancs, étant regardés au^travers d’un
prifme, paroiffent comme bordés d’un côté de rouge
©c de jaune, & de l’autre de bordures bleues & violettes
; car ces bordures ne font autre chofe que les
extrémités d’autant d’images de l’objet entier, qu?il
y a de différentes couleurs dans la lumière, 8c qui ne
tombent pas toutes dans le même lieu , à caufe des
différentes refrangibilités des rayons.
Tome IV.
90. Si déux prifmes font placés de ftiani'ere que le
rouge de l’un & le violet de l’autre tombent mr un
même papier, l’image paroîtra pâle ; mais.fi on la
regarde au-travers d’un troifieme prifme, en tenant
l’oeil à une diftance convenable, elle paroîtra double
, l’une rouge, l’autre violette. D e même fi on
mele deux poudres, dont l’une foit parfaitement
rouge, & l’autre parfaitement bleue qu’on cou,
vre de ce mélange un corps de peu d’étendue, ce
corps regardé au-travers d’un prifme, aura deux
images, l’une rouge, l’autre bleue.
io°. Lorfque les rayons qui traversent une lenà
tille convexe, font reçus fur un papier avant qu’ils
foient réunis au foyer , les bords de la lumière pa-
roîtront rougeâtres ; mais fi on réçoit ces rayons
après la réunion, les bords paroîtront bleus : car les
rayons rouges étant les moins réfraftés, doivent être
réunis le plus loin, 8c par conféquent être les plus
près du bord-, lorfqu’on place le papier ayant le
foyer; au lieu qu’après ie loyer, c’eft au contraire
les rayons bleus réunis les premiers, qui,doivent
alors renfermer lès autres, 8c être vers les bords.
L’image colorée du foleil, que Newton appelle l*
fpeclre folaire , n’offre à la première vûe que cinq couleurs
, violet, bleu ; verd, jaune & rouge ; mais en
retréciffant l’image, pour rendre les couleurs plus
tranchantes 8c plus diftinâes, oh voit très-bien les
fept, rouge , orangé , jaune, verd, bleu, indigo,
violet. M. de Buffon (mem. acad. 2743) dit même en
avoir diftingué dix-huit ou vingt ; cependant il n’y
en a que fept primitives, par la raifon qu’en divifant
le fpeftre, fuivant la proportion de Newton, en fept
efpaces, les fept couleurs font inaltérables par le prifme
; 8c qu’eri je divifant en plus de fep t, les ce«--
leurs voifines font de la même nature. .
L’étendue proportionnelle de ces fept intervalles
de couleurs , répond affez jufte à l’étendue propos
tionnelle des fept tons de la Muîique : c’eft un phénomène
fingulier ; mais il faut bien fe garder d’en
conclure qii’il y ait aucune analogie entré les fenfations
des couleurs & celles des tons : car nos fenfations
n’ont rien de femblable aux objets qui les cau-
fent. Voye^ Sensation, T on , Clavecin ocu-*
LAI RE , &C.
M. de Buffon, dans le mémoire que nous venons
de citer, compte trois maniérés dont la nature produit
les couleurs ; là réfrattion, l’inflexion, 8c la réflexion.
Voye^ces mots. Voye{ ««^Diffraction*
Couleurs des lames minces. Le phénomène de la féparation
des rayons de différentes couleurs que donne
la féfraéiion du prifme & des autres corps d’une
certaine épailfeur, peut encore être cohftaté par le
moyen des plaques ou lames minces, tranfparentes
comme les bulles qui s’élèvent fur là furface de l’eau
de favon; car-toutes t e s peiités lames à un certain
degré d’épaiffeur tranfmettent les rayons de toutes
les couleurs , fans en réfléchir aucune ; mais en augmentant
d’épaiffeur, elles commencent à réfléchir
premièrement les rayons bleus , 8c fucceffivement
après, les verds, les jaunes & les rouges tous purs’:
par de nouvelles augmentations d’épaiffeur , elles
iourniffent encore des rayons bleus, verds, jaunes
8c rouges, mais un peu plus mêlés les uns avec les
autres ; 8c enfin elles viennent à réfléchir tous ces
rayons fi bien mêlés enfemble , qu’il s’en forme les
blanc.
Mais il eft à remarquer que dans quelqu’endroif
d’une lame mince que fe fafle la réflexion d’une coupleuri
telle que le bleu, par exemple, il fe fera atx
même endroit unë tranfmiffion de la couleur oppofée
, qui fera èn ce cas ou le rouge ou lè jaune.
On trouve par expérience, que la différence de
couleur qu’une plaque donne, ne dépend pas du milieu
qffi l’environne, mais feulement la vivacité do,