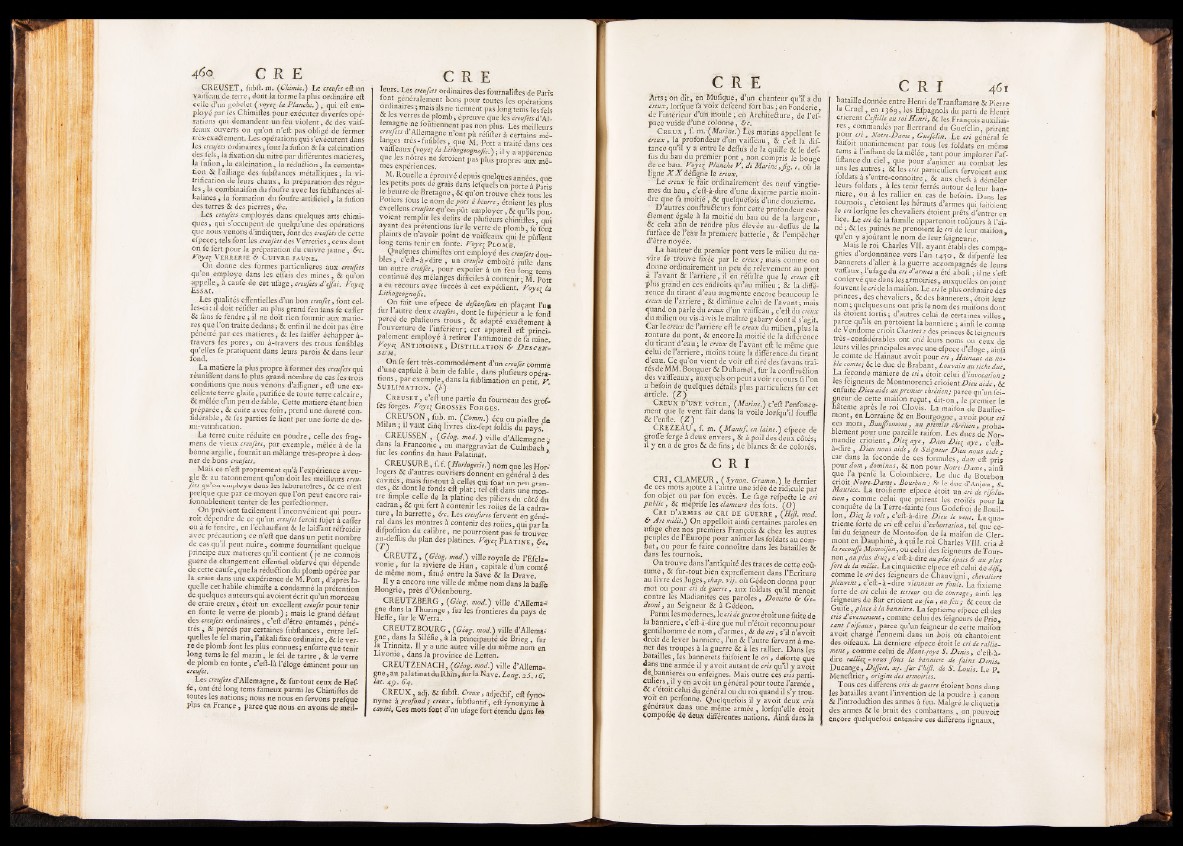
CREUSET, fubft. m. (Chimie.') Le creufet eft un
yaifleau de terre, dont la tonne la plus ordinaire eft
celle d’un gobelet (voyez La Planche. ) , qui eft employé
par lés Chimiftes pour exécuter diverfes opérations
qui demandent un feu violent, & des vaif-
feîiux ouverts ou qu’on n ’eft pas obligé de fermer
très-exa&ement. Les opérations qui s’exécutent dans
les creujets ordinaires, font la fufion & la calcination
des fels, la fixation du nitre par différentes matières,
la fufion, la calcination, la réduâion, la cementation
& l’alliage des fubftances métalliques, la v itrification
de leurs chaux , la préparation des régules
, la com'binaifon du fouïfe avec les fubftances al-
kalines , la formation du foufre artificiel, la fufion
des. terres & des pierres, 6yc.
Les creufets employés dans quelques arts chimiques
, qui s’occupent de quelqu’une des opérations
que nous venons d’indiquer, font des creufets àt cette
efpece; tels font les creufets des Verreries., ceux dont
on fe fert pour la préparation du cuivre jaune, &c.
Voye^ V e r r e r i e & C u i v r e j a u n e .
Qn donne des formes particulières aux creufets
qu on employé dans les effais des mines, & qu’on
appelle, à caufe de cet ufage, creufets d’cjfai. Foyer
E s s a i .
Les qualités effentielles d’un bon creufet, font celles
ci : il doit refifter au plus grand feu fans fe caffer
& fans fe fendre ; il ne doit rien fournir aux matières
que 1 on traite dedans ; & enfin il ne doit pas être
pénétré par ces matières, & les laiffer échapper à-
travers fes pores, ou à-travers des trous fenfibles
qu’elles fe pratiquent dans leurs parois & dans leur
fond.
ï La matière la plus propre à former des creufets qui
réunifient dans le plus grand nombre de cas les'trois
conditions que nous venons d’afligner, eft une excellente
terre glaife, purifiée de toute terre calcaire,
& mêlée d’un peu de fable. Cette matière étant bien
préparée, & cuite avec foin, prend une dureté con- i
fidérable, & fes parties fe lient par une forte de demi
vitrification.
La terre cuite réduite en poudre, celle des frag-
mens de vieux creufets, par exemple, mêlée à de la
bonne argille, fournit un mélange très-propre à donner
de bons creufets.
Mais ce n’eft proprement qu’à l’expérience aveugle
& au tâtonnement qu’on doit les meilleurs creufets
qu’on employé dans les laboratoires, 8c ce n’eft
prefque que par ce moyen que l’on peut encore rai-
fonnablement tenter de les perfeâionner.
On prévient facilement l ’inconvénient qui pourvoit
dépendre de ce qu’un creufet feroit fujet à caffer
ou à fe fendre, en réchauffant & le laiffant réfroidir
avec précaution ; ce n’eft que dans un petit nombre
de cas qu’il peut nuire , comme fourniffant quelque
principe aux matières qu’il contient ( je ne connois
guere de changement effentiel obfervé qui dépende
de cette caufe, que la réduction du plomb opérée par
la craie dans une expérience de M. Pott, d’après laquelle
cet habile chimifte a condamné la prétention
de.quelques auteurs qui avoient écrit qu’un morceau
de craie creux, étoit un excellent creufet pour tenir
en fonte le verre de plomb) ; mais le grand défaut
des creufets ordinaires, c’eft d’être entamés, pénétrés
, & percés par certaines fubftances, entre lef-
quelles le fel marin, l’alkali fixe ordinaire, & le verre
de plomb font les plus connues; enforfe que tenir
long tems le fel marin, le fel de tartre, & le verre
de plomb en fonte, c’eft-là l’éloge éminent pour un
creufet. r
Les creufets d’Allemagne, & fur-tout ceux de Hef-
fe , ont été long tems fameux parmi les Chimiftes de
toutes les nations ; nous ne nous en fervons prefque
pUis en France, parce que nous en ayons de meilleurs.
Les crtufets ordinaires des fournaliiles de Paris
lont généralement bons pour toutes les opérations
ordinaires ; mais ils ne tiennent pas long tenis les fels
, les verres de plomb, épreuve que lés mufiis d’Al-
iemagne ne îoûtiennent -pas non plus. Les meilleurs
mujetré Allemagne n’ont pû réfifter A certains mélanges
tres-fufibles, que M. Pott a traité dans ces
VHffeMxÇvoy^liaogiogHoj!'.); g g j a apparence
que les nôtres ne ferment pas plus propres aux mê-
nies expériences.
M. Rouelle a éprouvé depuis quelques années, que
les petits pots de grais dans lefquels on porte à Paris
le beurre de Bretagne-, & qu’on trouve chez tous les
Potiers fous le nom de/wo à ban c, étoient les plus
exçMlélis creufets qtt’oh pût employer, Sc qu’ils pou-
voiern remplir lés defîrs de plufieurs cliilïtiïles, qui
ayant des prétentions fur le Verre de ploitib , fe font
plaints de n’avoir point dé vaiffeaux qui le pûffenr
long tems tenir en fonte. Foyez P l o m b .
Quelques chimiftes ont employé des enufets doubles,
c’elt-à/dire , un crèufei emboîté jnfte dans
Un autre mûfet, pour expofer à un feu long tems
continué des mélanges difficiles à contenir; M. Pott
a eu retours avec fuccès A cet expédient. Voyer la
Litkogeognojie. x
On fait une efpece de defiinfum eh plaçant l’u ,
lui-1 autre deux creufets, dont le fupérièur a le fond
percé de plufieurs « b u s , & adapté exàftement à 1 ouverture de l’inférieur ; cet ap’pàréil eft princi-
paiement employé à retirer l’antimoine de fa raine
royc{ A n t im o i n e , D i s t i l l a t i o n & D esc ex-
S U M .
On fe fert très-commodément d’un creufet comme
d une capfule à bain de fable, dans plufieurs opérations
, par exemple, dans la fublimation en petit. F
S u b l im a t i o n , (b)
C r e u s e t , c’eft une partie du fourneau des greffes
forges. Foye{ G r o s s e s F o r g e s .
m* (Comm.) écu ou piaftre de
Müan ; il vaut cinq livres dix-fept foldis du pays".
CREUSSEN , (pèog. mod. ) ville d’Allemagne ;>
dans la Francome , au marggraviat de Culmbach .
iur les confins du haut Palatinat.
CREUSURE, f. f. (Horlogerie.) nom que les Horlogers
8c d autres ouvriers donnent en general à des
cavités, mais fur-tout à celles qui font un peu grandes,
& dont le fonds eft plat; tel eft dans une montre
fimple celle de la platine des piliers du côté du
cadran, & qui fert à contenir les roiies de la cadra-
ture, la barrette, &c. Lés creufures fervent en général
dans les montres à contenir des roues, qui par la
difpofition du calibre, ne pourraient pas fe trouver
( T ) C^~US P^an Patines. Feyez Pla t in e , &c+
CR EUT Z, (Géog. mod.) ville royale de l’Efcla-
vome, fur la riviere de Hun, capitale d’un comté
de même nom , fitué entre la Save & la D rave.
Il y a encore une ville de même nom dans la baffe
Hongrie, près d’Odenbourg.
CREUTZBERG, (Géog. mod.) ville d’Allema-3
gne dans la Thuringe, fur les frontières du pays de
Heffe, ftir le Verra.
CKEUTZBOURG, (Géog. mod.) ville d’Allemagne
, dans la Silefie, à la principauté de Brieg , fur
la Trinnitz. Il y a une autre ville du même nom en
Livonie, dans la province dé Letten.
CREUTZENACH, (Géog. mod.) ville «3’AIlema-i
gne, au palatinat du Rhin, fur là Nave. Long. 23. i G,
lat. 4£). 64.
CREUX, adj. & fubft. Creux, adjectif, eft fyno'
nyme à profond; creux, fubftantif, eft fynonyine à
cavitéf Ces mots font d’un ufage fort étendu dans Ieô
Arts; on dit, en Mtifîtfue, d’un chanteur qu’il a du
creux, lorfquë fa Voix dëfcehd fort ‘bas ; en Fonderie
de l’intérieur d’un ttîôule ; en Archite&ure, de l’ef-
pace vuide d’ufie côlônne, :&c. '
C r e u x ; f. m. f Marine.) te s marins appellent le
creux, la profondeur d’un vaiffëau, & c’eft la distance
qu’il y a eritFe'te’deflÜs’âe‘'îâ qûxlle & le def-
fus du bau du prefiiièr pont, höh compris le bouge
de ce bâu. F ô f ei Flanche F . de Marine 3fig. p i i la
ligne X AT.defighe lê creux. *
• Le ànuïc fe fàit Ordihairémenf'dés neuf vingtièmes
du b,au, c’eft-à-dire d’une dixiéme partie moin-
dre que fa ftioitié, & quelquefois d’uné douzième.
D ’aiitres conftrüôèurs font cétté profondeur exactement
egale à la moitie.dü bau ou de la largeur,
& cela afih de réndre plus élevée âu-deffus de la
furface de 1 êàU la première baftérié, 8c l’empêcher
d’être rtôyéé. '
La hauteur du premier pont vers le milieu du navire
fë trouvé fixée par le 'creux; mais comme on
donne ordinairemëfit un peti de rélevement au pont
à l’avant & rarriêre , il eh reïiilfo que le creux eft
piiïs grand èh ce's endroits, qu’au milieu ; & la diéé-
rence du tirant d’eau augmente encore beaucoup lé
Cféuic dé l’arrierë, & diminue celui de l’avant ; mais
quand on parle 8\\ creux d’un vaiffeaü, c’eft du creux
du milieu ou vis-à-vis le maître gàbary dont il s’agit.
C'âr le créùx dè'l’ârriére eft le creux du milieu, plus la
tonture du pont, & encore, la moitié cle la différence :
du tirant d’eau ; le creux de i’àvant eft lé même que
celui de l’àrrierë, riioms toute la différence-du tirant
d’eau. Ce qu’on vient de voir eft tiré dés favàris trai-
rés de MM. Bougucr & Duhahnël, ;fuY la conftruaion
dés Vaiffeaux, auxquels on peut avoir recours fi l’on
a bdoin de quelques détails plus particuliers fur cet
article. ( Z )
CRËt7X d ’u n e v o i l e , (Marine?) c’eft l’enfonce-
ment que le vent fait dans la voile lorfqu’il fouffle
8c l’enfle. (Z )
. CREZEAU., f. m. (Manuf, eh laine.) efpece dè
greffe ferge à deux envers, & à poil des deux côtés;
il y en a dè gros 8c de fins ; de blancs & de colorés.
C R I
C R I , CLAMEUR, ( Synon. Gramm?) le dernier
de cés mots ajoute à l’autre une idée de ridicule par
fon objet ou par fon excès. Le fage refpe&e le cri
public y 8c méprife les clameurs des fots. (O)
C r ï d ’ a r m é s o à CR I d e g u e r r e , (Hiß. mod.
& Art milit.) On appelloit ainfi certaines paroles en
ufage chez nos premiers François & chez les autres
peuplés dé l’Europé pour animer.les foldats au combat,
pu pour fe faire connoltre dans les batailles &
danis les tournois.
On trouve dans l’antiquité des traces de cette coutume
, & fur-tout bien expreffement dans l’Ecriture
au livre deS Juges, chap. vij. oùGédeon donna pour
mot Ou pour cri de guerre, aux foldats qu’il menoit
contre lés Màdianites ces paroles, Domino & Ge-
deoni, au Seigneur & à Gedeon.
Parmi les modernes, le cri de guerre étoitune fuite de
la bârinîëré, C ëft-à-dire que nul n’étoit reconnu pour
gentilhomme de nom, d’armes, & de cri, s’il n’avoit
droit de lever bannière, l’un & l’autre fervant à mener
dès troupes à la guerre & à les rallier. Dans les
batailles, les bannerets faifoient le cri, defortè, que
dans une armée il y avoit autant de cris qu’il y avoit
dévbannieres ou enfeignes. Mais outre ces cris particuliers,
il y en avoit un général pour toute l’armée,
8c c etoit celui du général ou du roi quand il s’y trou-
Voit én perfonne. Quelquefois il y avoit deux cris
generaux dans une même armée, lorfqu’elle étoit
tompofée de deux différentes nations. Ainfi dans la
j Vataille clonn^e.entre Henri de Tranftamare & Pierre
la Cruel, en 13 69, les Efpagnols du parti de Henri
cnerentÇajlilU auraiHtnri, & les.François auxiliaires
, commandés par Bertrand dit Guciclin, prirent
pour f r f , Notnt-Dami, Gmfclin. Le cri général fe
tailoit unanimement par tous les foldats en même
i tems à 1 inftant de. la mêlée, tant pour implorer i ’af-
lutance du ciel, que pour s’animer au combat lep
uns les autres ; & les cris particuliers fervoient aux
.foldats .à. s entre-connoître,, & aux chefs à démêler
leurs foldats,; Aies tenir ferrés autour de leur bannière,
ott Aies rallier eii cas de befoin. Dans les
tournois, c’êtôient l'es hérauts d’armes qui/aifoient
le cri lorfque les chevaliers étoient prêts d’entrer en
lice. Le frf de la famille appartenoiî toiiiours A l’aî-
n s; & les puînés ne prenoient le a i de leur maifon
qu’en y ajoutant le nom de leur feioneurie.
Mais le roi Charles Vil. ayant.êtabli des compagnies.
d’ordonnance.vers l’an 1450, & difpenfé les
bannerets d’Æêr A la guerre accompagnés de leurs
vanaux, l ’ufage du cri d’armes a été aiioii * il ne s’eft
Confervé que dans lès armoiries, auxquelles on joint
fouvent le cri de là mailon. Le crfjeplus ordinaire des
'princes, des chevaliers, &des banneretsétoit leur
nom, quelques uns ont pris le nom des mations dont
ils etoient lortis; d’autres celui de certaines villes-,
parce qu ils en povtoient la bannière ; ainfi le comte
de Vendôme crioit Chartres : des princes 8c ièigneurs
très-cqnfidérables ont crié leurs noms ou ceux de
leurs villes principales avec une efpece d’éloge, ainft
le comte de Hainaut avoit pour cri, Hainaut au noble
comte; 8c le duc de Brabant, Louvain au riche duc.
La fécondé maniéré de cri, étoit celui d’invocation^
les feigneurs de Montmorenci crioient Dieu aide y &
énfuite Dieu aide au premier chrétien; parce qu’un fei-
gneùr de cette maifon reçut, dit-on , le premier le
bâteme après le roi Clovis. La maifon de Bauffre-
mont, en Lorraine 8c en Bourgogne, avoit pour cri
ces mots , Bauffremonty au premier chrétien, probablement
pour une pareille raifon. Les ducs de Normandie
crioient, D'H ayef Dam D ie fa y t, c’eft-
a-dire , Dieu nous aide, le Seigneur Dieu nous aide ;
car dans la fécondé de ces formules, dam eft pris
pour dom, dômihusy 8c non pour Notre-Dame, ainfi
que l’a'penfé la Colombiere. Le duc de Bourbofi
crioit Notre-Dame, Bourbon; & le duc d’Anjou 61,
Maurice. La troifieme efpece étoit un cri de réfolu1 tion, comme celui que prirent les croifés pour la
conquête de la Terre-fainte fous Godefroi de Bouillon,
Die{levolty c’eft-à-dire Dieu Le veut. La quatrième
forte de cri eft celui à?exhortation, tel que celui
du feigneur de Montoifon de la maifon de Clermont
en Dauphiné, à qui le roi Charles VIII. cria à
la recoujfe Montoifon, ou celui des feigneurs de Tour-
non , au plus dru{, c ’eft-à-dire au plus épais & au plus
fort de la mêlée. La cinquième efpece eft celui de défi,
comme le cri des feigneurs de Châuvigni, chevaliers
pleuveht, c’eft-à-dire viennent eh foule. La fixieme
forte de cri celui de terreur ou de courage, ainfi les
feigneurs de Bar crioient au feu, au feu; 8c ceux de
Guife, place à La bannière. La feptiertie efpece eft des
cris d'événement, comme celui des feigneurs de Prie,
cant Voifeaux, parce qu’un feigneur de cette maifon
avoit chargé l’ennemi dans un bois où chantoient
des oifeaux. La derniere efpece étoit le cri de ralliement
, comme celui de Mont-joye S. Denis, c’eft-à-
dire ralliez-vous fous la bannière de faint Denis.
Ducange, Differt. xj. fur l'hifi. de S. Louis. Le P.
Merieftrier, origine des armoiries.
Tous ces différens cris de guerre étoient bons dans
les batailles avant l’invention de la poudre à canon
& l’ifitroduâion des armes à feu. Malgré le cliquetis
des armes & le bruit des combattans , on pouvoit
encore quelquefois entendre ces différens fignaux.