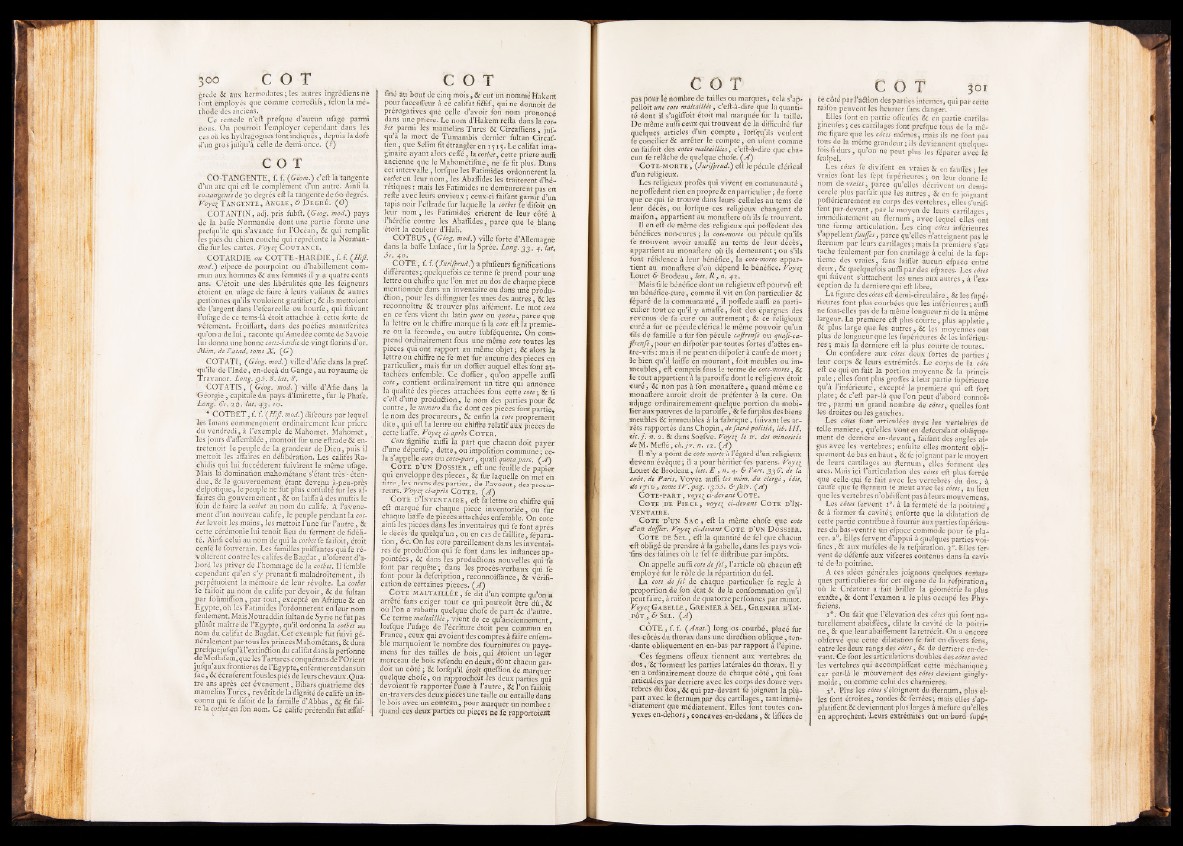
$00 C O T èrede & aux liermodates ; les autres ingrëdîens né
ibnt employés que comme corrtélifs, félon la méthode
des anciens.
Ce remede n’eft prefque d’aucun ufage parmi
nous. On poùrroit l’employer cependant dans les
cas oh les hy cïragogUe's font indiqués, depuis la dofé
d’un gros jufqu’à celle de demi-once. {b)
C O T
ÇO-ÏANGÊNTE, ƒ. CÇSïïmï.) c’eïl là tangente
d’un arc qui eft le complément d’un autre. Ainfi là
co-tangehte de 30 degrés eft la tangente de 60 degrés.
F o y e { TÀNGENTE, ANGLE , & DEGRE. (O)
COTANTIN, adj. pris fubft. (Gtog. mod.) pays
de la baffe Normandie dont une .partiè forme une
prefqu’île qui s’avance fur l’Océan , 6c qui remplit
les pies du chien couché qui repréfente la Normandie
fur les cartes. Foye^ Coutance.
COTARDIE ou COTTE-HARDIE, f. f. {Hijl.
mod.) efpece de pourpoint ou d’habillement commun
aux hommes 6c aux femmes il y a quatre cents
ans. C ’étoit une des libéralités que les feigneurs
étoient en ufage de faire -à leurs vaffaux 6c autres
perlonnes qu’ils vouloient gratifier ; 6c ils mettoient
de l’atgent dans l’efcarcelle ou bourfe, qui fuivant
l ’ufage de ce tems-là étoit attachée à cette forte de
vêtement. Froiffart, dans des poéfies manufcrites
•qu’on a de lui, raconte qu’Amedée comte de Savoie
lui donna une bonne cotte-hardie de vingt florins d’or.
dMém. de l ’acad. tome X . (G)
CO TA TI, {Géog. mod.) ville d’Afie dans la pref-
•'qu’île de l’Inde, en-deçà du Gange, au royaume de
Travanor. Long. gS. 8. Lat. 8.
COTA TIS, ( Géog. mod.) ville d’Afie dans la
‘Géorgie, capitale du pays d’Imirette, fur le Phafe.
Long. S i. 20. but. 43;. -10.
* CO TB ET, f. î.J(Hijl, mod.) difcours par lequel
les îmans commençoient ordinairement leur priere
du vendredi, à l’exemple de Mahomet. Mahomet,
les jours d’affembléè, montôit für une eftrade 6c en-
tretenoit le peuple de la grandeur de Dieu, puis il
mettoit les affaires en délibération. Les califes Ra-
chidis qui lui fiiccéderent fui virent le même ufage.
"Mais la domination mahométane s’étant très - étendue,
"& le gouvernement étant devenu à-peu-près
défpotique ,-le peuple ne fut plus confulté fur les affaires
du gouvernement, & on laiffa à'des muftis le
Toin défaire la cotbet au‘nom du calife. A l’avene-
ment d’un nouveau calife, le peuple pendant la cotbet
levoit les-mains, les mettoit l ’une fur l’autre, &
'cette cérémonie lui tenoit lieu du ferment de fidélité.
Ainfi celui au nom de qui la cotbet'fe'fai foit, étoit
cenfé le fouverain. Les familles puiffantes qui fe'révoltèrent
contre les califes de Bagdat, n’oferent d’abord
les priver de l’hommage de la cotbet. Il femble
cependant qii’en s’y prenant fi maladroitement, ils
.perpétuoient la mémoire de leur révolte. La cotbet
'le faifoit au nom du calife par devoir, & du fultan
par foûmiflion, par-tout, excepté en Afrique & en j
Egypte, o'u lesFatimid'es l’ordonnèrent en leur nom
feulement. MaisNouraddin fultan de Syrie né fut .pas ;
plutôt maître de l’Egypte, qu’il ordonna la cotbet au !
nom du califat de Bagdat. Cet exemple fut fuivi gé- !
néralement par tous les princes Mâhométans, & dura
prefque jufqu’à l’extin&ion du califat dans la perfonne
deMofiafem, quelesTartares conquérans de'l’Orient |
jufqu’aux frontières de l’Egypte, enfermèrent dans un i
la c ,6c ecraferent fous les pies de leurs chevaux. Quatre
ans aptes cet événement, Bibars quatrième des
anamelins Turcs, revêtit de là dignité de calife un inconnu
qui fe difoit de la famille d’Abbas, & fit faire
la cotbet-en fon nom. Ce calife prétendu fut affaf- .
C O T ! fine au bout de cinq mois, & eut Un nommé Hakerrf
pour fucceffeur à ce califat fiftif, qui ne donnoit de
prérogatives que celle d’avoir fon nom prononcé
dans une priere. Le nom d’Hakem refta dans la cot-
bet parmi les mamelins Turcs & Circafliens, jufqu’à
la mort de Tumambis dernier fultan Circaf-
fien, que Selim fit étrangler en 1515. Le califat imaginaire
ayant alors ceffé, la cotbet, cette priere aufli
ancienne que le Mahométifme, né fe fit plus. Dans
cet intervalle , lorfque les Fatimides ordonnèrent la
‘cotbet en leur nom, les Abaflîdes les traitèrent d’hé-
retiqués : mais les Fatimides ne demeurèrent pas en
refte avec leurs envieux ; ceux-ci faifant garnir d’un
tapis noir l’eftrade fur laquelle la cotbet le difoit en
leur nom, les Fatimides crièrent de leur côté à
d’héréfie contre les Abaflîdes, parce que le blanc
étoit la couleur d’Hali.
COTEDS, {Géog. mod.) ville forte d’Allemagne
dans la baffe Luface, fur la Sprée. Long. 33. 4. lat4 5i. 40.
C O T E , f. f. {Junfprud.) a plufieurs fignifications
différentes ; quelquefois ce terme fe prend pour une
lettre ou chiffre que l’on met au dos de chaque piecé
mentionnée dams un inventaire ou dans urte ptodu-
•ftion, pour les diftinguer les Unes des autres, 6c les
reconnoître 6c trouver plus aiîément. Le mot cote
en ce fens vient du latin quot OU quota, parce que
la lettre ott le chiffre marque fi la cote eft la première
ou la fécondé, ou autre fu'bféquente. On comprend
ordinairement fous une même cote toutes les
pièces qui ont rapport au même objet ; 6c alors la
lettre ou chiffre ne fe met fur aucune des pièces en
particulier , mais fur un doffier auquel elles font attachées
enfemble. ‘Ce doffier, qu’on appelle aufli
cote, contient Ordinairement un titre qui annonce
la qualité des pièces attachées fous cette cote ; & fi
c’en d’une produôion, le nom des parties pour 6c
contre, le numéro du fac dont ces pièces font partie,
:le nom des procureurs, 6c enfin la cote proprement
dite, qui eft la lettre ou chiffre relatif aux pièces de
cette liaffe. Foye^ ci après C OTER.
Cote ‘fignifie aufli la .part que Chacun doit payer
d’une dépenfe, dette, ou impofttion commune ; cela
s’appelle y0« cm cote-part, quafi quota,pars. {A )
Cote d'un Dossier, eft une feuille de papier
qui enveloppe despieces, 6c fur laquelle on met en
titre, les noms des parties, de l'avocat, des procureurs.
Yoye^ cUaptls COTER. {A)
C ote D’Inventaire^ eft la lettre ou chiffre qui
eft marque.fur chaque piece inventoriée, ou fur
chaque liaffe de pièces attachées enfemble. On cote
ainfi les pièces dans les inventaires qui fe font après
le décès de quelqu’un, ou en cas de faillite, fépara-
tion, &c.‘On les cote pareillement dans les inventaires
de produftion qui fe font dans les inftances appointées
, 6c dans les produirions nouvelles 'qui fe
font par requête ; dans les procès-verbaux qui fe
font pour la defeription, reconnoiffance, & vérification
de certaines pièces. {A)
Cote malt aillé E ,fe dit d’un compte qu’orna
arrête fans exiger tout ce qui pouvait être dû , Sc Ou 1 on a rabattu quelque Chofe de part & d’autre.
Ce terme nutltaïllee, vient de ce qu’anciennement,
lorfque l’ufage de l ’écriture é'toit peu commun en
France, ceux qui avoient des comptes à faire enfemble
marquoient le nombre des fournitures ou paye-
mens fur des tailles de bois, qui étoient un léger
morceau de bois refendu en deux, dont chacun gar-
doit un côté ; 6c lorfqu’il étoit queftion de marquer
quelque chofe, on rapprochait les deux parties qui
dévoient fe rapporter l’une à l’autre ,& l’on faifoit
en-travers des deux pièces une taille ou entaille dans
le bois avec un couteau., pour marquer un nombre :
quand ces deux parties on pièces ne fe rapportoient
C O T
pas pour ïé nombre dé tailles ou marques, Cela s*ap-
pelloit une cote màltaillée, c’eft-à-dire que la quantité
dont il s’agiffoit étoit mal marquée für la taille.
De même aum ceux qui trouvent de la difficulté fur
quelques articles d’un. compte , lorfqu’ils veulent
le concilier 6c arrêter le compte, en ufent comme
on faifoit des côtes maltaillées, c’eft-à-dire que cha-*-
cun fe relâche de quelque chofe. {A)
Cote-morte , {Jurifprud.) eft le pécule clérical
d’un religieux.
Les religieux profès qui vivënt en communauté j
ne poffedent rien en propre & en particulier ; de forte
que ce qui fe trouve dans leurs cellules au tems de
leur décès, ou lorfque ces religieux changent de
maifon, appartient au monaftere Oh ils fe trouvent.
Il en eft de même des religieux qui poffedent des
bénéfices non-cures ; la cote-morte ou pécule qu’ils
fe trouvent avoir amaffé au tems de leur décès-,
appartient au monaftere oh ils demeurent ; ou s’ils
font réfidence à leur bénéfice, la cote-morte appartient
au monaftere d’oh dépend le bénéfice. Foye^
Louet & Brodeau, lett. R ,n . 42.
Mais fi le bénéfice dont un religieux eft pourvu eft
lin bénéfice-cure, comme il vit en fon particulier 6c
féparé de la communauté, il poffede aufli en particulier
tout ce qu’il y amaffe, foit des épargnes des
revenus de fa cure ou autrement; & ce religieux
curé a fur ce pécule clérical le même pouvoir qu’un
fils de famille a furfon pécule cafirenfe ou quafî-ca-
‘flrenfe, pour en difpofer par toutes fortes d’a&es entre
vifs: mais il ne peut en difpofer à caufe de mort;
ïe bien qu’il laiffe en mourant, foit meubles ou immeubles
, eft compris fous le terme de cote-morte, 6c
le tout appartient à la paroiffe dont le religieux étoit
curé, iSc -non pas à fon monaftere, quand même ce
monaftere auroit droit de préfenter à la cure. On
adjuge ordmairemement quelque portion du mobilier
aux pauvres de la paroiftè, & le furplus des 'biens
meubles 6c immeubles à la fabrique, fuivant les arrêts
rapportés dans Chopin yde facrâpolitiâ, lib. III.
tit. j . n. 2. & dans Sôefve. Voyeç le tr. des minorités
deM. Méfié, ch.jv. n. 1%. {A)
’Il ri’y a-pornt de cote-morte à l ’égard d’un religieux
xlevenn évêque.; îl a pour héritier fies p.arens. Foye^
liOtiet & 'Brodeau, lett. E , n. 4. & l ’art. 33CT. de la
coïct. de Paris. Voyez aufli les mém. dii Clergé, édit,
■ de ryi'Sj tome IF . pag. 1^66. &fuiv. {A)
'Gote-PART , voyei ci-devant Cote.
C ote de Piece, voye^ d-devant C ote D’Inventaire.
•Cote d’-un Sac , eft la mênte chofe que cote
<d’un doffier. Foyeç ci-devant C ote d’un DOSSIER.
-Cote de Sel , eft la quantité de fdl que chacun
«ft obligé de prendre à la gabelle, dans lés pays voi-
■ fins des falines oh le fel fe diftribue ;par impôts.
On appelle aufli cote de fe l} l’article oh chacun eft
employé fur le rôle delà répartition du fel.
, L a cote de fe l .de .chaque particulier fe réglé à
^proportion de fon état.& de là confomm.ation qu’il
peut faire, à raifon de quatorze perfonnes par minot.
FoyeiGabelle, Grenier.à Sel, Grenier d’IM- .
t ô t j & Sel. fA)
C O T E , f. f. {Anat.) long os courbé, placé fur
fles ■ GÔtésidu1 thorax dans une direfrion oblique, ten-
•ilante obliquement-en-en-bas par rapport à l’épine*
’Ces fegmens Offeux tiennent aux vertèbres du
do s , '& ‘forment les parties latérales du thorax. Il y
'en a ordinairement douze de chaque côté, qui font
articulées par derrière avec. les coçps des douze vertèbres
du dos qui par-devant fe joignent la plftpart
avec, le fternum par des cartilages., tant immé-
^diatemént que médiatement. Elles font toutes convexes
en-dehors, concaves -en-dedans, & liffées de
C O T $ 0 1
ëé côte parl’aâion des parties internes, qui par cetto
raifon peuvent les heurter fans danger-;
| Elles font eh partie oflèufes 6c en partie cartilà-
gineufes ; ces cartilages font prefque tous de la même
figure que les côtés mêmes ? mais ils ne font pas
tous de la même grandeur ; ils deviennent quelquefois
fi durs, qu’on ne peut plus les féparer avec le
fe-alpel.
Les côtes fe diVifent en vraies & en faillies ; les
Vraies font les fept fupérieures ; on leur donne lé
nom de vraies, parce qu’elles décrivent un demn
cerclé plus parfait que les autres , & en fe joignant
poftérieurement au corps des vertèbres, elles s’unif-
fent jpar- devant, par le moyen de leurs cartilages,
immédiatement aii fternum, avec lequel elles ont
une ferme articulation. Les cinq côtes inférieures
S’appellent fauffes y parce qu’elles n’atteignent pas lè
fternum par leurs cartilages ; mais la première s’at-f
tache feulement par fon cartilage à celui de la fep-
tieme des vraies, fans laiffer aucun efpaee entré
deux, 6c quelquefois auflî par des efpacés. Les côtei
qui fuivent s'attachent les Unes aux autres, à l’ex-
ceptiori de la derniere qui eft libre;
La figure des côtes eft demi-circulaire, 6c les ftipé-
rieures font plus courbées que les inférieures ; auflî
ne font-elles pas de la même longueur ni de la même
largeur. La première eft plus courte, plus applatie,
& plus large que les autres, & les moyennes ont
plus de longueur que les fupérieures 6c les inférieures
; mais la derniere eft la plus courte de toutes.
On confidere aux cotes deux fortes de parties *
leur corps & leurs extrémités. Le corps de la côté
eft ce qui en fait la portion moyenne & la principale
; elles font plus greffes à leur partie fupérieuré
qu’à l’inférieure, excepté la première qui eft fort
plate; & c’eft par-là que l’on peut d’abord Connoî-
-tre, parmi un grand hombre de cotes, quelles font
les droites ou lès gauches*
Les côtes font articulées avec les -vertébrés dé
toile maniéré, qu’elles vont en defeendant obliquement
de derrière en-devant, faifant des angles aigus
avec les vertèbres ; enfuite elles montent obliquement
de bas en haut, 6c fe joignant par le moyeri
de leurs cartilages au fternum, elles forment des
arc-s* Mais ici 1 articulation des cotés eft plus ferrée
que eelle-qlfi fe fait avec les vertébrés du dos, 4
caufe que ‘le fternum fe Meut avec les côtes-, au fieil
■ que les vertèbres ri’ebéiffent pas à leùrs moiivemens*
Les côtes fervent i°. à la fermeté de la poitrine,
& à former fa cavité ; enforte que la dilatation de
cette partie contribue à fournir aux parties fiipérieu-
res -dù bas-ventre un efpaee commode pour fe placer*
i° . Elles fervent d-appui à quelques parties voisines
, & aux mufeles de la refpiratiOn* .3 °. -Elles fervent
de défenfe aux vifeeres contenus dans la eavi«
-té de la poitrine.
. A ces jdées générales joignons quelques remarques
particulières fur cet organe de 'la refpiration ,
~oh le Créateur a fait briller la géométrie la plus
exaéte, & dont f examen a le plus occupé les Phy-
ficieiis.
,1°* Gn fait que l’éleyatiori des côtes qui font naturellement
abaiffées, dilate la cavité de la poitrine,
& que leur.abaiffement la rétrécit; On a encore
\obfervë que cette dilatation fe-fait en divers fens,
entre Ses delix rangs des côtes, & de derrière en-devant.
Ce font les articulations doubles des côtes avec
les vertèbres qui accOmpliffent cette niéchaniquej
car par-là lé mouvement des côtes devient gingly-
mQÏde, ou comme celui des charnières*
,2°. Plus les côtes s’éloignent du-fternùm, plus elles
font étroites, tondes & ferrées ; mais elles s’ap-
platiffent.& deviennent plus larges àmefiire qu’elles
en approchent*'Leurs extrémités ont un bord fupé«