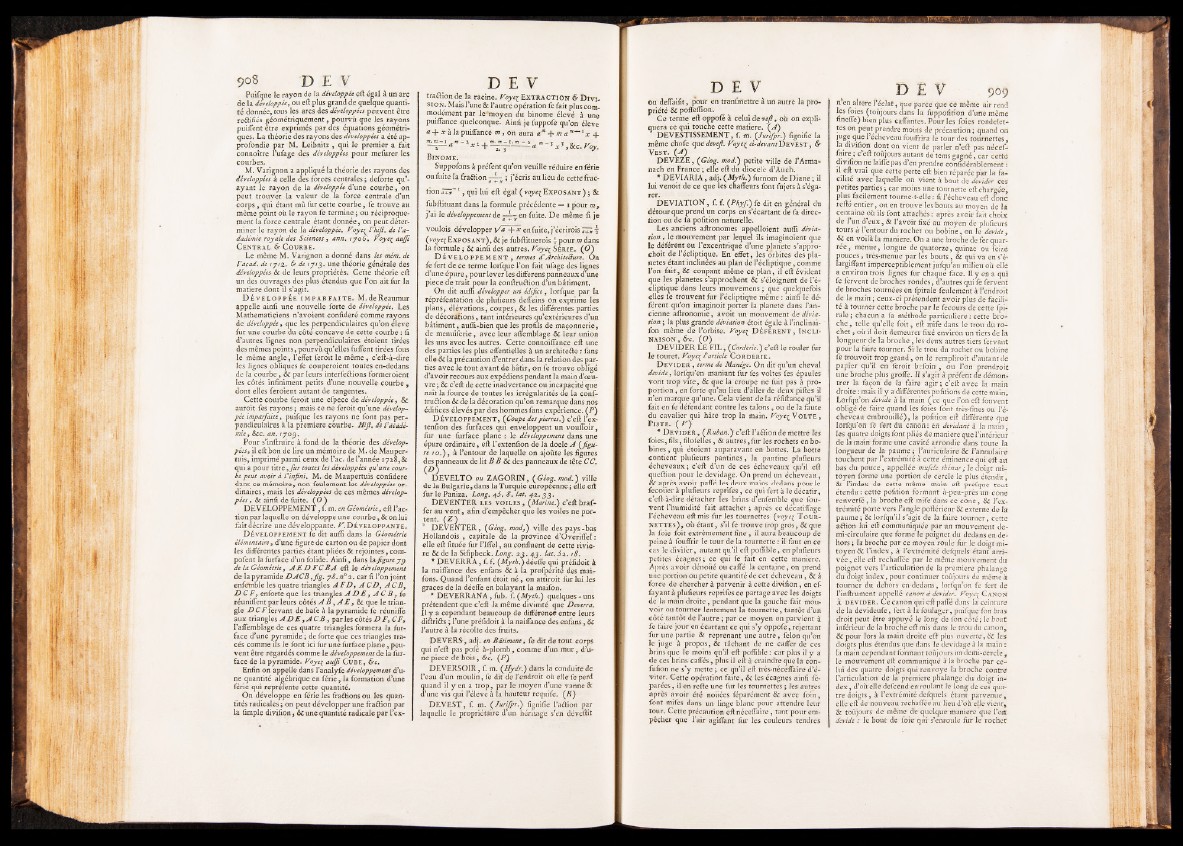
Puifque le rayon de la développée eft égal à un arc
de la développéey ou eft plus grand de quelque quantité
donnée, tous les arcs des développées peuvent être
reûifiés géométriquement, pourvu que les rayons
puiffent être exprimés par des équations géométriques.
La théorie des rayons des développées a été approfondie
par M. Leibnitz , qui le premier a fait
connoître l’ufage des développées pour mefurer les
courbes.
M. Varignon a appliqué la théorie des rayons des
développées à celle des forces centrales ; deforte qu’ayant
le rayon de la développée d’une courbe, on
peut trouver la valeur de la force centrale d’un
corps, qui étant mû fur cette courbe, fe trouve au
même point où le rayon fe termine ; ou réciproquement
la force centrale étant donnée, on peut déterminer
le rayon de là développée. Foye£ l'hiß. de l'a-
dadémie royale des Sciences , ann. 170 G. Foye^ aujji
C entral & C ourbe.
Le même M. Varignon a donné dans les mèm. de
l'acad. de 171z. & de 1713. une théorie générale des
développées & de leurs propriétés. Cette théorie eft
un des ouvrages des plus étendus que l’on ait fur la
matière dont il s’agit.
D é v e l o p p é e im p a r f a i t e . M.deReaumur
appelle ainli une nouvelle forte de développée. Les
Mathématiciens n’avoient confideré comme rayons
de développée , que les perpendiculaires qu’on eleve
fur une courbe du côté concave de cette courbe : fi
d’autres lignes non perpendiculaires étoient tirées
des mêmes points, pourvû qu’elles fùffent tirées fous
le même angle, l’effet feroit le même , c’eft-à-dire
les lignes obliques fe couperoient toutes en-dedans
de la courbe, & par leurs interférions formeroient
les côtés infiniment petits d’une nouvelle courbe,
dont elles feroient autant de tangentes.
Cette courbe feroit une efpece de développée, 8c
auroit fes rayons ; mais ce ne feroit qu’une développée
imparfaite, puifque les rayons ne font pas perpendiculaires
à la première courbe. Hiß. de Vacadémie
, &c. an. 170$).
Pour s’inftruire à fond de la théorie des développéess
il eft bon de lire un mémoire de M. de Mauper-
tuis, imprimé parmi ceux de l’ac. de l’année 1728,0c
qui a pour titre y fur toutes les développées qu'une courbe
peut avoir à L'infini. M. de Maupertuis confidere
dans ce mémoire, non-feulement les développées ordinaires
, mais les développées de ces mêmes développées
, & ainfi de fuite. (O )
DEVELOPPEMENT, L m .en Géométrie, eft l’action
par laquelle on développe une courbe, & on lui
fait décrire une développante. ^ .D éveloppante.
D éveloppement fe dit aufli dans la Géométrie
élémentaire, d’une figure de carton ou de papier dont
les différentes parties étant pliées & rejointes, com-
pofent la furface d’un folide. Ainfi, dans lafigure 79
delà Géométrie9 A E D F C B A eft le développement
de la pyramide DA CB ,fig. 78. n° z . car fi l’on joint
enfemble les quatre triangles A F D , A CD f A C B y
D C F , enforte que les triangles A D E ,A C B , f e
réunifient par leurs côtés A B ,A E , 8c que le triangle
D C F fervant de bafe à la pyramide fe réunifie
aux triangles A D E ,A C B , par les côtés D F, CF,
l’affemblage de ces quatre triangles formera la fur-
face d’une pyramide ; de forte que ces triangles tracés
comme ils le font ici fur une furface plane, peuvent
être regardés comme le développement de la fur-
face de la pyramide. Foye^ außi C ube, &c.
Enfin on appelle dans l’analyfe développement d’une
quantité algébrique en férié, la formation d’une
férié qui reprélente cette quantité.
On développe en férié les fractions ou les quantités
radicales ; on peut développer une fradion par
la fimple divifion, 6c une quantité radicale par l’extra&
ionde la racine. Foycç Ex t r a c t io n & D ivis
io n. Mais l’une & l’autre opération fe fait plus commodément
par le*moyen du binôme élevé à une
puiffance quelconque. Ainfi je fuppofe qu’on éleve
a + x à la puiffance m, On aura am + rnam~~Ix .p
-— a 2x 1 -f- ■ -■ ^ —-a m x * ,8tc. Foy,
Binomé.
Suppofons à préfent qu’on veuille réduire en férié
ou fuite la fradion — - ; j’écris au lieu de cette fraction
777T 1 , qui lui eft égal ( voye^ Exposant ) ; &
fubftituant dans la formule précédente — 1 pour m ,
j ai le développement de — en fuite. De même fi je
voulois développer F a + * en fuite, j’écrirois a
(yoye^ Exposant) , & je fubftituerois £ pour m dans
la formule ; 8c ainfi des autres. Foyei Série. (O ) DEVELOPPEMENT , termes d'Architecture. Oïl
fe fert de ce terme lorfque l’on fait ufage des lignes
d’une epure, pour lever les differens panneaux d’une
piece de trait pour la conftrudiort d’un bâtiment.
On dit aufli développer tiri édifice, lorfque par la
répréfentation de plufieurs deffeins on exprime les
plans, élévations, coupes, 8c les différentes parties
de décorâïions, tant intérieures qu’extérieures d’un
bâtiment, aufli-bien que les profils de maçonnerie,
de menuiferie, avec leur affemblage 8c leur union
les uns avec les autres. Cette connoiffance eft une
des parties les plus effëntielles à un architede ; fans
elle & la précaution d’entrer dans la relation des parties
avec le tout avant de bâtir, on fe trouve obligé
d’avoir recours aux expédiens pendant la main d’oeuvre
; 8c c’eft de cette inadvertance ou incapacité que
naît la fource de toutes les irrégularités de la conf-
tru&ion 8c de la décoration qu’on remarque dans nos
édifices élevés par des hommes fans expérience. (P)
D éveloppement, (Coupe des pierres.') c’eft l’ex-
tenfion des furfaces qui enveloppent un vouffoir,
fur une furface plane : le développement dans une
épure ordinaire, eft l’extenfion de la doele A (figure
10.), à l’entour de laquelle on ajoute les figures
des panneaux de lit B B 8c des panneaux de tête C C. I l ■ H H DEVELTO ou ZAGORIN, (Giog. moi.) ville
de la Bulgarie, dans la Turquie européenne ; elle eft
fur le Paniza. Long. 46. 8. lat. 4 2 .33.
DEVENTER LES v o il e s , (Marine.) c’eftbraf-
fer au vent, afin d’empêcher que les voiles ne portent.
( Z )
|j DE VENTER, (Géog. mod, ) ville des pays - bas
Hollandois , capitale de la province d’Overiffel:
elle eft fituée fur l’Iffel, au confluent de cette rivière
& d e la Sifipbeck. Long. 23. 43. Ut, 5%. 18.
* D EVERRA, f. f. (Mythf) déeffe qui préfidoit à
la naiffance des enfans & à la profpérité des mai-
fons. Quand l’enfant étoit n é , on attiroit fur lui les
grâces de la déeffe en balayant la maifon,
* DEVERRANA , fub. f. (Myth.) quelques - uns
prétendent que c’eft la même divinité que Deverra.
Il y a cependant beaucoup de différence entre leurs
diftrifts ; l’une préfidoit à la naiffance des enfans, 8c
l’autre à la récolte des fruits.
DEVERS, adj. en Bâtiment, fe dit de tout corps
qui n’eft pas pofé à-plomb, comme d’un mur, d’une
piece de bois, &c. (P)
DEVERSOIR, f. m. (Hydr.) dans la Conduite de
l’eau d’un moulin, fe dit de l'endroit où elle fe perd
quand il y en a trop, par le moyen d’une vanne &
d’une vis qui l’éleve à la hauteur requife. (K)
DEVEST, f. m. (Jurifpr.) fignifîe Paétion par
laquelle le propriétaire d’un héritage s’en déveftit
ou deffaifit, pour en tranfmettre à üiï autre la propriété
8c poffeflionv
Ce terme eft oppofé à celui de vejl, où on eXpli*
quera ce qui touche cette matière. (A )
INVESTISSEMENT, f. m. (Jurifpr.) fignifîe la
même chofe que devefi. Foye{ ci-devant D e v e s t , &
V e s t . (A)
DEVEZE, (Géog. mod.) petite ville de l’Arma*
nach en France ; elle eft du dioeefè d’Aueh-.
* DEVIARIA, adj. (Myth.) furnom de Diane ; il
lui venoit de ce que les chafietirs font fiijets à s’égarer
.D
EVIATION, f. f. (Phyf.) fe dit en général du
détour que prend un corps en s’écartant de fa direction
ou de la pofition naturelle.
Les anciens aftronomes appelloient aufli déviation,
le mouvement par lequel ils imaginoient- que
le déférent ou l’excentrique d’une planete s’appro-
choit de l’écliptique. En effet, les orbites des planètes
étant inclinées au plan de l’écliptique, comme
l’on fait, 8c coupant même ce plan, il eft évident
que les planètes s’approchent 8c s’éloignent de l’écliptique
dans leurs mouvemens ; que quelquefois
elles fe trouvent fur l’écliptique même : ainfi le déférent
qu’on imaginoit porter la planetë dans l’ancienne
aftronomie, avoit un mouvement de déviation
; la plus grande déviation étoit égalé à l’inclinai-
fon même de l’orbite. Foye^ D é f è r e n t , I n c l i n
a i s o n , &c. (O)
DEVIDER LE FIL, (Gorderie.) c ’ e ft le r o u le r fur
l e to u r e t . Voye^ Varticle C o r d e r i e .
D e v i d e R , terme de Manège. On dit qu’un cheval
dévidé, lorfqu’en maniant- fur fes voltes fes épaules
Vont trop v ite, 8c que la croupe né fuit pas à proportion
, en forte qu’au lieu d’aller de dëux piftes il
n’en marque qu’une. Gela vient de la réfiftance qu’il
fait en fe défendant contre les talons, ou de la faute
du cavalier qui hâte trop la main. Foyer V û L îE ,
P i s t e . ( F )
* D e v i d e r , (Ruban.) e’eft l’a&ion de mettre les
foies, fils, filofelles, & autres, fur les rochets en bobines
,- qui étoient auparavant en bottés. La botte
contient; plufieurs pântines, la pantine plufieurs
écheveaux; c’eft d’un de ces écheveaux qu’il eft
queftion pour le devidage. On prend un écheveau,
& après avoir paffé les deux mains dedans pour le
fecoiier à plufieurs reprifes, ce qui fert à le décatir ,
c’eft-à-dire détacher les brins d’enfemble que fou-
vent l’humidité fait attacher ; après ce décatfiffage
l’écheveau eft mis fur les tournettes (voye{ T o u r -
NETTês) , où étant, s’il fe trouve trop gros, 8c que
la foie foit extrêmement fine , il aura beaucoup de
peine à fouffrir le tour de la tournette : il faut en ce
cas le divifer, autant qu’il eft poflible, en-plufieurs
petites écagnes; ce qui fe fait en cette maniéré.
A près avoir dénoiié ou caffé la centaine, on prend
une portion ou petite quantité de cet écheveau, 8c à
force de chercher à parvenir à cette divifion, en ef-
fayant à plufieurs reprifes ce partage avec les doigts
de la main droite, pendant que la gauche fait mouvoir
ou tourner lentement la tournette, tantôt d’un
côté tantôt de l’autre ; par ce moyen on parvient à
fe faire jour en écartant ce qui s’y oppofe, rejettant
fur une partie & reprenant une autre, félon qu’on
le juge à propos, & tâchant de ne caffer de ces
brins que le moins qu’il eft poflible : car plus il y a
de ces brins caffés, plus il eft à craindre que la con-
fufion ne s’y mette ; ce qu’il eft très-nécefiaire d’éviter.
Cette opération faire, 8c les écagnes ainfi fé-
parées, il en refte une fur les tournettes ; les antres
après avoir été nouées féparément 8c avec foin,
font mifes dans un linge blanc pour attendre leur
tour. Cette précaution eft néceffaire, tant pour empêcher
que l’air agiffant fur les couleurs tendres
n en aîterel’éclat, que parée que tè même air rend
les foies (toûjours dans la fuppofition d’une même
fîneffe) bien plus caffantes. Pour les foies rondelettes
on peut prendre moins de précaution ; quand on
juge que l’echeveau fouffrira le tour des tournettes,
la divifion dont on vient de parler n’eft pas nécef-
y V9J c toujours autant de tems gagné, car cette
dtvifion ne laiffe pas d’en prendre confidérablement :
il eft vrai que cette perte eft bien réparée par la facilité
avec laquelle on vient à bout de dévider ces
petites parties ; car moins une tournette eft chargée,
plus facilement tourne-t-elle: fi l’écheveau eft donc
refié entier, on en trouve les bouts au moyen de la
centaine où ils font attachés : après avoir fait choix
de 1 Un d’eux, & l’avoir fixé au moyen dè plufieurs
tours à l’entour du roehet Ou bobine, on le dévidé ,
8c en voilà la maniéré. On a une broche de fer quar-
rée, menue, longue de quatorze, quinze ou feizé
pouces, très-menue par les bouts, & qui va en s’é-
largiffant imperceptiblement jufqu’au milieu où elle
a environ trois lignes fur chaque face. Il y en a qui
fe fervent de broches rondes, d’autres qui fe fervent
de broches tournées en fpirale feulement à l’endroit
de la main ; ceux-ci prétendent avoir plus de facilité
à tourner cette broche par le fecours de cette fpirale
; chacun a fa méthode particulière : cette broche
, telle qu’elle foit, eft mile dans le trou du ro-
chet, où il doit demeurer fixé environ un tiers de la
longueur de la broche, lès deux autres tiers fervant
pour la faite tourner. Si- le trou du roehet ou bobiné
fe trouvoit trop grand, on lè rempliroit d’autant de
papier qu’il en feroit befoin-, ou l’on prendfoit
une broche plus groffe. Il s’agit à préfent d‘e démon*
trer la façon’ de la faire agir ; c’eft avec la main
droite : mais il y a différentes pofitions de cette main.
Lorfqu’on dévidé à la main ( c e que l’on eft fou vent
obligé de faire quand les foies font très-fines ou l’é»
cheveau embrouillé), la pofition eft différente que
lorfqn’on fe fert du canon: en dévidant à l'a main,
les quatre doigts font pliés de maniéré que l’intérieur
de la main- forme une cavité arrondie d'ans toute la
longueur de fa paume ; l’auricirlâire & l ’annulaire
touchent par l’extrémité à cette éminence qui eft au
bas du pouce, appellée mufde thénar ; le doigt mitoyen
forme une portion1 de cercle le plus étendit,
& l’index de cette même main eft prefque tout
étendu-: cette pofition formant à-peu-près un cône
reriverfé, la broche eft mife’ dans ce cône, 8c l’ extrémité
porte vers l’angle poftérieur 8c externe de la
paume; 8c lorfqu’il s ’agit de la faire tourner, cette
attion lui eft communiquée par un mouvement demi
circulaire que forme le poignet du dedans en-dehors
; la broche par ce moyen roule fur le doigt mitoyen
8c l’index, à- l’extrémité defquels- étant arrivée
, elle eft rechaffée par le même mouvement du
poignet vers l’articulation de là première phalange
du doigt index, pour continuer toûjours de même à
tourner du dehors en-dedans, lorfqu’on fe fert de
l’inftrument appellé canon à devider. Foyev C anon
À devider. Ce canon qui eft paffé dans la1 ceinmre
de la devidëufe, fert à la foulager, puifque fon bras
droit peut être appuyé le long de fon côté ; le bout
inférieur de la broche eft mis dans lè trou du canon,
8c pour lors la main droite eft plus ouverte, 8c lès
doigts plus étendus que dans le devidage à la main :
là- main cependant formant toûjours undemi-cercle,
le mouvement eft communiqué à la broche par celui
des quatre doigts qui renvoyé la broche contre
l’articulation de la première phalange du doigt index
, d’où elle defeend en roulant le long de ces quatre
doigts, à l’extrémité defquels étant parvenue,
elle-eft de'nouveau rechaftée au lieu d’où elle vient,
& toûjours de- même dè quelque maniéré que l’on
dévidé ; le bout de foie qui- s’enroule fiir le' roehet