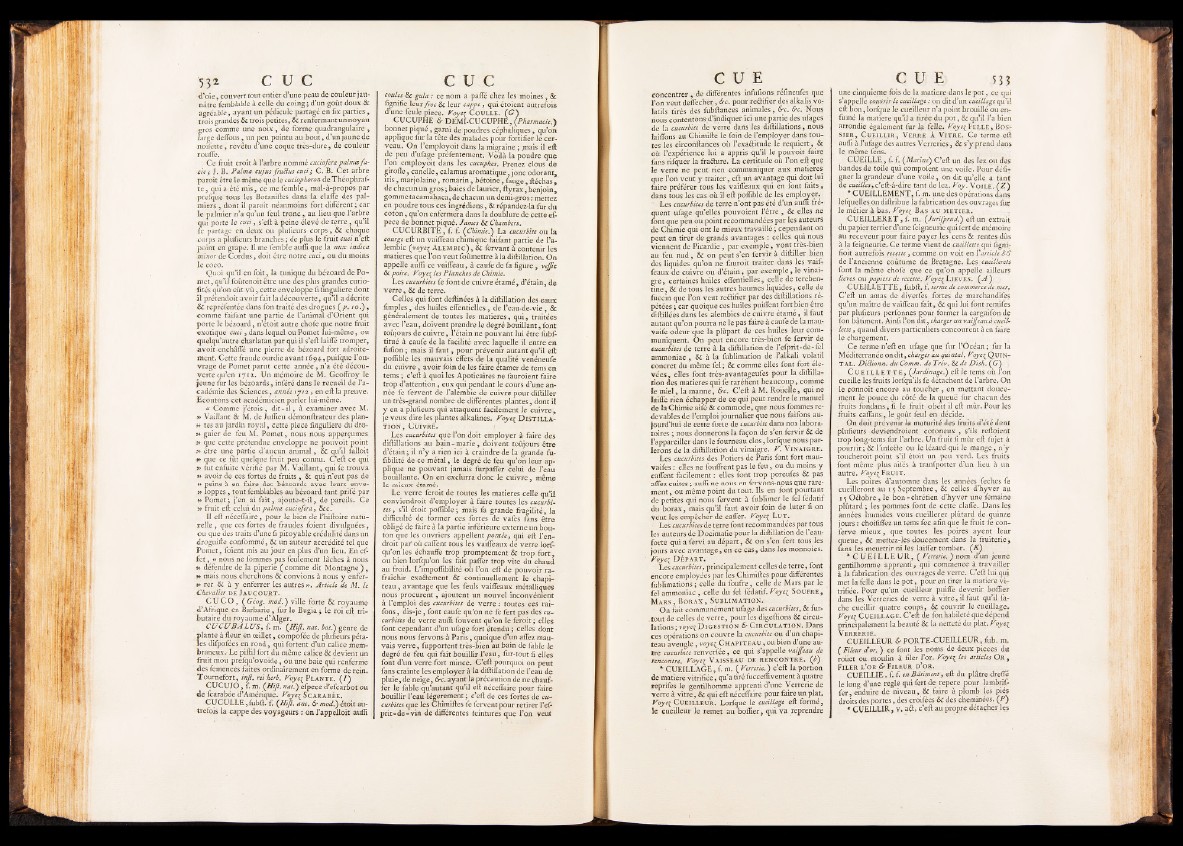
d’oie, couvert tout entier d’une peau de couleur jaunâtre
femblable à celle du coing ; d’un goût doux &
agréable, ayant un pédicule partagé en fix parties,
trois grandes & trois petites, &c renfermant un noyau
gros comme une noix, de forme quadrangulaire ,
large deffous, un peu pointu au bout, d’un jaune de
noiiètte, revêtu d’une coque très-dure, de couleur
roufle.
Ce fruit croît à l’arbre nommé cuciofera palmoe fade
i J. B. Palma, cujus fruclus cud; C. B. Cet arbre
paroît être lemême que le cuciophoron de Theophraf-
t e , qui a été mis,, ce me femble, mal-à-propos par
prefque tous les Botaniftes dans la dalle des palmiers
, dont il paroît néanmoins fort différent ; car
le palmier n’a qu’un feul tronc, au lieu que l’arbre
qui porte le cud , .sîeft à peine élevé de terre , qu’il
fe partage en deux ou plufieurs corps, & chaque
corps a plufieurs branches ; de plus le fruit cuci n’eft
point en grape. Il me femble aulîi que la nux indica
minor de Cordus, doit être notre cuci, ou du moins
le coco.
Quoi qu’il en foit, la tunique du bézoard de Pomet,
qu’il foûtenoit être une des plus grandes curio-
fités qu’on eût v û , cette enveloppe fi finguliere dont
il prétendoit avoir fait la-découverte, qu’il a décrite
& repréfentée dans fon traité des drogues ( p. /o.),
comme faifant une partie de l’animal d’Orient qui
porte le bézoard, n’étoit autre chofe que notre fruit
exotique cuci, dans lequel ou Pomet lui-même, ou
quelqu’autre charlatan par qui il s’eft lailfé tromper,
avoit ençhâlfé une pierre de bézoard fort adroitement.
Cette fraude ourdie avant 1694, puifque l’ouvrage
de Pomet parut cette année, n’a été découverte
qu’en 171a. Un mémoire de M. Geoffroy le
jeune lur les bézoards, inféré dans le recueil de l’académie
des Sciences, année iy iz , en eft la preuve.
Ecoutons cet académicien parler lui-même.
« Comme j?étois, d i t - il, à examiner avec M.
» Vaillant & M. de Juflieu démonftrateur des plan-
» tes au jardin royal, cette piece finguliere du dro-
» guier de feu M. Pomet, nous nous apperçumes
» que cette prétendue enveloppe ne pouvoit point
» etre une partie d’aucun animal, & qu’il falloit
» que ce fût quelque fruit peu connu. C’eft ce qui
>> fut enfuite vérifié par M. Vaillant, qui fe trouva
» avoir de ces fortes de fruits , & qui n’eut pas de
»» peine à en faire des bézoards avec leurs enve-
» loppes, tout femblables au bézoard tant prifé par
» Pomet ; j’en ai fa it, ajoute-t-il, de pareils. Ce
» fruit eft celui du palma cuciofera, &c.
Il ell néceffaire, pour le bien de l’hiftoire naturelle
, que ces fortes de fraudes foient divulguées ,
ou que des traits d’une fi pitoyable crédulité dans un
droguifte confommé, & un auteur accrédité tel que
Pomet, foient mis au jour en plus d’un lieu. En e ffet
, « nous ne fommes pas feulement lâches à nous
9> défendre de la piperie ( comme dit Montagne ) ,
Vf mais nous cherchons & convions à nous y enfer-
►> rer & à y enferrer les autres ». Article de M. le
Chevalier d e JAUCOURT .
C U C O , ( Géog. mûd. ) ville forte & royaume
d’Afrique en Barbarie, fur le Bugia ; le roi eft tributaire
du Royaume d’Alger.
CU CU B A LUS, f. m. {Hiß. nat. bot.) genre de
plante à fleur en oeillet, compofée de plufieurs pétales
difpofées en rond, qui fortent d’un calice membraneux.
Le piftil fort du même calice & devient un
fruit mou préfqu’ovoïde, ou une baie qui renferme
des femences faites ordinairement en forme de rein.
Tournefort, infi. reiherb. Voyt{ P l a n t e . ( / )
CUCUJO, f. m. {Hiß, nat.') efpece d’efearbot ou
d e fearabée d’Amérique. Foye^ S c a r a b é e .
CUCULLEjfubft. f. {Hiß. anc. & mod.) étoit autrefois
la cappe des voyageurs : on l’appelloit aufli
coules & gula : ce nom a pafle chez les moines, &
lignifie leur froc & leur cappe , qui étoient autrefois
d’une feule piece. Foye^Co u l l e . (G )
CUCUPHE & DEMI-CUCUPHE, {Pharmacie^
bonnet pique, garni de poudres céphaliques, qu’on
applique fur la tête des malades pour fortifier le cerveau.
On l’employoit dans la migraine ; .mais il eft
de peu d’ufage préfentement. Voilà la poudre que
l’on employoit dans les cucuphes. Prenez clous de
girofle, canelle, calamus aromatique, jonc odorant,
iris, marjolaine, romarin, bétoine, fauge, fléchas,
de chacun un gros ; baies de laurier, ftyrax, benjoin,
gomme tacamahaca, de chacun un demi-gros : mettez
en poudre tous ces ingrédiens, & répandez-la fur du
coton, qu’on enfermera dans la doublure de cette e fpece
de bonnet piqué. James & Chambers.
CUCURBITE, f. f. {Chimie.) La cucurbtte ou la
courge eft un vaiffeau chimique faifant partie de l’a-
lembic (voyeç A l e m b i c ) , & fervant à contenir les
matières que l’on veut foûmettre à la diftillation. On
appelle aufli ce vaiffeau, à caufe de fa figure, vejjic
& poire. F?ye{ les Planches de Chimie.
Les cucurbites fe font de cuivre étamé, d’étain, de
verre, & de terre.
Celles qui font deftinées à la diftillation des eaux
fimples, des huiles effentielles, de l’eau-de-vie, &
généralement de toutes les matières, qui, traitées
avec l’eau, doivent prendre le degré bouillant, font
toûjours de cuivre, l’étain ne pouvant lui être fubfi
titué à caufe de la facilité avec laquelle il entre en
fufion ; mais il faut, pour prévenir autant qu’il eft
poflible les mauvais effets de la qualité venéneufe
du cuivre, avoir foin de les faire etamer de tems en
tems ; c’eft à quoi les Apoticaires ne fauroient faire
trop d’attention, eux qui pendant le cours d’une année
fe fervent de l’alembic de cuivre pour diftiller
un très-grand nombre de différentes plantes, dont il
y en a plufieurs qui attaquent facilement le cuivre,
je veux dire les plantes alkalines. Foye{ D i s t i l l a t
i o n , C u i v r e .
Les cucurbites que l’on doit employer à faire des
diftillations au bain - marie, doivent toûjours être
d’étain ; il n’y a rien ici à craindre de la grande fu-
fibilité de ce métal, le degré de feu qu’on leur applique
ne pouvant jamais furpaffer celui de l’eau
bouillante. On en exclurra donc le cuivre, même
le mieux étamé.
Le verre feroit de toutes les matières celle qu’il
conviendroit d’employer à faire toutes les cucurbites,
s’il étoit poflible; mais fa grande fragilité, la
difficulté de former ces fortes de vafes fins être
obligé de faire à la partie inférieure externe un bouton
que les ouvriers appellent pontée, qui eft l’endroit
par’où caffent tous les vaiffeaux de verre lorf-
qu’on les échauffe trop promptement & trop fort,
ou bien lorfqu’on les fait paffer trop vîte du chaud
au froid. L’impoflibilité où l’on eft de pouvoir rafraîchir
exaâement & continuellement le chapiteau,
avantage que les feuls vaiffeaux métalliques
nous procurent, ajoutent un nouvel inconvénient
à l’emploi des cucurbites de verre : toutes ces rai-
fons, dis-je, font caufe qu’on ne fe fert pas des cucurbites
de verre aufli fou vent qu’on le feroit ; elles
font cependant d’un ufage fort étendu ; celles dont
nous nous fervons à Paris, quoique d’un affez mauvais
verre, fupportent très-bien au bain de fable le
degré de feu qui fait bouillir l ’eau, fur-tout fi elles
font d’un verre fort mince. C ’eft pourquoi on peut
fans crainte les employer à la diftillation de l’eau de
pluie, de neige, &c. ayant la précaution de ne chauffer
le fable qu’autant qu’il eft néceffaire pour faire
bouillir l’eau légèrement ; c’eft de ces fortes de cucurbites
que les Chimiftes fe fervent pour retirer l’ef-
prit-de-vin de différentes teintures que l’on veut
concentrer , de différentes infufions réfineufes que
l’on veut deffecher, &c. pour reôifierdes alkalis vor
latils tirés des fuèftances animales, &c. &c. Nous
nous contentons d’indiquer ici une partie des ufages
de la cucurbite de verre dans des diftillations, nous
laiffons au Chimifté le foin de l’employer dans toutes
les circonftances où l’exafritude le requiert, &
où l’expérience lui a appris qu’il le pouvoit faire
fans rifquer la fraûure. La certitude où l’on eft que
le verre ne peut rien communiquer aux matières
que l’on veut y traiter , eft un avantage qui doit lui
faire préférer tous les vaiffeaux qui en font faits ,
dans tous les cas où il eft poflible de les employer.
• Les cucurbites de terre n’ont pas été d’un aufli fréquent
ufage qu’elles pouvoient l’être , & elles ne
tónt que peu ou point recommandées par les auteurs
de Chimie qui ont le mieux travaillé ; cependant on
peut en tirer de grands avantages : celles qui nous
viennent de Picardie , par exemple , vont très-bien
au feu nud, & on peut s’en fervir a diftiller bien
des liquides qu’on ne fauroit traiter dans les vaifir
féaux de cuivre ou d’étain, par exemple, le vinaigre,
certaines huiles effentielles , celle de tereben-
tine, & de tous.les autres baumes liquides, celle de
fiiccin que l’on veut reâifier par des diftillations^répétées
; car quoique ces huiles puiffent fort bien etre
diftillées dans les alembics de cuivre étamé, il faut
autant qu’on pourra ne le pas faire à caufe de la mau-
vaife odeur que la plûpart de ces huiles leur communiquent.
On peut encore très-bien fe fervir de
cucurbites de terre à la diftillation de l’efprit-de-fel
ammoniac , & à la fublimation de l’alkali volatil
concret du même fel; & comme elles font fort élevées
, elles font très-avantageufes pour la diftillation
des matières qui fe raréfient beaucoup, conime
le miel, la manne, &c. C ’eft à M. Rouelle, qui ne
Iaiffe rien échapper de ce qui peut rendre le manuel
de la Chimie aifé & commode, que nous fommes redevables
de l’emploi journalier que nous faifons aujourd’hui
de cette forte de cucurbite dans nos laboratoires
; nous donnerons la façon de s’en fervir & de
l’appareiller dans le fourneau clos, lorfque nous parlerons
de la diftillation du vinaigre. V . V i n a i g r e .
Les cucurbites des Potiers de Paris font fort mau-
vaifes : elles ne fouffrent pas le feu, ou du moins y
caffent facilement : elles font trop poreufes & pas
affez cuites ; aufli ne nous en fervons-nous que rarement
, ou même point du tout. Ils en font pourtant
de petites qui nous fervent à fublimer le fel fedatif
du borax, mais qu’il faut avoir foin de luter fi on
veut les empêcher de caffer. Fyye{ Lu t .
■ Les cucurbites de terre font recommandées par tous
les auteurs de Docimafie pour la diftillation de l’eau-
forte qui a fervi au départ, & on s’en fert tous les
jours avec avantage, en ce cas, dans les monnoies.
Foye^ D é p a r t .
Les cucurbites, principalement celles de terre, font
encore employées par les Chimiftes pour différentes
fublimations ; celle du foufre, celle de Mars par le
fel ammoniac , celle du fel fédatif. Voye^ S o u f r e ,
M a r s , B o r a x , S u b l im a t i o n .
On fait communément ufage des cucurbites, & fur-
.tout de celles de verre, pour les digeftions & circulations
; voyeiD i g e s t i o n & C i r c u l a t i o n , Dans
ces opérations on couvre la cucurbite ou d’un chapiteau
aveugle, voyeç C h a p i t e a u , ou bien d’une autre
cucurbite renverfée, ce qui s’appelle vaiffeau de
rencontre. Foye£ VAISSEAU DE RENCONTRE, (b)
* CUEILLAGE, f. m. ( Ferrerie. ) c’eft la portion
de matière vitrifiée, qu’a tiré fucceflivement à quatre
reprifes le gentilhomme apprenti d’une Verrerie de
verre à vitre, & qui eft néceffaire pour faire un plat.
Foyei C u e i l l e u r . Lorfque le cueillage eft formé,
le cueilleur le remet au boflier, qui va reprendre
une cinquième fois de la matière dans le pot, ce qui
s’appelle couvrir le cueillage : on dit d’un cueillage qu’il
eft bon, lorfque le cueilleur n’a point brouillé ou enfumé
la matière qu’il a tirée du pot, & qu’il l’a bien
arrondie également fur la felle. Foye^ Felle, Bos*-
siER, Cueillir, Verre à Vitre. Ce terme eft
aufli à l’ufage des autres Verreries, & s’y prend dans
le même fens.
CÜEILLE, fi f. {Mariné) C’eft un des lez ou des
bandes de toile qui compofent une voile. Pour défi*
gner la grandeur d’une voile, on dit qu’elle a tant
de cueilles, c’eft-à-dire tant de lez. Foy. V oile. ( Z )
* CUEILLEMENT, f. m. une des opérations dans
lefquelles on diftribue la fabrication des ouvrages fur
le métier à bas. Foye^ Bas au metier.
CUEILLERET, fi m. {Jurifprud.) eft un extrait
du papier terrier d’une feigneuriequi lèrt de mémoire
au receveur pour faire payer les,cens & rentes dus
à la feigneurie. Ce terme vient de cueillette qui figni-
fioit autrefois recette, comme on voit en Y article 8 G
de l’ancienne coûtume de Bretagne. Les cueillerets
font la même chofe que ce_ qu’on appelle ailleurs
lieves ou papiers de recette. Foyeç Lieves. {A )
CUEILLETTE, fubft. f. terme de commerce dernier.
C ’eft un .amas de diverfes fortes de marchandifes
qu’un maître de vaiffeau fait-, & qui lui font remifes
par plufieurs perfonnes pour former la cargaifon de
fon bâtiment. Ainfi l’on dit, charger un vaijfeau à cueillette
, quand divers particuliers concourent à en faire
le chargement.
Ce terme n’eft en ufage que fur l’Océan ; fur la
Méditerranée on dit, charger au quintal. Fye%_ Q uint
a l . Diclionn. du Comm. de Trév. & de Dish. {G) ,
C u e i l l e t t e , {Jardinage.) eft le tems où l’on
cueille les fruits lorfqu’ils fe détachent de l’arbre. On
le connoît encore au toucher , en mettant doucement
le pouce du côté de la queue fur chacun des
fruits fondans, fi le fruit obéit il eft mûr. Pour les
fruits caffans , le goût feul en décide.
On doit pré venir la maturité des fruits d’été dont
plufieurs deviendroient cotoneux , s’ils reftoient
trop long-tems fur l’arbre. Un fruit fi mûr eft fujet à
pourrir ; & l’infefre ou le lézard qui le mange, n’y
toucheroit point s’il étoit un peu verd. Les fruits
font même plus aifés à tranfporter d’un lieu à un
autre. Foye%_ Fr u it .
Les poires d’automne dans les années feches fe
cueilleront au 15 Septembre, & celles d’hyver au
15 Ofrobre, le' bon - chrétien d’hyver une femaine
plûtard ; les pommes font de cette claffe. Dans les
années humides vous cueillerez plûtard de quinze
jours : choififfez un tems fec afin que le fruit fe con-
ferve mieux, que toutes les poires ayent leur
queue, & mettez-les doucement dans la fruiterie,
lians les meurtrir ni les laiffer tomber. {K)
* C U E I L L E U R , ( Ferrerie. ) nom d’un jeune
gentilhomme apprenti, qui commence à travailler
à la fabrication des ouvrages de verre. Ç ’eft lui qui
met la felle dans le pot, pour en tirer la matière vitrifiée.
Pour qu’un cueilleur puiffe devenir boflier
dans les Verreries de verre à vitre, il faut qu’il fâche
cueillir quatre coups, & couvrir le cueillage.
Foyei C ueillage. C ’eft de fon habileté que dépend
principalement la beauté & la netteté du plat, F?yeç
V errerie.
CUEILLEUR & PORTE-CUEILLEUR, fub. m_.
( Fileur efor. ) ce font les noms de deux pièces du
roiiet ou.moulin à filer l’or. Foye^ les articles Or ,
Filer l ’or 6* Fileur d’or.
CUEILLIE. f. f. en B dûment, eft. du plâtre drefle
le long d’une réglé qui fert de repere pour -lambrif-
fer enduire de niveau, & faire à plomb les piés
droits des portes, des croifées & des cheminées. {P)
* CUEILLIR, Y. aft, c’eft au propre détacher les