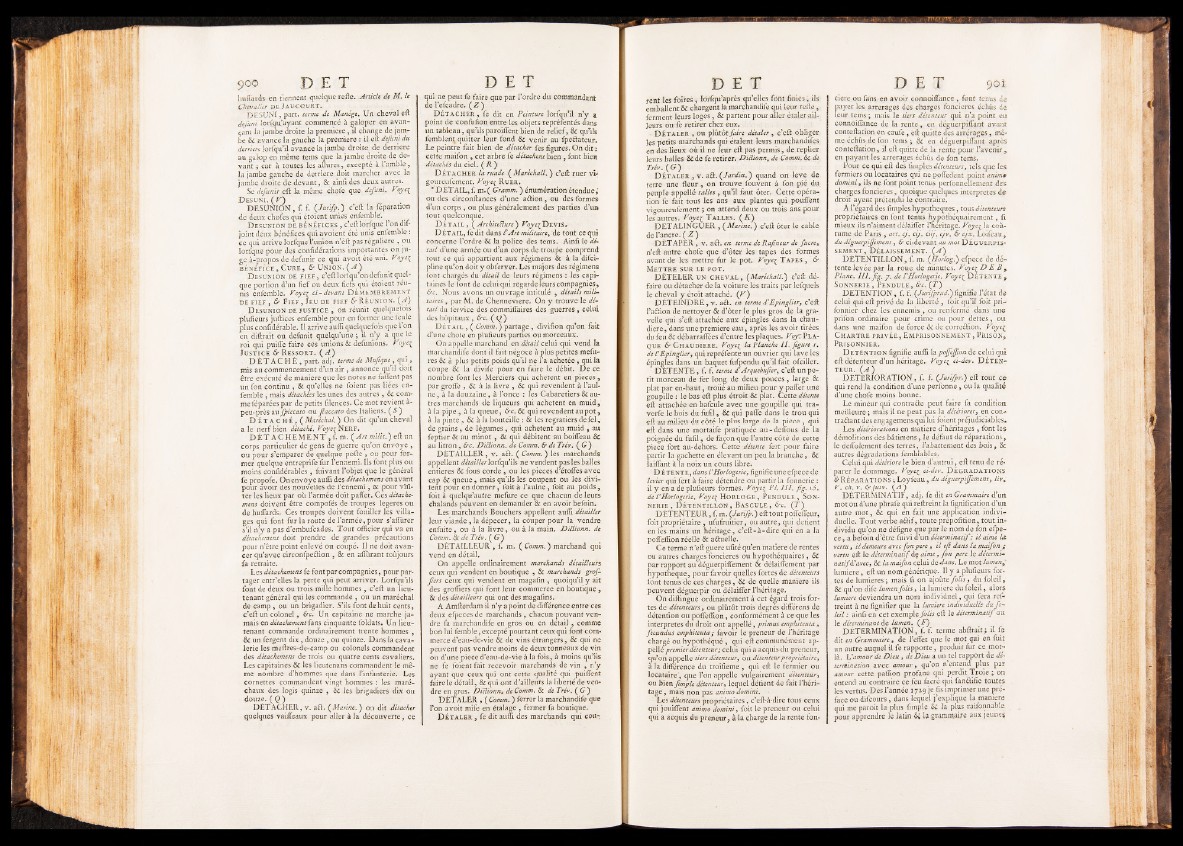
huffards en tiennent quelque refte. Article de M. le
Chevalier d e .Ja u c o u r t .
DESUNI, part, terme de Manège. Un cheval eft
dejuni lorfqu’ayant commencé à galoper en avançant
la jambe droite la première, il change de jambe
& avance la gauche la première : ilêft dejuni du
derrière lorfqu’il avance la jambe droite de derrière ;
au galop en même tems que la jambe droite de devant
; car à, toutes les allures, excepté à l’amble, ;
la jambe gauche de derrière doit marcher avec la
jambe droite de devant, & ainfi des deux autres. ;
Se defunir eft la même chofe que defuni. Vye^
D ésuni, ( r )
DESUNION, f. E ÇJ“ rifp.) c’eft la fépàration
de deux chofes qui étoient unies enfembleJ.
D ésunion de bénéfices , c’eft lorsque l’on dif-
joint deux bénéfices qui avoient été unis enfemble :
ce qui arrive lorfque l’union n’éft pas régulière , ou
•lorfque pour des confidérations importantes on juge
à-propos de defunir ce qui avoit été uni. Voye{
b é n é f ic e , C u r e , & Union. { A }
D ésunion de fief , c’ eft lorfqu’ondefunit quelque
portion d’un fief ou deux fiefs qui étoient réunis
enfemble. Voye{ ci-devant D é m e m b r e m e n t
de fief , & Fief , Jeu de fief & Réunion. (A)
D ésunion de justice , on réunit quelquefois
plufieurs juftices enfemble pour en former une feule
plus confidérable. Il arrive auffi quelquefois que l’on
en diftrait ou defunit quelqu’une ; il n’y a que le
roi qui puiffe faire ces unions & defunions. Voye^
Ju st ice & Ressort. {A)-
D É T A C H É , part. adj. terme de Mufîque, qui,
mis au commencement d’un air , annonce qu’il doit
être exécuté de maniéré que les notes ne faffent pas
un fon continu , & qu’elles ne foient pas liées enfemble
, mais détachées les unes des autres , 8c comme
féparées par de petits filences. Ce mot revient à-
peu-près au fpiccato ou Jlaccato des Italiens. (*£)
D é t a c h é , ( Maréchal.) On dit qu’un cheval
a le nerf bien détaché. Voye^ Nerf.
D É T A C H E M E N T , f. m. ( Art milit. } eft un
corps particulier de gens de guerre qu’on envoyé ,
ou pour s’emparer de quelque pofte , ou pour former
quelque entreprife fur l’ennemi. Ils font plus ou
moins confidérables , fuivant l’objet que le général
fe propofe. On envoyé auffi des détachemens en avant
pour avoir des nouvelles de l’ennemi, & pour vifi-
ter les lieux par où l’armée doit paffer. Ces détachemens
doivent être compofés de troupes legeres ou
de huffards. Ces troupes doivent fouiller les villages
qui font fur la route de l’armée, pour s’affùrer
s’il n*y a pas d’embufcades. Tout officier qui va en
détachement doit prendre de grandes précautions
pour n’être point enlevé ou coupé. Il ne doit avancer
qu’avec circonfpeftion , & en affürant toujours
fa retraite.
Les détachemens fe font par compagnies, pour partager
entr’elles la perte qui peut arriver. Lorfqu’ils
font de deux ou trois mille hommes , c’eft un lieutenant
général qui les commande , ou un maréchal
de camp , ou un brigadier. S’ils font de huit cents,
c’eft un colonel, &c. Un capitaine ne marche jamais
en détachement fans cinquante foldats. Un lieutenant
commande ordinairement trente hommes ,
& un fergent dix, douze , ou quinze. Dans la cavalerie
les meftres-de-camp ou colonels commandent
des détachemens de trois ou quatre cents cavaliers.
Les capitaines & les lieutenans commandent le même
nombre d’hommes que dans l’infanterie. Les
cornettes commandent vingt hommes : les maréchaux
des logis quinze , & les brigadiers dix ou
douze. ( Q )
DÉTACHER, v. a61. ( Marine.} on dit détacher
quelques vaiffeaux pour aller à la découverte, ce
qui ne peut fe faire que par l’ordre du commandant
de l’efcadre. (Z .) . .
D é t a c h e r , fe dit en Peinture lorfqu’il n’y a
point de confufion entre les objets représentés dans
un tableau, qu’ilsparoiffent bien de relief, 8c qu’ils
femblertt quitter-leur fond & venir au fpe&ateur.
Le peintre fait bien de détacher fes figures. On dit :
cette maifon , cet arbre fe détachent bien, font bien
détachés du ciel. ( R }
D é t a c h e r la ruade { Marèchall. } c ’ e ft ru e r v i -
g o u r eu fem en t . Voye^ R u e r .
* DÉTAIL, f. m. ( Gramm. ) énumération étendue
ou des circonftances d’une aftion., ou des formes
dùm corps , ou plus généralement des parties d’u»
tout quelconque.
D é t a il , ( Architecture} Voye{D evis#
D é t a i l , fe dit dans F Art militaire, As tout ce qui
concerne l’ordre 8c la police des tems. Ainfi le détail
d’une armée ou d’un corps de troupe comprend
tout ce qui appartient aux régimens & à la difci-
pline qu’on doit y obferver. Les majors des régimens
font chargés du détail de leurs régimens : les capitaines
le font de celui qui regarde leurs compagnies,
&c. Nous avons un ouvrage intitulé , détails militaires
, par M. de Chenneviere. On y trouve' le détail
du lervice des commiffaires des guerres, celui
des hôpitaux , &c. { }
D é t a i l , ( Comm.} partage , divifion qu’on fait
d’une chofe en plufieurs parties ou morceaux.
On appelle marchand en détail celui qui vend la
marchandife dont il fait négoce à plus petites mefu-
res 8c à plus petits poids qu’il ne l’a achetée, qui la
coupe 6c la divife pour en faire le débit. De ce
nombre font les Merciers qui achètent en pièces ,
par groffe , & à la livre , 6c qui revendent à l’aulne,
à la douzaine, à l’once : les Cabaretiers & autres
marchands de liqueurs qui achètent en muid,
à la pipe , à la queue, &c. 8c qui revendent au pot,
à la pinte, & à la bouteille : & les regratiers defel,
de grains , de légumes, qui achètent au muid , au
feptier & au minot, & qui débitent au boiffeau 8c
au litron, &c. Diclionn. de Comm. & de Trév. ( G')
DÉTAILLER, v. aft. ( Comm. ) les marchands
appellent détailler lorfqu’ils ne vendent pas les balles
entières 8c fous corde , ou les pièces d’étoffes avec
cap 8c queue, mais qu’ils les coupent ou les divi-
fent pour en donner, foit à l’aulne, foit au poids ,
foit à quelqu’autre mefure ce que chacun de leurs
chalands peuvent en demander & en avoir befoin.
Les marchands Bouchers appellent auffi détailler
leur viande ,1a dépecer, la couper pour la vendre
enfuite, ou à la livre, ou à la main. DiÜionn. de
Comm. & de Trév. {G }
DÉTAILLEUR , f. m. ( Comm.} marchand qui
vend en détail.
On appelle ordinairement marchands dètailleurs
ceux qui vendent en boutique , & marchands greffiers
ceux qui vendent en magafin , quoiqu’il y ait
des greffiers qui font leur commerce en boutique ,
& des détailleurs qui ont des magafins.
A Amfterdam il n’y a point de différence entre ces
deux efpeces de marchands , chacun pouvant vendre
fa marchandife en gros ou en détail , comme
bon lui femble, excepté pourtant ceux qui font commerce
d’eau-de-vie 8c de vins étrangers, 8c qui ne
peuvent pas vendre moins de deux tonneaux de vin
ou d’une piece d’eau-de-vie à la fois, à moins qu’ils
ne fe foient fait recevoir marchands de vin , r.’y
ayant que ceux qui ont cette qualité qui puiffent
faire le détail, 8c qui ont d’ailleurs la liberté de vendre
en gros. Diclionn, de Comm. & de Trév. {G }
DÉTALER , {Comm. ) ferrer la marchandife que
l’on avoit mife en étalage , fermer fa boutique.
D étaler , fe dit auffi des marchands qui courent
les foires, lôrfqu’après qu’elles fdttt finies ÿ ils
emballent 8c chargent la marchandife qui leur refte,
ferment leurs loges, & partent pour aller étaler ailleurs
bu Te retirer chez eux.
• D étaler , ou plutôt faire détaler, c’eft obliger -
les petits marchands qui étalent leurs marchandifes.
en des lieux où il ne leur eft pas permis, de replier
leurs balles & d e fe retirer. Diclionn. de Comm. 8c de
Trév. ( G }
D étaler , v. aéh {Jardin.} quand on leve de
terre une fleur , on trouve fouvent à fon pié du
peuple appellé talles, qu’il faut ôter. Cette opération
fe fait tous les ans aux plantes qui pouffent
vigoureufement ; on attend deux ou trois ans pour
les autres. Voye^ T alles. { K}
DETALINGUER , {Marine.} c’eft ôter le cable
de l’ancre. ( Z )
DÉTAPER, v. att. en terme de Rafineür de fucre,
n’eft autre chofe que d’ôter les tapes des formes
avant de les mettre fur le pot. Voye^ T apes , &
Met tre sur lé p o t .
DÉTELER UN ch e v a l , {Marèchall.} c’eft défaire
ou détacher de la voiture les traits par lefquels
le cheval y étoit attaché. (V )
DÉTEINDRE, v . aét. en terme d'Epinglier, c’eft
l’aâion de nettoyer & d’ôter le plus gros de la gra-
velle qui s’eft attachée aux épingles dans la chaudière,
dans une première eau, après les avoir tirées
du feu 8c débarraffées d’entre les plaques. Voy: Plaque
& CHAUDIERE. Voye^ la Planche I I . figure i.
de l'Epinglier, qui repréfente un ouvrier qui lave les
épingles dans un baquet fufpendu qu’il fait ofciller.
DÉTENTE, f. f. terme d'Arquebufier, c’eft un petit
morceau de fer long de deux pouces, large &
plat par en-haut, troiié au milieu pour y paffer une
goupille : le bas eft plus étroit 8c plat. Cette détente
eft attachée en bafcule avec une goupille qui tra-
verfe le bois du fùfil, 8c qui paffe dans le trou qui
eft au milieu du côté le plus large de la piece, qui
eft dans une mortaife pratiquée au-deffous de la
poignée du fufil, de façon que l’autre côté de cette
piece fort au-dehors. Cette détente fert pour faire
partir la gâchette en élevant un peu la branche, 8c
laiffant à la noix un cours libre.
D Étente, dans l'Horlogerie, fignifie une efpece de
levier qui fert à faire détendre ou partir la fonnerie :
il y en a de plufieurs formes. Voye^ PI. III. fig. iS,
de l'Horlogerie. Voye^ Ho r lo g e , Pendule, Sonn
e r ie , D é t en t il lo n , Ba s cu l e , &c. (T )
DÉTENTEUR, f. m. {Jurifp.} eft tout poffeffeur,
foit propriétaire , ufufruitier, ou autre, qui détient
en fes mains un héritage, c’e ft-à-dire qui en a la
poffeffion réelle & aftuelle.
Ce terme n’eft guere ufité qu’en matière de rentes
ou autres charges foncières ou hypothéquâmes , 8c
par rapport au déguerpiffement & délaiffement par
hypotheque, pour favoir quelles fortes de détenteurs
font tenus de ces charges, 8c de quelle maniéré ils
peuvent déguerpir ou délaiffer l’héritage.
On diftingue ordinairement à cet égard trois fortes
de détenteurs, ou plutôt trois degres différens de
détention ou poffeffion, conformément à ce que les
interprètes du droit ont appellé, primus emphiteuta ,
ftcundus emphiteuta; favoir le preneur de l’héritage
chargé ou hypothéqué , qui eft communément appellé
premier détenteur; celui qui a acquis du preneur,
qu’on appelle tiers détenteur, ou détenteur propriétaire,
à la différence du troifieme , qui eft le fermier ou
locataire, que l’on appelle vulgairement détenteur,
ou bien fimple détenteur, lequel détient de fait l’héritage
, mais non pas animo domini.
Les détenteurs propriétaires, c’eft-à-dire tous ceux
qui jouiffent animo domini, foit le preneur ou celui
qui a acquis du preneur, à la charge de la rente fonciere
ou fans en avoir connoiffance , font tenus de
payer les arrerages des charges foncières échus de
leur tems ; mais le tiers détenteur qui n’a point eu
connoiffance de la rente, en déguerpiffant avant
conteftation en caufe, ëft quitte des arrérages, même
échus de fon tems; 8c en déguerpiffant après
conteftation, il eft quitte de la rente pour l’avenir ,
en payant les arrerages échus de fon tems.
Pour ce qui eft des {impies détenteurs, tels que les
fermiers ou locataires qui ne poffedent point anim»
domini , ils ne font point tenus perfonnellement des
charges foncières, quoique quelques interprètes de
droit ayent prétendu le contraire.
A l’egard des fimples hypotheques, tous détenteurs
propriétaires en font tenus hypothéquairement, fi
mieux ils n’aiment délaiffer l’héritage. Voye^ la coutume
de Paris , art. cj. cij. ciij. cjv. & cjx. LoifeaU ,
du déguerpiffement, & ci-devant au mot DÉGUERPISSEMENT,
D élaissement. {A}
DÉTENTILLON, f. m. {Horlog.} efpece de dé*
tente levée par la roue de minutes. Voye^ D E B >
Plane. III. fig. y. de l'Horlogerie. Voye{ DETENTE,
So nnerie, Pendule, &c. {T}
DETENTION, f. f. {jurifprud.} fignifie l’état de
celui qui eft privé de la liberté , loit qu’il foit prif
fonnier chez les ennemis , ou renfermé dans une
prifon ordinaire pour crime ou pour dettes , ou
dans une maifon de force 8c de corre&ion. Vyye%
C hartre priv é e, Emprisonnement, Prison,
Prisonnier.
D étention fignifie auffi la poffejfion de celui qui
eft détenteur d’un héritage. Voye^ ci-dev. D étenteur.
{A }
DÉTÉRIORATION, f. f. {Jurifpr.} eft tout ce
qui rend la condition d’une perfonne, ou la qualité
d’une chofe moins bonne.
Le minéur qui contraâe peut faire fa condition
meilleure ; mais il ne peut pas la détériorer, en con-
traûant des engagemens qui lui foient préjudiciables*
Les détériorations en matière d’héritages , font les
démolitions des bâtimens, le défaut de réparations ,
le deffolement des terres, l’abattement des bois, &
autres dégradations femblafiles.
Celui qui détériore le bien d’autrui, eft tenu de réparer
le dommage. Voye^ ci-dev. DÉGRADATIONS
& RÉPARATIONS ; Loyfeau, du déguerpiffement, liy.
V. ch.v. &fuiv. {A }
DÉTERMINATIF, adj. fe dit en Grammaire d’un
mot ou d’une phrafe qui reftreint la lignification d’un
autre mot, 6c qui en fait une application individuelle.
Tout verbe aû if, toute prépofition, tout, individu
qu’on ne défigne que par le nom de fon efpec
e , a befoin d’être fuivi d’un déterminatif : il aime let
vertu , il demeure avec fon pere , il efi dans la maifon ;
vertu eft le déterminatif dç aime , fon pere le déterminatifd’avec,
8c la maifon celui dedans. Le mot lumen,
lumière, eft un nom générique. Il y a plufieurs for-,
tes de lumières; mais fi on ajoute folis, du foleil,
8c qu’on dife lumen folis, la lumière du foleil, alors
lumière deviendra un nom individuel, qui fera reftreint
à ne fignifier que la lumière individuelle du foleil
: ainfi en cet exemple folis eft le déterminatif ou
le déterminant de lumen. {F}
DÉTERMINATION, f. f. terme abftrait; il fe
dit en Grammaire, de l’effet que le mot qui en fuit
un autre auquel il fe rapporte, produit fur ce mot-
là. L'amour de D ieu, de Dieu a un tel rapport de détermination
avec amour, qu’on n’entend plus par
amour cette paffion profane qui perdit Troie ; on
entend au contraire ce feu facré qui fanûifie toutes
les vertus. Dès l’année 17x9 je fis imprimer une préface
ou difeours, dans lequel j’explique la maniéré
qui me paroît la plus fimple 6c la plus raifonnable
pour apprendre le latin ôi la grammaire aux jeunes
n
H ,
fe: