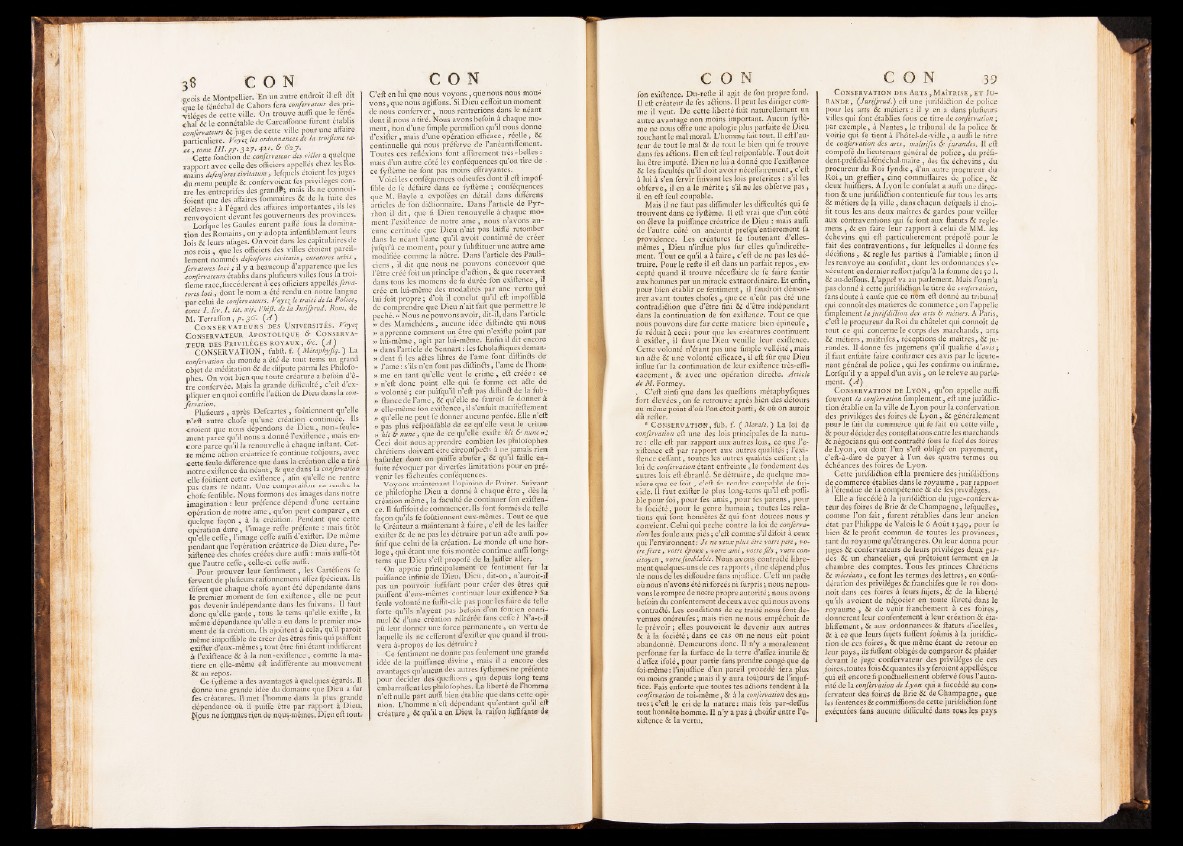
»eois de Montpellier. En un autre endroit il eft dit
tquede lenéchal deCaàors ieaatnfervauut des pïi*
Yîtcoes de cette ville. On trouve àuffi que le lene-
«hal & le connétable de Carcaffonne furent établis
xonfarmuurs & juges de cette ville pour une affaire
•particulière. Voye{ les ordonnances de latroifieme rat
t , wm1MI.rp.3x.7- 1 9 &■ 9 |
'Cette fonction de confervateur des villes a quelque
Tapport avec celle des officiers appelles chez lès Romains
defenforcs civitalum, 'lefquels étoient les piges
-du,menu peuple & confervoient fes privilèges ccfn_-
-tre -les entreprifes des grand?; mais ils rte connoif-
foient que des affaires fommaires & de la fuite des
efclaves ,: à l’égard des affaires importantes, ils les
renvoyoient devant les gouverneurs des provinces.
Lorîqùe les Gaules eurent paffé fous la domination
des Romains, on y adopta infenfiblement leurs
lois .& leurs ufages. On voit dans les capitulaires de
nos rois, que les officiers des villes étoient pareillement
nommés defenforcs m ita is , curatons urbis ,
fmatons lo ü / il y a beaucoup d'apparence que les
iconfervatturs établis dans pluficurs villes fous la troiiieme
race, fuccéderent à ces officiers appellésyërvutores
lad.s dont le nom a été rendu en notre langue
-par celui de conferv tueurs. Voyelle tràtb dt la Poliu,
tome I . liv .I. tic. xij. l’hift. de la Jmifpmd. llom. de
M. Terraffbn , p. 3 dl (A ) .
1 C o n s e r v a t e u r s des Universités. Voye{
C onservateur Apostolique & C onservateur
des Privilèges r o y a u x , fre. (A )
CONSERVATION, fubft. f. ( Mltnphyfii. ) La
confemuior. du monde a été de tout teins un grand
objet de méditation & de difpute parmi les Philofo-
phes. On voit bien que toute créature a befoin d’être
confervée. Mais la grande difficulté, c’eft d’expliquer
en quoi confiftel’aétion de Dieu dans la coït,
fervation.
Plufieurs , après Defcartes , foûtiennent qu’elle
n’eft autre chofe qu’une création continuée. Ils
■ croient que nous dépendons dé Dieu, non-feulement
parce qu’il nous a donne 1 exiftence, mais encore
parce qu’il la renouvelle à chaque inftant. Cette
même ariion créatrice fe continue toujours, avec
cette feule différence que dans la création elle a tiré
aïotre exiftence du néant, & que dans la confervation
elle foûtient cette exiftence j afin qu’elle ne rentre
pas dans le néant. Une comparaison va rendre la
chofe fenfible. Nous formons des images dans notre
imagination : leur préfence dépend d’une certaine
opération de notre ame, qu’on peut comparer, en
quelque façon , à la création. Pendant que cette
opération dure, l’image refte préfente : mais fitôt
qu’elle ceffe, l’image ceffe aufli d’exifter. De même
pendant que l’opération créatrice de Dieu dure, l’e-
xiftence des chofes créées dure aufli : mais aufli-tôt
que l’autre ceffe, celle-ci ceffe aufli.
Pour prouver leur fentiment, les Carteftens fe
fervent de plufieurs raifonnemens âffez fpécieux. Ils
difent que chaque chofe ayant été dépendante dans
le premier moment de fon exiftence, elle ne peut
pas devenir indépendante dans les fui vans. Il faut
donc qu’ elle garde, tous le tems qu’elle exifte, la
même dépendance qu’elle a eu dans le premier moment
de fa création. Ils ajoutent à cela, qu’il paroît
mêmeimpoflible de créer des êtres finis qui puiffent
exifter d?eux-mêmes ; tout être fini étant indifférent
à l’exiftence & à la non-exiftence, comme la matière
en elle-même eft indifférente au mouvement
& au repos.
Ce fyftème a des avantages à quelques égards. Il
donne une.grande idée du domaine que Dieu a fur
fes créatures. I l .met l’homme dans la plus grande
dépendance où il puiffe être par rapport à Dieu.
|fous ne fon des rfen de nQus-mêmes. Dieu eft tout*
C ’eft en lui que nous voyons, que nous nous mouvons
, que nous agiffons. Si Dieu ceffoit un moment
dé nous conferver , nous rentrerions dans le néant
dont il nous a tiré. Nous avons befoin à chaque moment
, non d’une fimple permiflion qu’il nous donne
d’exifter, mais d’une opération efficace, réelle, 6c
continuelle qui nous préferve de l’anéantiffement.
Toutes ces refléxions font affûrement très-belles:
mais d’un autre côté les conféquences qu’on tire de ■
ce fyftème ne font pas moins effrayantes.
Voici les conféquences odieufes dont il eft impofi
fible de fe défaire dans ce fyftème ; conféquences
que M. Bayle a expofées en détail dans différens
articles de fon diriionnàire. Dans l’article de Pyr-
rhon il dit, que fi Dieu renouvelle à chaque moment
l’exiftence de notre ame, nous n’avons aucune
certitude que Dieu n’ait pas laifle retomber
dans le néant l’ame qu’il avoit continué de créer
jufqu’à ce moment, pour y fubftituer une autre ame
modifiée comme la nôtre. Dans l’article des Pauli-
ciens, il dit que nous ne pouvons concevoir que
l ’être créé foit un principe d’ariion, & que recevant
dans tous les momens de fa durée fon exiftence, il
crée en lui-même des modalités par une vertu qui
lui foit propre ; d’où il conclut qu’il eft impoflible
de comprendre que Dieu n’ait fait que permettre le
péché. « Nous ne pouvons avoir, dit-il, dans l’article
» des Manichéens, aucune idée diftinrie qui nous
» apprenne comment un être qui n’exifte point par
» lui-même, agit par lui-même. Enfin il dit encore
» dans l’article de Sennart : les fcholaftiques deman-
» dent fi les aries libres de l’ame font diftinris de!
» l’ame : s’ils n’en font pas diftinris, l’ame de l’hom-
» me en tant qu’elle veut le crime, eft créée : ce
» n’eft donc point elle qui fe forme cet a&e dé
» volonté ; car puifqu’il n’eft pas diftinri de la fub-
» ftance de l’ame, 8c qu’elle ne fauroit fe donner à
» elle-même fon exiftence, il s’enfuit manifeftement
» qu’elle ne peut fe donner aucune penfée. Elle n’eft
» pas plus refponfable de ce qu’elle veut le crime
» hîc & nunc, que de ce qu’elle exifte hîc & nunc»:
Ceci doit nous apprendre combien les philoiophea
chrétiens doivent être circonfperis à ne jamais rien
hafarder dont on puiffe abufer ; 6c qu’il faille en-
fuite révoquer par diverfes limitations pour en prévenir
les facheufes conféquences.
Voyons maintenant l ’opinion de Poiret. Suivant
ce philofophe Dieu a donné à chaque être, dès la
création même, la faculté de continuer fon exiftence.
Il fuffifoit de commencer. Ils font formés de telle
façon qu’ils fe foûtiennent eux-mêmes. Tout ce que
le Créateur a maintenant à faire, c’eft de les laiffer
exifter 6c de ne pas les détruire par un arie aufli po-
fitif que celui de la création. Le monde eft une hor-
l°ge 9 qui étant une fois montée continue aufli long-,
tems que Dieu s’eft propofé de la laiffer aller.
On appuie principalement ce fentiment fur la:
puiffance infinie de Dieu. Dieu, dit-on, n’auroit-i!
pas un pouvoir fuffifant pour créer des êtres quï
puiffent d’eux-mêmes continuer leur exiftence? Sa
feule volonté ne fuffit-elle pas pour les faire de telle
forte qu’ils n’ayent pas befoin d’un foutien continuel
6c d’une création réitérée fans ceffe? N’a-t-il
pû leur donner une force permanente, en vertu de
laquelle ils ne cefferont d’exifter que quand il trou-
, vera à-propos de les détruire ?
- Ce fentiment ne donne pas feulement une grande'
idée de la puiffance divine, mais il a encore des
avantages qu’aucun des autres fyftèmes ne préfente
pour décider des quellions , qui depuis long tems
ëmbarraffent les philofophes. La liberté de l’homme
n’eft nulle part aüfli bien établie que dans cette opi-1
nion. L’homme n’eft dépendant qu’entant qu’il eft
créature, 6c qu’il a en Dieu la raifon fufli,fente d«;
fon exiftence. Du-refte il agit de fon pró pre fond.
Il eft créateur de fes aérions. Il peut les diriger comme
il veut. De cette liberté fuit naturellement un
autre avantage non moins important. Aucun fyftè-
me ne nous offre une apologie plus parfaite de Dieu
touchant le mal moral. L’homme fait tout. Il eft l’auteur
de tout le mal & de tout le bien qui fe trouve
dans fes aérions. Il en eft feul refponfable. Tout doit
lui être imputé. Dieu ne lui a donné que l’exiftençe
6c les facultés qu’il doit avoir néceffairement, c’eft
à lui à s’en fervir fuivant les lois preferites : s’il les
obferve, il en a le mérite j s’il ne les obferve pas,
il en eft feul coupable.
Mais il ne faut pas diflïmuler les difficultés qui fe
trouvent dans ce fyftème. Il eft vrai que d’un côté
on éleve la puiffance créatrice de Dieu : mais aufli
de l’autre côté on anéantit prefqu’entierement fa
providence. Les créatures fe foutenant d’elles-
mêmes , Dieu n’influe plus fur elles qu’indirerie-
ment. Tout ce qu’il a à faire, ç’eft de ne pas les détruire.
Pour le refte il eft dans un parfait repos, excepté
quand il trouve néceffaire de fe faire fentir
aux hommes par un miracle extraordinaire. Et enfin,
pour bien établir çe fentiment, il faudroit démontrer
avant toutes chofes que ce n’eût pas été une
contradiérion que d’être fini 6c d’être indépendant
dans la continuation de fon exiftence. Tout ce que
nous pouvons dire fur cette matière bien épineufe,
fe réduit à ceci : pour que les créatures continuent
à exifter, il faut que Dieu veuille leur exiftence.
Cette volonté n’étant pas une fimple velléité, mais
un aéle 6c une volonté efficace, il eft fur que Dieu
influe fur la continuation de leur exiftence très-effi-
cacçment, 6c avec une opération direéte. Article
de M. Formey.
. C ’eft ainfi que dans les queftions métaphyfiques
fort élevées, on fe retrouve après bien des détours
au même point d’où l’onétoit parti, & où on auroit
du refter.
* C o nserv at ion, fub. f. ( Morale. ) La loi de
confervation eft une des lois principales de la nature
: elle eft par rapport aux autres lois, ce que l’e-
xiftence eft par rapport aux autres qualités ; l’exiftence
ceffant, toutes les autres qualités ceffent ; la
loi de confervation étant enfreinte, le fondement des
autres lois eft ébranlé. Se détruire, de quelque maniéré
que ce fo it , c ’eft fe rendre coupable de fui-
cide. Il faut exifter le plus long-tems qu’il eft poffi-
ble pour fo i, pour fes amis, pour fes parens, pour
la fociété, pour le genre humain ; toutes les relations
qui font honnêtes 6c qui font douces nous y
convient. Celui qui peche contre la loi de confervation
les foule aux piés ; c’eft comme s’il difoit à ceux
qui l’environnent: Je ne veux plus être votre pere, votre
frere, votre époux, votre ami, votre fils , votre concitoyen
, votre femblable. Nous avons contrarié librement
quelques-uns de ces rapports, il ne dépend plus
de nous de les difl'oudre fans injuftice. C’eft un parie
oùnqus n’avons été ni forcés ni furpris ; nous ne pouvons
le rompre de notre propre autorité ; nous avons
befoin du confentement de ceux avec qui nous avons
contrarié. Les conditions de ce traité nous font devenues
onéreufes ; mais rien ne nous empêchoit de
le prévoir ; elles pouvoiertt le devenir aux autres
& à la fociété ; dans ce cas on ne nous eût point
abandonné. Demeurons donc. Il n’y a moralement
perfonne fur la furface de la terre d’affez inutile 6c
d’affez ifolé, pour partir fans prendre congé, que de
foi-même : l’injuftice d’un pareil procédé fera plus
ou moins grande ; mais il y aura toûjours de l’injuftice.
Fais enforte que toutes tes ariions tendent à la
confervation de toi-même, 6r. à la confervation des autres
; c’eft le cri de la nature : mais fois par-deffus
tout honnête homme. Il n’y a pas à choilir entre l’e-
xiftençe 8c la vertu.
C onservation des Ar t s ,M aîtrise, et Jurande
, ( Jurifprud,) eft une jurifdiriion de police
pour les arts 6c m é t ie r s il y en a dans plufieurs
villes qui font établies fous ce titre de confervation ;
par exemple, à Nantes, le tribunal de la police 8c
voirie qui fe tient à l’hôtel-de-ville, a aufli le titre
de confervation des arts, maîtr'fes & jurandes. Il eft
compofé du lieutenant général de police, du préfi-
dent-préfidiahfénéchal-maire , des fix échevins, du
procureur du Roi fyndic, d’un autre procureur du
R o i, un greffier, cinq commiffaires de police, 6c
deux huimers. A Lyon le confulat a aufli une direction
& une jurifdiriion contentieufe fur tous les arts
6c métiers de fe v ille, dans chacun defquels il choi-
fit tous les ans deux maîtres 6c gardes pour veiller
aux contraventions qui fe font aux ftatuts 6c regle-
mens , 6c en faire leur rapport à celui de MM. les
échevins qui eft particulièrement prépofé pour lç
fait des contraventions, fur. lefquelles il donne fes
décifions, 6c réglé les parties à l’amiable ; finon if
les renvoyé au confulat, dont les ordonnances s’exécutent
en dernier refforr jufqu’à la femme dei 501.
6c au-deffous. L’appel va au parlement. Mais l’on n’a
pas donné à cette jyrifdiriian le titre de confervation,
fans doute à caiife que ce nom eft donné au tribunal
qui connoît des matières de commerce ; on l’appelle
Amplement la jurifdiclion des ans & métiers. A Paris,
c’eft le procureur du Roi du châtelet qui connoît de
tout ce qui concerne le corps des marchands, arts
6c métjers, maftrifes, réceptions de maîtres, 6c jurandes.
Il donne fes jugemens qu’il qualifie dWi* ;
jl faut enfuite faire confirmer ces avis par le lieutenant
général de police, qui les confirme ou infirme,
Lorfqu’il y a appel d’un avis, on le releve au parlement.
(A )
C onservation de Lyon , qu’on appelle aufli
fouvent la confervation Amplement, eft une jurifdic-
tion établie en fe ville de Lyon pour fe confervation
des privilèges des foires de L y on , 6c généralement
pour le fait du commercé qui fe fait en cette v ille,
6c pour décider des çonteftations entre les marchands
6c négocians qui ont contrarié feus le feel des foires
de Ly on , ou dont l ’un s’eft obligé en payement,
c’eft-à-dire de payer à l’un des quatre termes ou.
échéances des foires de Lyon.
Cette jurifdiriion eft la première des jurifdiriions
de commerce établies dans le royaume, par rapport
à l’étendue de fa compétence 6c de fes privilèges.
Elle a fuccédé à la jurifdiriion du juge-conferva-
teur des foires de Brie 6c de Champagne, lefquelles,
comme l’on fa it, furent rétablies dans leur ancien
état par Philippe de Valois le 6 Août 1349, pour fe
bien 6c le profit commun de toutes les provinces,
tant du royaume qu’étrangeres. On leur donna pour
juges 6c confervateurs de leurs privilèges deux gardes
6c un chancelier, qui prêtoient ferment en fe
chambre des comptes. Tous les princes Chrétiens
6c mécréans, ce font les termes des lettres, en confi-
dération des privilèges 6c franchifes que le roi don-
poit dans ces foires à leurs fujets, 6c de la liberté
qu’ils a voient de négocier en toute fûreté dans le
royaume , 8c de venir franchement à ces foires,
donnèrent leur confentement à leur création 8c éta-
bliflèment, 6c aux ordonnances 6c ftatuts d’icelles,
& à ce que leurs fujets fuffent foûmis à la jurifdic-
tion de ces foires, 8c que même étant de retour en
leur pays, ils fuffent obligés de comparoir 6c plaider
devant le juge confervateur des privilèges de ce$
foires,toutes fois 6cquantes ilsyferoient appellésjce
qui eft encore A pooriuellement obfervé fous l’autorité
de la confervation de Lyon qui a fuçcédé au confervateur
des foires de Brie 8c de Champagne, que
les fentences 6c commiflions de cette jurildiriion font
exécutées fans aucune difficulté dans tous les pays