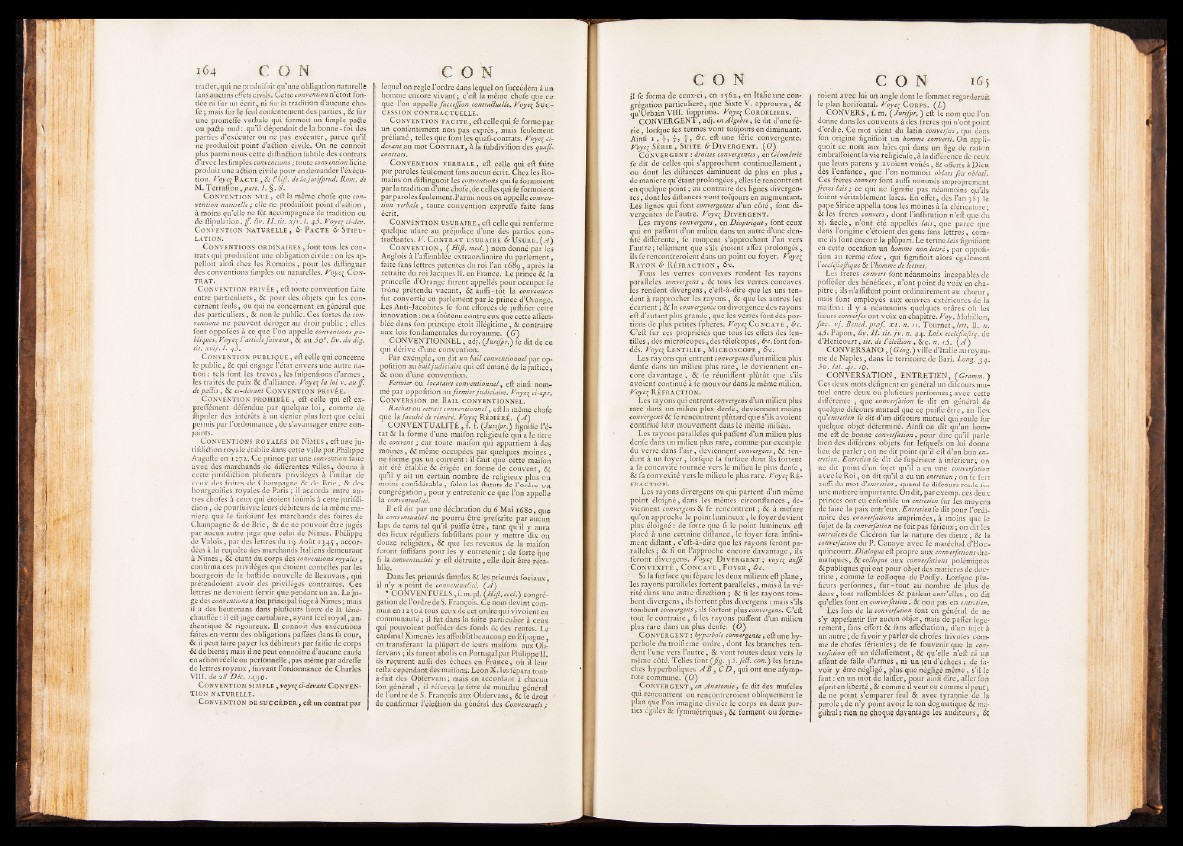
trailer, qui ne produifoit qu’une obligation naturelle
fans aucuns effets civils. Cette convention n’étoit fondée
ni fur un écrit* ni fur la tradition d’aucune cho-
fe ; mais fur le feul eonfentement des parties, & fur
une promeffe verbale qui formoit un fimple paôe
ou paéle nud: qu’il dépendoit de la bonne-foi des
parties d’exécuter ou ne pas exécuter, parce qu’il
ne produifoit point d’a il ion civile. On ne connoît
plus parmi nous cette diltinition fubtile des contrats
d’avec les fimples conventions; toute convention licite
produit une ailion civile pour en demander l’éxécu-
tion. F?yeç PACTE, & P hiß. de la.jurifprud, Rom. de
M. Terraffon ,part. I. §. 8.
C onvention nue, eft la même chofe que con-
vention naturelle ; elle- ne produifoit point d’ailion ,
à moins qu’elle ne fut accompagnée de tradition ou
de ftipulation, ff. Uv. II. tit. xjv. I. 46. Foye{ ci-dey.
Convention naturelle, & Pacte & Stipulation.
Conventions ordinaires , font tous les contrats
qui produifent une obligation civile : on les ap-
pelloit ainli chez les Romains, pour les dillinguer.
des conventions fimples ou naturelles, Foye% Contrat.
Convention privée , eft toute convention faite
entre particuliers, & pour des objets qui les concernent
feuls, ou qui ne concernent en général que
des particuliers, & non le public. Ces fortes de conventions
ne peuvent déroger au droit public ; elles
font oppofées à ce que l’on appelle conventions publiques.
Voyei Varticle fuivant, & au 5 0e. liv. du dig.
tit. xvij. 1. 45.
Convention publique , eft celle qui concerne
le public, & qui engage l’état envers une autre nation
: tels font les treves, les fufpenfions d’armes ,
les traités de paix & d’alliance. Foye[ la loi v. au ff.
depaclis , & ci-devant CONVENTION PRIVÉE.
. C onvention prohibée , eft celle qui eft ex-
preffément défendue par quelque lo i, comme de.
ftipuler des intérêts à un denier plus fort que celui
permis par l’ordonnance, de s’avantager entre conjoints.
Conventions royales de Nîmes , eft une ju-
rifdiélion royale établie dans cette ville par Philippe
Augufte en 127z. Ce prince par une convention faite
avec des marchands de différentes villes,, donna à
cette jurifdiétion plusieurs privilèges à l’inftar de
ceux des foires de Champagne & de Brie, & des
bourgeoifies royales de Paris ; il accorda entre autres
chofes à ceux qui étoient fournis à cette jurifdi-
clion, de pourfuivre leurs débiteurs de la même maniéré
que le faifoient les marchands des foires de
Champagne & de Brie, & de ne pouvoir être jugés
par aucun autre juge que celui de Nîmes. Philippe
de Valois, par des lettres du 19 Août 1345 , accordées
à la requête des marchands Italiens demeurant
à Nîmes, & étant du corps des conventions royales,
confirma ces privilèges qui étoient conteftés par les
bourgeois de la baftide nouvelle de Beauvais, qui
prétendoient avoir des privilèges contraires. Ces
lettres ne dévoient fervir que pendant un an. Le juge
des conventions a fon principal fiége à Nîmes ; mais
il a des lieutenans dans plufieurs lieux de la féné-
çhauffée : il eft juge cartulaire, ayant fceL royal, authentique
& rigoureux. Il connoît des exécutions
faites en vertu des obligations paffées dans fa cour,
& il peut faire payer les débiteurs par faille de corps 1
& de biens ; mais il ne peut connoître d’aucune caufe
en aflion réelle ou perfonnellè, pas même par adreffe ;
de lettres royaux, fuivant l’ordonnance de Charles
VIII. du 2.8 Déc. 149-0. .4 Convention simple , voye^çi-devant Convention
naturelle.
. Convention de succéder, eft un contrat par
| lequel on regle l’ordre dans lequel on fucçédera à un
j homme encore vivant* ç’eft la même chofe que ce
! que l’on appelle fuccejjîon contractuelle. Foye£ Su c- ! CESSION CONTRACTUELLE.
Convention ta c ite , eft celle qui fe forme par
; un eonfentement non pas exprès, mais; feulement
j préfumé, telles que font les quafi-contrats, Foye^ ci-
; devant au mot Contrat, à la fubdivifion des quafi-
; contrats.
Convention verbale , eft celle qui eft faite
I par paroles feulement fans aiicun écrit. Chez les Ro-
: mains on difting.uoit les conventions qui fe formoient
■ par la tradition d’une chofe,dje celles qui fe formoient
; par paroles feulement.Parmi nous on appelle convention
verbale, toute convention expreffe faite fans
écrit.
Convention usuraire , eft celle qui renferme
quelque ufure au préjudice d’une des parties con-
tra&antes. V. Contrat usuraire 6* Usure. ( 4 )
C onvention , ( Hiß. mod. ) nom donné par les
Anglois à l’affemblée extraordinaire du parlement,
faite fans lettres patentes du roi l’an 1689, après la
retraite du roi Jacques II. en France. Le prince & la
princeffe d’Orange furent appellés pour occuper le
trône prétendu vacant, & auffi-tôt la convention
fut convertie en parlement par le prince d’Orange.
Les Anti-Jacob.ites fe font efforcés de juftifier cette
I innovation : on.a foutenu contre eux que cette affem-
I blée dans fon principe étoit illégitime, & contraire
aux lois fondamentales du royaume. (G)
CONVENTIONNEL, adj. (Jurijpr.') fe dit de ce
' qui dérive d’une convention.
Par exemple, on dit un bail conventionnel par pp-
pofition au bail judiciaire qui eft émané de la juftice,
& non d’une convention.
Fermier ou locataire conventionnel, eft ainli nommé
par oppofition au fermier judiciaire. Voye£ ci-apr.
Conversion de Bail conventionnel.
Rachat ou retrait conventionnel, eft la même chofe
que la facultéde réméré. Voyeç RÉMÉRÉ. (4 )
CONVENTUALITÉ, f. f. (Jurifpr.) lignifie l’état
& la forme d’une maifon religieufe qui a le titre
de couvent ; car toute maifon qui appartient à des
moines, & même occupées par quelques moines ,
ne forme pas un couvent : il faut que cette maifon
ait été établie & érigée.en forme de couvent,
qu’il y ait un certain nombre de religieux plus ou
moins conlidérable, félon les ftatuts de l’ordre ou
congrégation, pour y entretenir ce que l’on appelle
la conventualité.
Il eft dit par une déclaration du 6 Mai 1680, que
la conventualité ne pourra être'prefçrite par auçuq
laps de tems tel qu’il puiffe être , tant qu’il y aura
des lieux réguliers fubfiftans pour y mettre dix ou
douze religieux, & que les revenus de la maifon
feront fuffifans pour les y entretenir ; de forte ijue
fi la conventualité y eft détruite, elle dpit être rétablie.
il n’y a point de conventualité. (4)
* CONVENTUELS, f. m. pi. (Hiß. ecçl.) congrégation
Dans les prieurés fimples & les prieurés fociaux,
de l’ordre de S. François. C e nom devint commun
en 1250 à tous ceux de cet ordre qui vivoient en
communauté ; il fut dans la fuite particulier à ceii*
qui pouvoient pofféder des fonds &c des rentes. Le
cardinal Ximenès les affoiblit beaucoup en Efpagne,
en transférant la plupart de leurs irçaifons aux qj,.
fervans ; ils furent abolis en Portugal par Philippe II.
ils reçurent auflî des échecs en France, où il leur
refta cependant des maifons. Léon X. les fepara toutr
à-fait des Obfervans ; mais en accordant à chacun
ion général , il réferva le titre de miniftre généra)
de l’ordre de S. François aux Obfervans, & le droit -1
de confirmer l’éleélion du général des Conventuels ;
il fe forma fie ceux-ci, en 15 61 , en Italie une congrégation
particulière, que Sixte V. approuva, &
qu’Ur-bain VIII. fupprima. Voyt{ C ordeliers.
CONVERGENT, adj. en Algèbre, fe dit d’une féerie
, lorfque fes termes vont toujours en diminuant.
Ainfi 1 , t , f-, &c. eft une férié convergente»
Voyei Sé r ie , Suite & D ivergen t. (O) CONVERGENT : droites convergentes, en Géométrie
fe dit de celles qui s’approchent continuellement,
ou dont les diftances diminuent de plus en plus ,
fie maniéré qu’étant prolongées, elles fe rencontrent
en quelque point ; au contraire des lignes divergentes
, dont les diftances vont toujours en augmentant.
Les lignes qui font convergentes d’un côté, font divergentes
de l’autre. Foye{ D ivergent.
Les rayons convergens, en Diaptrique, font ceux
•qui en paffant d’un milieu dans un autre d’une den-
fité différente, fe rompent s’approchant l’un vers
l’autre ; tellement que s’ils étoient affez prolongés *
ils fe rencontïeroient dans un point ou foyer. Foye^
R a y o n & R é f r a c t i o n , &c-, .
Tous les verres convexes rendent les rayons
parallèles convergens , & tous les verres concaves
les rendent divergens, c’eft-à-dire que les uns tendent
à rapprocher les rayons, & que les autres les
écartent ; & la convergence ou divergence des rayons
eft d’autant plus grande, que les verres font des portions
de plus petites fpheres. Foye^ C oncave , &c.
C ’eft fur ces propriétés que tous les effets des lentilles
, des microfcopes , des télefeopes, &c. font fondés.
Voye{ L en t il le, Mic r o s co p e , &c.
Les rayons qui entrent convergens d’un milieu plus
fienfe dans un milieu.plus rare, le deviennent encore
davantage , & fe réunifient plutôt que s’ils
avoient continué à fe mouvoir dans îe même milieu.
Voyei R é f r a c t i o n .
Les rayons qui entrent convergens d’un milieu plus
rare dans un milieu plus denfe, deviennent moins
convergens & fe rencontrent plûtard que s’ils avoient
continué leur mouvement dans le même milieu.
Les rayons parallèles qui paffent d’un milieu plus
denfe dans un milieu plus rare, comme par exemple
du verre dans l’air, deviennent convergens, & tendent
à un foy er, lorfque la furfaee dont ils fortent
a fa concavité tournée Vers le milieu le plus denfe ,
& fa convexité vers le milieu le plus rare. Foye^ RÉ*
f r a c t i o n .
Les rayons divergens ou qui partent d’un même
point éloigné, dans les mêmes circonftances , deviennent
convergens & fe rencontrent ; & à mefure
qu’on approche le point lumineux, le foyer devient
plus éloigné : de forte que fi le point lumineux eft
placé à une certaine diîlance, lé foyer fera, infiniment
diftant , c’eft-à-dire que les rayons feront.pa*
rallelés ; & fi on l’approche encore davantage, ils
feront divergens. Foye^ D ivergent ; voye^ auffi
C o nvexité , C o n c a v e , Fo y e r , &c...
Si la furfaee qui fépare les deux milieux eft plane,
les rayons parallèles lortent parallèles., mais à la vérité
dans une autre direélion ; & fi les rayons tombent
divergens , ils fortent plus divergens : mais s’ils
tombent convergens, ils fortent plus convergens. C ’eft
tout le contraire, fi les rayons paflent d’un milieu
plus rare dans un plus denfe. (Ô)
C o n v e r g e n t : hyperbole convergente , eft une hyperbole
du troifieme ordre, dont lès branches tendent
l’une vers l’autre, & vont toutes deux vers le
même côté. Telles font Cfig. 3 S. fecl. con.') les branches
hyperboliques A B , C D , qui ont une afymp-
tote commune. (O)
C onvergent , en Anatomiefe dit dès mufcles
qui rencontrent ou rençontreroient obliquement le
Plan que l’on imagine divifer le corps en deux parties
égales & fymmétriques, §£ forment ou formeroient
avec lui un angle dont le fommet fegarderoit
le plan horifontal. Foye7^ Corps. (V)
CONVERS, f. m. ( Jurifpr. ) eft le nom qtiè l’on-
donne dans ies couvents à dès freres qui n’ont point
d’ordre. Ce mot vient du latin conyerjïis, qui dans
fon origine fignifioit un homme converti. On appli-
quoit ce nom aux laïcs qui dans un âge de railon
embraflbient la vie religieufe, à la différence de ceux
que leurs parens y avoient voués, & offerts à Dieu
fiés l’enfance, que l’on nommoit oblatsfeu oblati.
Ces freres convers font auffi nommés improprement
freres lais ; ce qui ne fignifie pas néanmoins qu’ils
foient véritablement laïcs. En effet, dès l’an 383 le
pape Sirice appella tous lçs moines à la cléricature;
& les freres convers -, dont l’inftitution n’eft que du
xj. fiecle, n’ont été appelles lais, que parce que
dans l’origine c’étoient fies gens fans lettres-, comme
ils font encore la plupart. Le terme lais fignifiant
en cette' occafion un homme non lettré, par oppofition
au terme clerc , qui fignifioit alors égalément
l’écclèjiaflique & Yhomme de lettres.
Les freres convers font néanmoins incapables de
pofleder des bénéfices, n’ont point de voix en chapitre
; ils n’affiftent point ordinairement au choeur,
mais font employés aux oeuvres extérieures delà
maifon : il y a néanmoins quelques ordres où les
foeurs converfes ont voix en chapitre. Foy. Màbillon,
foec. vj. Bened.proef. XI. n. 11. Tournet, lett. B. //.
4à. Papon, liv. 11.'tit. jv . n. 44. Loix cccléjîafliq. de
d’Hericourt, tit. de V-élection , &c. n. ià. (4 )
CON VERS AN O , (Géog■ .') ville d’Itaïie au royaume
de Naples, dans le territoire de Bari. Long. 3 4.
60. lat. 4 1 .Ho.
CONVERSATION, ENTRETIEN, ( Gramm. )
Ces deux mots défignent en général un difeours mutuel
entre deux ou plufieius perfonnes ; avec cette
différence , que converfàtion fe dit en général de
quelque difeours mutuel que ce puiffe être, au lieu
oyYentretien fe dit d’un difeours mutuel qui roule fur
quelque objet déterminé. Aiiifi on dit qu’un homme
eft de bonne converfàtion, pour dire qu’il parle
bien des différens objets fur lefquels on lui donne
lieu de parler -, on ne dit point qu’il eft fi’un bon entretien.
Entretien fe dit de fupérieur à inférieur ; on
ne dit point d’un fujet qu’il a eu une converfàtion
avec le R oi, on dit qu’il a eu un entretien; on fe fort
auffi du mot d’entretien, quand le difeours roule fur
une matière importante.On dit, par exemp. ces deux
princes ont eu enfemble un entretien fur les moyens
de faire la paix entr’eux. Entretient dit pour l’ordinaire
des converfations imprimées, à moins que le
fujet de la converfàtion ne foit pas férieux ; on dit les
entretiens de Cicéron fur la nature des dieux, & la
converfàtion du P. Canaye avec le maréchal d’Hoc-
quincourt. Dialogue eft propre aux converfations dramatiques
, & colloque aux converfations polémiques
& publiques qui ont pour objet des matières de doctrine
, cômrhé le colloque de Poiffy. Lorfque plufieurs
perfonnes, fur-tout au nombre de plus de
deux, font raffemblées & parlent entr’elles, on dit
qu’elles font en converfàtion, & non pas en entretien»
Les lois de la converfàtion font en général de ne
s’y appefantir fur aucun objet, mais de paffer légèrement,
fans effort & fans affeôation, fi’un fujet à
un autre ; de favoir y parler de chofes frivoles comme
dè chofes férieufes ; de fe fouvenir que la con*.
verfation eft un délaffement, & qu’elle n’eft ni un
affaut de falle d’armes , ni un jeu d’échecs ; de fa-
.voir y être négligé , plus que négligé même, s’il le
faut : en un mot fie laiffer, pour ainfi dire,’ aller ton
efprit en liberté, & comme il veut ou comme il peut ;
de ne point s’emparer feul & avec tyrannie de la
parole ; de n’y point avoir le ton dogmatique & mâ-
giftral; rien ne çhoque davantage les auditeurs, £c