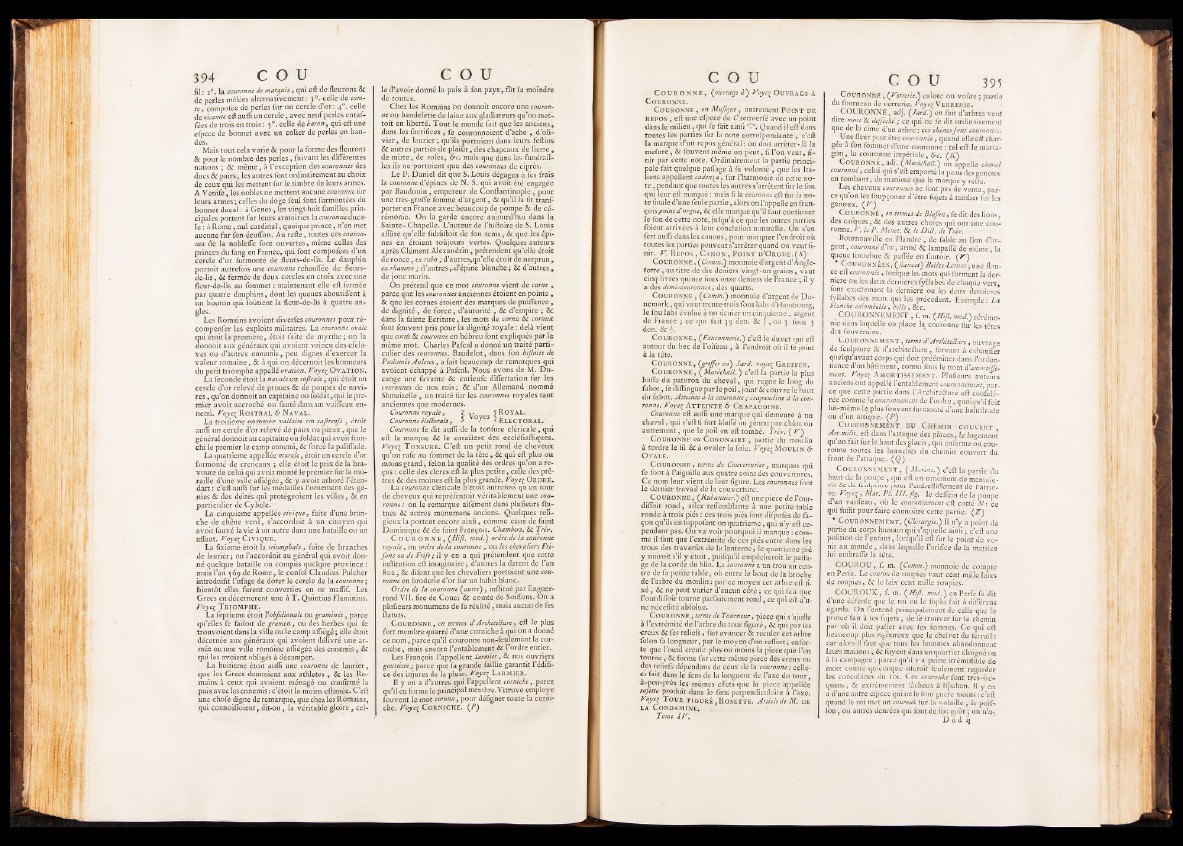
iil : z°. la couronne de marquis, qui eft de fleurons &
de perles mêlées alternativement : 30. celle de comte
, composée de perles fur un cercle d’o r: 40. celle
de vicomte eft aufli un cercle, avec neuf perles entaf-
fées de trois en trois : 50. celle de baron, qui eft une
efpece de bonnet avec un colier de perles en bandes.
Mais toüt cela varie & pour la forme des fleurons
& pour le nombre des perles, fuivant les differentes
nations ; & même, à l’exception des couronnes des
ducs & pairs, les autres font ordinairement au choix
de ceux qui les mettent fur le timbre de leurs armes.
A V enife, les nobles ne mettent aucune courpnne fur
leurs armes ; celles du doge feul font furmontées du
bonnet ducal : à G enes, les vingt-huit familles principales
portent fur leurs armoiries la couronne ducale
: à Rome, nul cardinal, quoique prince, n’en met
aucune fur fon écuffon. Au relie, toutes ces couronnes
de la nobleflfe font ouvertes, même celles des
princes.du fang en France, qui font compofées d’un
cercle d’or furmonté de fleurs-de-lis, Le dauphin
portoit autrefois une couronne rehaulfée de fleurs-
.de-lis, & fermée de deux cercles en croix avec une
fleur-de-lis au fommet : maintenant elle ell fermée
par quatre dauphins, dont les queues aboutilfent à
un bouton qui foûtient la fleur-de-lis à quatre angles.
Les Romains avoient diverfes couronnes pour re-
compenfer les exploits militaires. La couronne ovale
qui étoit la première, étoit faite de myrthe ; on la
donnoit aux généraux qui avoient vaincu des efcla-
ves ou d’autres ennemis,. peu dignes d’exercer la
valeur romaine, & à qui on décernoit les honneurs
du petit triomphe appellé ovation. Voyeç O v a t i o n .
La fécondé étoit la navale ou roflrale, qui étoit un
cercle d’or relevé de proues & de poupes de navires
, qu’on donnoit au capitaine ou foldat, qui le premier
avoir accroché ou fauté dans un vailfeau ennemi.
Voye^ R o s t r a l & N a v a l .
La troifieme nommée vallaire ou cajlrenfe , étoit
aufli un cercle d’or relevé de paux ou pieux, que le
général donnoit au capitaine ou foldat qui avoit franchi
le premier le camp ennemi, & forcé la paliflade.
La quatrième appellée murale, étoit un cercle d’or
furmonté de créneaux ; elle étoit le prix de la bravoure
de celui qui avoit monté le premier fur la muraille
d’une ville afliégée, & y avoit arboré l’éten-
. dart : c’efl aufli furies médailles l’ornement des gé-
,nies & des déités qui protégeoient les villes, & en
particulier de Cybele.
La cinquième appellée civique , faite d’une branche
de chêne verd, s’accordoit à un citoyen qui
avoit fauvé la vie à un autre dans une bataille ou un
aflaut. Voye^ C i v i q u e .
La fixieme étoit la triomphale , faite de branches
de laurier; on l’accordoit au général qui avoit donné
quelque bataille ou conquis quelque province :
mais l’an 569 de Rome, le conful Claudius Pulcher
introduifit l’ufage de dorer le cercle de la couronne ;
bientôt elles furent converties en or maflif. Les
Grecs en décernèrent une à T . Quintius Flaminius.
Voyei T r i o m p h e .
La feptieme étoit Y objidionale ou graminée, parce
qu’elles fe faifoit de gramen, ou des herbes qui fe
trouvoient dans la ville ou le camp afliégé ; elle étoit
décernée aux généraux qui avoient délivré une ar-
.mée ou une ville romaine afliégée des ennemis, &
qui les avoient obligés à décamper.
La huitième étoit aufli une couronne de laurier,
que les Grecs donnoient aux athlètes , & les Romains
à ceux qui avoient ménagé ou confirmé la
paix avec les ennemis ;.c’étoit la moins eftimée. C’efl:
une chofe digne de remarque, que chez les Romains,
qui connoifloient, dit-on, la véritable gloire, celle
d’avoir donné la paix à fon pays, fût la moindre
dè toutes,
Chez les Romains bn donnoit encore une couronne
ou bandelette de laine aux gladiateurs qu’on met-
toit en liberté. Tout le monde fait que les anciens,
dans les facrifices , fe couronnoient d’ache , d’olivier,
de laurier; qu’ils portoient dans leurs feftins
& autres parties de plaifir, des chapeaux de lierre ,
de mirte, de rofes, &c. mais-que dans les funérailles,
ils ne portoient que des couronnes de ciprès.
Le P. Daniel dit que S. Louis dégagea à fes frais
la couronne d’épines de N. S. qui avoit été engagée
par Baudouin, empereur de Conftantinople , pour
une très-grofle fomme d'argent, & qu’il la fit tranf-
porter en France avec beaucoup de pompe & de cérémonie.
On la garde encore aujourd’hui dans la
Sainte - Chapelle. L’auteur de l’hiftoire de S. Louis
aflure qu’elle fubfiftoit de fon tems, & que les épines
ën étoient toujours vertes. Quelques auteurs
après Clément Alexandrin, prétendent qu’elle étoit
de ronce, ex rubo ; d’autres,qu’elle étoit de nerprun,
ex rhamno ; d’autres,.d’épine blanche ; ÔC d’autres ,
de jonc marin.
On prétend que ce mot couronne vient de corne ,
parce que les couronnes anciennes étoient en pointe,
& que les cornes vétoient des marques de puiflance,
de dignité , de force, d’autorité , & d’empire ; &
dans la fainte Ecriture, les mots de cornu & cornua
font fouvent pris pour la dignité royale : delà vient
que corrle & couronne en hébreu font expliqués par le
même mot. Charles Pafcal a donné un traité particulier
des couronnes. Baudelot, dans fon hifloire de
Ptolomèe Auletes, a fait beaucoup de remarques qui
avoient échappé à Pafcal. Nous avons de M. Du-
cange une favante & curieufe diflertation fur les
couronnes de nos rois ; & d’un Allemand nommé
Shmeizeile , un traité fur les couronnes royales tant
anciennes que modernes.
Couronne royale y \ \r 5 R O Y A L .
Couronne électorale y $ ° ^ z 1 É L ECTORA L.'
Couronne fe dit aufli de la tonfure cléricale, qui
eft la marque & le cara&ere des eccléfiaftiques.
Voyt^ T onsure. C ’eft un petit rond de cheveux
qu’on rafe au fommet de la tête, & qui eft plus ou
moins grand, félon la qualité des ordres qu’on a reçus
: celle des clercs eft la plus petite, celle des prêtres
& des moines eft la plus grande. Voye{ Ordre.
La couronne cléricale n’etoit autrefois qu’un tour
de cheveux qui repréfentoit véritablement une couronne
: on lé remarque àifément dans plufieurs fta-
tues & autres monumens anciens. Quelques religieux
la portent encore ainfi, comme ceux de faint
Dominique & de faint François. Chambers. & Trév.
C o u r o n n e , (Hijl. mod.) ordre de la couronne
royale , ou ordre de la couronne , ou les chevaliers Fri-
fons ou de Frife; il y en a qui prétendent que cette
inftitution eft imaginaire ; d’autres la datent de l’an
801, & difent que les chevaliers portoient une couronne
en broderie d’or fur un habit blanc.
Ordre de la couronne (autre) , inftitué par Enguer-
rand VII. fire de Couci & comte de Soiflons. On a
plufieurs monumens de fa réalité, mais aucun de fes
ftatuts.
COURONNE, en termes <TArchitecture, eft le plus
fort membre quarré d’une corniche à qui on a donné
ce nom, parce qu’il couronne non-feulement la corniche,
mais encore l’entablement & l’ordre entier.
Les François l’appellent larmier, & nos ouvriers
gouttière ; parce que fa grande faillie garantit l’édifice
des injures de la pluie. V Larmier.
Il y en a d’autres qui l’appellent corniche., parce
qu’il en forme le principal membre. Vitruve employé
fouyent le mot corona, pour défigner toute la corniche.
Voyei C orniche. (P)
C o u r o n n e , (ouvrage à ) Voye^ Ouvrage à
C ouronne.
C ouronne , en Mujîque, autrement Point dè
repos , eft une efpece de C renverfé avec un point
dans le milieu, qui fe fait ainfi Quand il eft dans
toutes les parties fur la note correfpondante , c’eft
la marque d’un repos général : on doit arrêter-là la
mefure, & fouvent meme on peut, fi l’on Veut, finir
par cette note. Ordinairement la partie principale
fait quelque paflage à fa volonté , que les Italiens
appellent caden^a9 fur l’harmonie de cette note
, pendant que toutes les autres s’arrêtent fur le fon
qui leur eft marqué : mais fi la couronne eft fur la note
finale d’une feule partie, alors on l’appelle en fran-
çoispoint d’orgue, & elle marque qu’il faut continuer
le fon de cette note, jufqu’à ce que les autres parties
foient arrivées à leur conclufion naturelle. On s’en
fert aufli dans les canons, pour marquer l’endroit oii
toutes les parties peuvent s’arrêter quand on veut finir.
V. Repos , C anon j Po int d’OrgueT(Ô')
C ouronne, (Comm.) monnoie d’argent d’Angleterre
, au titre de dix deniers vingt-un grains, vaut
cinq livres quinze fous onze deniers de France ; il y
a des demi-couronnes y des quarts.
C ouronne , ( Comm.) monnoie d’argent de Danemark
, qui vaut trente-trois fous lubs d’Hambourg,
le fou lubs évalué à un denier un cinquième , argent
de France ; ce qui fait 39 den. & } , ou 3 fous 3
den. & }.
C ouronne, (Fauconnerie.) c’eft le duvet qui eft
autour du bec de l’oifeaü , à l’endroit oii il fe joint
à la tête.
CO U R O N N E , (greffer en) Jard. voye^ G r e f f e r .
C ouronne, ( Maréchall. ) c’eft la partie la plus
baffe du paturon du cheval, qui régné le long du
fabot, fe diftingue par le poil, joint & couvre le haut
du fabot. Atteinte a la couronne ; crapaudine à La couronne.
Foyei Attein te & C rapaudine.
Couronne eft aufli une marque qui demeure à un
cheval, qui s’eftfi fort blefle au genou par chûte'ou
autrement, que le poil en eft tombé. Trév. ( V")
C oûronne ou C oronaire , partie du moulin
à tordre le fil & à ovaler la foie. Voye^ Moulin &
O vale.
C ouronne , terme de Couverturier, marques qui
fe font à l’aiguille aux quatre coins des couvertures.
Ce nom leur vient de leur figure. Les couronnes font
le dernier travail de la couverture.
C ouronne, (Rubannier.) eft unepiece de l’our-
difloir rond, allez refîemblante à une petite table
ronde à trois piés : ces trois piés font difpofés de façon
qu’ils en fuppofent un quatrième, qui n’y eft cependant
pas. On va voir pourquoi il manque : comme
il faut que l’extrémité de ces piés entre dans les
trous des traverfes de la lanterne, le quatrième pié
y nuiroit s’il y é toit, puifqü’il empêcheroit le paflage
de la cordé du blin. La couronne a Un trou au centre
de fa petite table, oîi entre le bout de la broche
de l’arbre du moulin : par ce moyen cet arbre eft fix
é , & ne peut varier d’aucun coté ; ce qui fait que
l ’ourdifloir tourne parfaitement rond, ce qui eft d’une
néceflité abfolue.
C ouronne , terme de Tourneur, piece qui s’ajufte
à l’extrémité de l ’arbre du tour figuré, & qui parlés
creux & fes reliefs, fait avancer & reculer cet arbre
félon fa longueur, par le moyen d’un reflort; enfor-
te que l’outil creufc plus OU moins la piece que l’on
tourne, & forme fur cette même piece des creux ou
des reliefs dépendans de ceux de la couronne : celle-
ci fait dans le fens de la longueur de l’axe du tour,
à-peu-près les mêmes effets que la piece appellée
rofette produit dans le fens perpendiculaire à l’axe.
Voyei T our f igu ré, Rosette. Article de M. de
la C ondamine.
Tome
COURONNÉ, ( Verrerie.) calote ou voûte ; partie
du fourneau de verrerie. Voye£ Verrerie.
COURONNÉ, adj. (Jard.) en fait d’arbres veut
dire mort & defféché; ce qui ne fe dit ordinairement
que de la cime d’un arbre : ces chênesJont couronnés.
7 Line fleur peut être couronnée, quand elle eft chargée
à fon fommet d’une couronne : tel eft le marra-
gon, la couronne impériale, &c. (K)
C ouronne, adj. (Maréchall.) On appelle cheval
couronné y celui qui s’eft emporté la peau des genoux
en tombant, de maniéré que la marque y refte.
Les chevaux couronnés ne font pas de vente, parce
qu’on les foupçonne d etre fujets à tomber fur les
genoux, ( y )
C ouronne , en termes de Blafony fe dit des lions,
des calques, & des autres choies qui ont une couronne.
y. le P. Menet. & le Dicl. de Trév.
Bournonville en Flandre , de fable au lion d’argent
, couronné d’or, armé & lampafle de même, la
queue fourchue & paflee en fautoir. (V )
* C ouronnées, (fiances) Belles-Lettres ; une fiance
eft couronnée, lorlque les mots qui forment la dernière
ou les deux dernieres fyllabes de chaque vers,
font exactement la derniere ou les .deux dernieres
fyllabes des mots qui les précèdent. Exemple : La
blanche- colombelle , belle , &c.
_ COURONNEMENT, f. m. (Hijl. mod.) cërérno
nie dans laquelle on place ta couronne fur les têtes
des fouverains.
C ouronnement , terme d>Architecture, ouvrage
de fculpture & d’architeClure, fervant à exhaufler
quelqu’avant corps qui doit prééminer dans l’ordonnance
d’un bâtiment, connu fous le nom à’amortijjc-
mènt. Voye{ Amortissement. Plufieurs auteurs
anciens ont appellé l’entablement couronnement, parce
que cette partie dans l’ArchiteClure eft confidé-
rée comme le couronnement de l’ordre, quoiqu’il foit
lui-même le.plus fouvent furmonté d’une baluftrade
ou d’un, attique. (P)
C ouronnement du C hemin ■ couvert
Art milit. eft dans l’attaque dés places, le logement
qu’on fait fur le haut des glacis, qui enferme ou couronne
toutes, les branches du chemin couvert du
front de l’attaque. (Q)
C ouronnement, ' (Marine.) c’eft 1a partie du
haut de 1a poupe, qui eft un ornèment de menuife-
rle & de fculpture pour l’embelliffement de l’arrie-
re. Voye^y Mar. PI. I l l . 'fig.' le deflein de 1a poupe
d’un vaifleau, oii le couronnement eft cotte N : ce
qui fuflit pour faire connoîtrë cette partie. (Z )
* C ouronnement, (Chirurgie.) Il n’y apoint de
partie du corps humain qui s’appelle ainfi ; c6eft une
pofition de l’enfant, lorl'qu’il eft fur le point de venir
au monde , dans laquëlle l’orifice de ta matrice
lui enibrafle ta tête.
COUROU, f. m. (Comm.) monnoie de compté
en Perfe. Le couroude roupies vaut cent mille laixs
de roupies, & le laix cent mille roupies.
COUROUK, f. m. ( Hijl. mod.) en Perfe fë dit
d’une défenie que le roi ou le fophi fait à différens
égards. On l’entend principalement de celle que le
prince fait à les fujets, de fe trouver fur le chemin
par- où.11 doit paflêr avec fes femmes. Ce qui eft
beaucoup plus rigoureux que le chelvet du ferrail :
car alors il faut q'ue tous' l’es hommes abandonnent
leurs mailons, & fuyent dans un quartier éloigné ou
à là campagne ; parce qu’il y a peine irrémiflible de
mort contre quiconque oferoit feulement regarder
les concubines du roi. Ces courouks font très-fré-
quéns, & extrêmement fâcheux à Ifpahan. Il y en
a d’une autre efpece qui ne le font guere moins : c’eft
quand le roi met un courouk fur la volaille , le poif-
Ion, ou autres denrées qui font de fon goût ; on n’o-
D d d ij