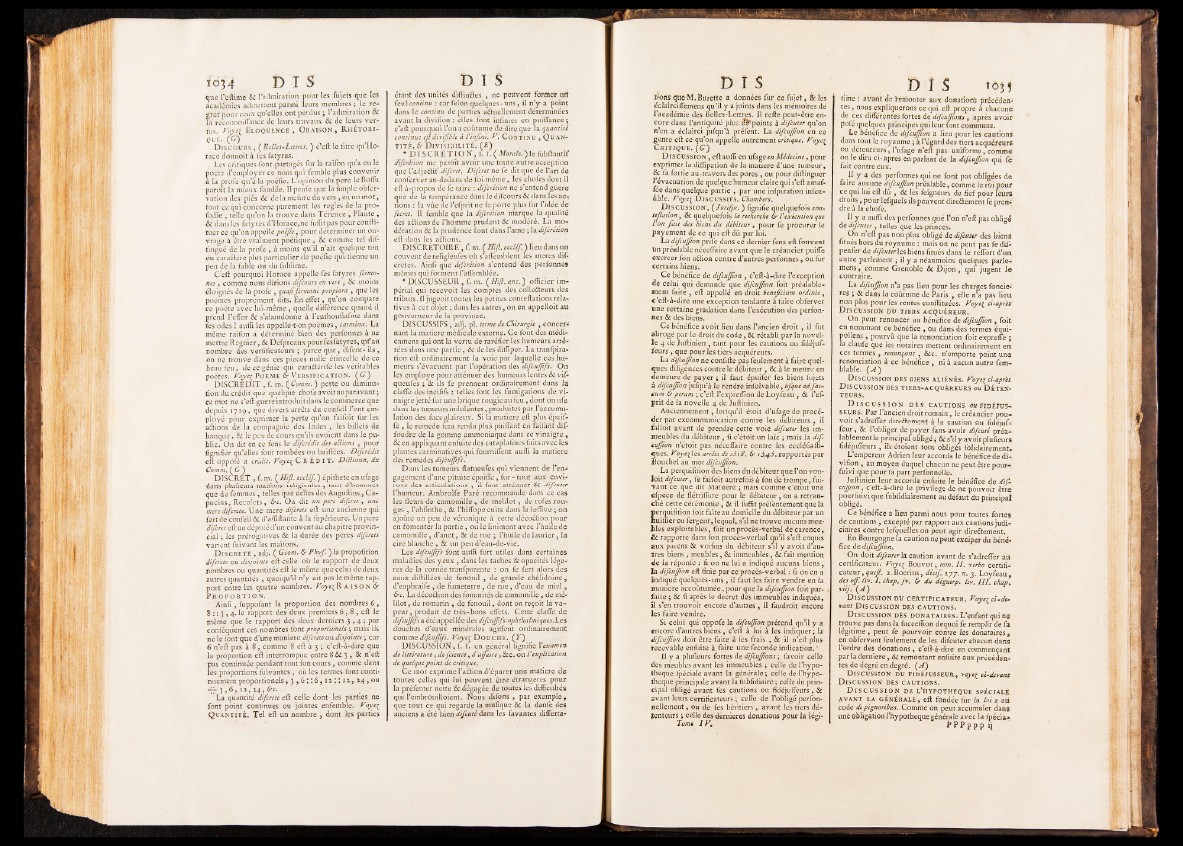
que M im e & l’admiration pour les fujets que les
académies admettent parmi leurs membres ; le regret
pour ceux qu’elles ont perdus ; l’admiration 8c
la reconnoiffance de leurs travaux & de leurs vertus
» Vôyt{ ÉLOQUENCE , ORAISON , R H É TO R I QUE.
( G ) Discours , ( Belles-Lettres. ) c’eft le titre qu’Ho-
race donnoit à Tes fatyres.
Les critiques font partagés fur la raifon qu’a eu le
poëte d’employer ce nom qui femble plus convenir
à la profe qu’à la poéfie. L’opinion du pere le Boflu
parait la mieux fondée. Il penfe que la fimple obfer-
vatiôn des piés & de la mefure du vers , en un mot,
tout ce qui concerne purement les réglés de la pro-
fodie , telle qu’on la trouve dans Térence , Plaute ,
& dans les fatyres d’Horace,ne fuffitpas pourconfti-
tuer ce qu’on appèlle poéfie, pour déterminer un ouvrage
à être vraiment poétique , & comme tel dif-
tingué de la profe , à moins qu’il n’ait quelque ton
Ou cara&ere plus particulier de poéfie qui tienne un
peu de la fable ou du fublime.
C’eft pourquoi Horace appelle fes fatyres (ermo-
nes y comme nous dirions difeours en vers , & moins
éloignés de la profe , quafifermoni propiora , que les
poëmes proprement dits. En effet, qu’on compare
ce poëte avec lui-même , quelle différence quand il
prend l’eflbr & s’abandonne à l’eothoufiafme dans
les odes ! aufli les appelle-t-on poëmes, carmina, La
même raifon a déterminé bien des perfbnnes à ne
mettre Regnier, & Defpreaux pour fes fatyres, qif au
nombre des .verfificateurs ; parce que, difent- ils ,
on ne trouve dans ces pièces nulle étincelle de ce
beau feu, de ce génie qui cara&érife les véritables
poètes, Voye^ Poeme o- Versification. ( G )
DISCREDIT , f. m. ( Comm. ) perte ou diminution
du crédit que quelque chofe avoit auparavant ;
ce mot ne s’eft guere introduit dans le commerce que
depuis .1719, que divers arrêts du confeil l’ont employé
pour exprimer la perte qu’on faifoit fur les
actions de la compagnie des Indes , les billets de
banque, & le peu de cours qu’ils avoient dans le public.
On dit en c i fens le diferédit des actions , pour
fignifier qu’elles font tombées ou baiffées. Diferédit
eft oppofe à crédit. Voye{ C r é d i t . Dictionn. du
Comm. ( G )
DISCRET , f. m. ( Hifi. eccléfi ) épithete en ufage
dans plufieurs maifons religieufes , tant d’hommes
que de femmes, telles que celles des Auguftins, Capucins,
Recolets , &c. On dit un pere diferet, une
mere difcrete. Une mere diferete eft une ancienne qui
fertde confeil & d’affiftante à la fupérieure. Un pere
diferet eft un député d’un couvent au chapitre provincial
; les prérogatives & la durée des peres diferets
varient fuivant les maifons.
DISCRETE , adj. ( Géom. & Phyf. ) la propofition
difcrete ou disjointe eft celle où le rapport de deux
nombres ou quantités eft le même que celui de deux
autres quantités , quoiqu’il n’y ait pas le même rapport
entre les quatre nombres. Voye^K aison & Proportion.
Ainfi , fuppofant la proportion des nombres 6 ,
5 : : 3 ,4 . le rapport des deux premiers 6 ,8 , eft le
même que le rapport des deux derniers 3 ,4 ; par
conféquent ces nombres font proportionels ; mais ils
ne le font que d’une maniéré difcrete ou disjointe ; car
6 n’eft pas à 8 , comme 8 eft à 3 ; c’eft-à-dire que
la proportion eft interrompue entre 8 & 3 , & n’eft
pas continuée pendant tout fon cours, comme dans
les proportions fuivantes , où les termes font conti-
nuement proportionels , 3 , 6 : : 6 , i z : : i i , z4 , ou
gf- 3 , 6 ,1 1,1 4 , &c.
La quantité difcrete eft celle dont Tes parties ne
font point continues ou jointes enfemble. V?yei Quantité. Tel eft un nombre , dont les parties
étant des unités diftinftes , ne peuvent former urî
feul continu : car félon quelques - uns, il n’y a point
dans le continu de parties aChiellemènt déterminées
avant la divifion : elles font infinies en puiflance ;
c’eft pourquoi l’on a coutume de dire que la quantité
continue ejl divijible à L'infini.TITÉ, & Divisibilité. (£) V. CONTINU , QUAN
♦ D IS C R É T IO N , f. f. ( Morale. ) le fubftantif
diferétion me parôît avoir une toute autre acception
que l’adjeclif diferet. Diferet ne fe dit que de l’art de
conferver au-dedans de foi-même, les ehofes dont il
eft à-propos de fe taire : diferétion ne s’entend guere
que de la tempérance dans le difeours & dans les actions
: la vue de l’efprit ne fe porte plus fur l’idée de
fecret. Il femble que la diferétion marque la qualité
des aCtions de l’homme prudent & modéré. La modération
& la prudence font dans l’ame ; la diferétion
eft dans les aCtions.
DISCRÉTOIRE, f. m. ( Hifi. eccléf. ) lieu dans un
couvent de religieufes oh s’affemblent les meres dif-
cretes. Ainfi que diferétion s’entend des perfonnes
mêmes qui forment ï’aflemblée.
* DISCUSSEUR, f. m. ( Hifi. ane. ) officier impérial
qui receyoit les comptes des colle&eurs des
tributs. Il jugeoit toutes les petites conteftations relatives
à cet objet ; dans les autres, on en appelloit au
gouverneur de la province*
DISCUSSIFS, adj. pl. terme de Chirurgie , concernant
la matière médicale externe. Ce font des médi-*
camens qui ont la vertu de raréfier les humeurs arrêtées
dans une partie, & de les diffiper. La tranfpira-
tion eft ordinairement la voie par laquelle ces humeurs
s’évacuent par l’opération des difeuffifs. On
les employé pour atténuer des humeurs lentes & vifi
queufes ; & ils fe prennent ordinairement dans I4
clafle-des incififs : telles font les fumigations de vinaigre
jetté fur une brique rougie au feu, dont on ufe
dans les tumeurs indolentes, produites par l’accumulation
des fucs glaireux. Si la matière eft plus épaif-
fe , le remede fera rendu plus puiffant en faifant di£
foudre de la gomme ammoniaque dans ce vinaigre ,
& en appliquant enfuite des cataplafmes faits avec les
plantes carminatives qui fourniffent auffi la matière
des remedes difeuffifs.
Dans les tumeurs flatueufes qui viennent de l’engagement
d’une pituite épaiffe , fur - tout aux environs
des articulations , il faut atténuer & difeuter
l’humeur. Ambroife Paré recommande dans ce cas
les fleurs de camomille , de melilot , de rofes rouges
, l’abfinthe, & l’hiffope cuits dans la leffive ; on
ajoute un peu de véronique à cette décoftion pour
en fomenter la partie, ou le Uniment avec l’huile de
camomille, d’anet, & de rue ; l’huile de laurier, la
cire blanche, & un peu d’eaurde-vie.
Les difeuffifs font aufli fort utiles dans certaines
maladies des yeux , dans les taches & opacités légères
de la cornée tranfparente : on fe fert alors des
eaux diftillées de fenouil , de grande chélidoine,
d’euphraife , de fumeterre, de rue, d’eau de miel ,
&c. La décoftion des fommités de camomille, de mé-
lilot, de romarin , de fenouil, dont on reçoit la vapeur,
produit de très-bons effets. Cette clafle de
difeuffifs a été appellée des difcujfifs-ophthalmiques.Les
douches d’eaux minérales agiffent ordinairement
comme difeuffifs. Voye^ Douche. (T )
DISCUSSION, f. f. en général fignifie Y examen
de littérature, de fcience, d'affaire , &c. ou l'explication
de quelque point de critique.
Ce mot exprime l’aâion d’épurer une matière de
toutes celles qui lui peuvent être étrangères pour
la préfenter nette & dégagée de toutes les difficultés
qui l’embrouilloient. Nous difons , par exemple,
que tout ce qui regarde la mufique & la danfe des
anciens a été bien difeuté dans les fayantes diflertalions
que M. Burette a données fur ce fujet, 8k les
èclairciflemens qu’il y a joints dans les mémoires de
l ’académie des Belles-Lettres. Il refte peut-être encore
dans l’antiquité plus appoints à difeuter qu’on
n’en a éclairci jufqu’à préfent. La difeuffion en ce
genre eft ce qu’on appelle autrement critique■, Voye^ CrDitique. (G) iscussion , eft auffi en ufage en Médecine, pour
exprimer la diffipatioh de la matière d’une tumeur,
& fa fortie au-travers des pores , ou pour diftinguer
l’évacuation de quelque humeur claire qui s’eft a maf-
fée dans quelque partie , par une infpiration infen-
fible. Voye{ Discussifs» Chambers» Discussion, ( Jurifpr» ) fignifie quelquefois côh-
tefiation, & quelquefois là recherche & Vexécution que
l'on fait des biens du débiteur , pour fe procurer le
payement de ce qui eft dû par lui.
La difeuffion prife dans ce dernier fens eft fouvent
lin préalable néceflaire avant que le créancier puifle
exercer fon aûion contre d’autres perfonnes, ou fur
certains biens.
Ce bénéfice de difeuffion , c*eft-à-dire l’exception
de celui qui demande que difeuffion foit préalablement
faite , eft appellé en droit beneficium ordinis,
c ’eft-à-dire une exception tendante à faire obferver
une certaine gradation dans l’exécution des perfonnes
& des biens.
Ce bénéfice avoit lieu dans l’ancien droit , il fut
abrogé par le droit du code, Sc rétabli par la novel-
le 4 de Juftinien , tant pour les cautions ou fidéjuf-
feurs , que pour les tiers acquéreurs.
La difeuffion ne confifte pas feulement à faire quelques
diligences contre le débiteur , & à le mettre en
demeure de payer ; il faut épuifer fes biens fujets
à difeuffion jufqu’à le rendre infoivâble, üfquc adfac-
cum & peram ; c’eft l’expreffion de Loyfeau , & l’efi
prit de la novelle 4 de Juftinien.
Anciennement, lorlqu’il étoit d’ufage de procéder
par excommunication contre les débiteurs , il
falloit avant de prendre cette voie difeuter les immeubles
du débiteur , fi c’étoit un laïc ; mais la difeuffion
n’étoit pas néceflaire contre les eccléfiafti-
ques. Voye^les arrêts de t5t8. & 1S4S. rapportés par
Bouchel aù mot difeuffion.
La perquifition des biens du débiteur que l’on vou-
loit difeuter, fe faifoit autrefois à fon de trompe, fuivant
ce que dit Mafuere ; mais comme c’étoit une
efpece de flétrifiùre pour le débiteur, on a retranché
cette cérémonie , & il fuffit préfentement que la
erquifition foit faite au domicile du débiteur par un
uiffierou fergent, lequel, s’il ne trouve aucuns meubles
exploitables, fait un procès-verbal de carence,
Sc rapporte dans fon procès-verbal qu’il s’eft enquis
aux païens & voifins du débiteur s’il y avoit d’au-
lres biens, meubles, & immeubles, & fait mention
de la réponfe : fi on ne lui a indiqué aucuns biens,
la difeuffion eft finie par ce procès-verbal : fi on en a
indiqué quelques-uns , il faut les faire vendre en la
maniéré accoutumée, pour que la difeuffion foit par- .
faite ; & fi après le decret des immeubles indiqués,
il s’en trouvoit encore d’autres , il faudrait encore
les faire vendre.
Si celui qui oppofe la difeuffion prétend qu’il y a
encore d’autres biens, c’eft à lui à les indiquer; la
difeuffion doit être faite à fes frais , & il n’eft plus
recevable enfuite à faire une fécondé indication. '
Il y a plufieurs fortes de difeuffions ; favoir celle
des meubles avant les immeubles ; celle de l’hypo-
theque fpéciale avant la générale ; celle de l’hypo-
theque principale avant la fubfidiaire ; celle du principal
obligé avant fes cautions ou fidéjufleurs , &
avant leurs certificateurs ; celle de l’obligé perfon-
nellement, ou de fes héritiers , avant les tiers détenteurs
; celle des dernieres donations pour la légi*
T om e i y %
timè : aVarit de Femonter aux donations précédentes,
nous expliquerons ce qui eft propre à chacune
de ces differentes fortes de difeuffions, après avoir
pofé quelques principes qiiileUr font communs.
Le bénéfice de difeuffion a lieu pour les cautions
dans tout le royaume ; à l’égard des tiers acquéreurs
ou détenteurs, l’ufage n’eft pas uniforme, comme
on le dira ci-après en parlant de la difeuffion qui fe
fait contre eux.
II y a des perfonnes qui né font pas obligées de
faire aucune difeuffion préalable, comme le roi pour
ce qui lui eft dû , & les feignéurs de fief pour leurs
droits, pour lefquels ils peuvent directement fé pren-,
dre à la chofe.
Il y a auffi des perfonnes que l’on ri’eft pas obligé
de difeuter y telles que les princes.
On n’eft pas non plus obligé de difetiter des biens
fitués hors du royaume : mais ôn ne peut pas fe dif-
penfer de difeuter les biens fitués dans le reflortd’un
autre parlement ; il y a néanmoins quelques parler
ftiens, comme Grenoble & Dijon, qui jugent le
contraire.
La difeuffion n’a pas lieu pour les charges foncières
; & dans la coûtumé de Paris , elle n’â pas lieu
non plus pour les rentes conftituées. Voye{ ci-après
D i s c u s s i o n d u t i e r s a c q u é r e u r .
On peut renoncer au bénéfice de difeuffion, foit
en nommant ce bénéfice , ou dans des termes équi-
pollens , pourvû que la renonciation foit exprefle ;
la claufe que lés notaires mettent ordinairement en
ces termes , renonçant , &c. n’emporte point une
renonciation à ce bénéfice , ni à aucun autre fem-
blable. ( ^ )
D i s c u s s i o n d e s b i e n s a l i é n é s . Voyc7^ci-après
D i s c u s s i o n d e s t i e r s - a c q u é r e u r s © « D é t e n t
e u r s .
D i s c u s s i o n d e s c a u t i o n s ou f id é j u s -
s e u r s . Par l ’ancien droit romain, le créancier pouvoir
s’adrefler directement à la caution ou fidéjuf*
feur, & l’obliger de payer fans-avoir difeuté préalablement
le principal obligé ; & s’il y avoit plufieurs
fidejufleurs , ils etoient tous obligés Solidairement*
L’empereur Adrien leur accorda le bénéfice de di-»
vifion, au moyen duquel chacun ne peut être pour*
fuivi que pour fia part perfonnelle.
Juftinien leur accorda enfuite le bénéfice de difeuffion
, c’eft-à-dire le privilège de ne pouvoir être
pourfuivique fubfidiairement au défaut du principal
obligé*
Ce bénéfice a lieu parmi nous pour toutes fortes
de cautions , excepté par rapport aux cautions judi*
ciaires contre lefquelles on peut agir directement.
En Bourgogne la caution ne peut exeiper du bénéfice
de difeuffion»
On doit difeuter là caution avant de s’adrefler au
certificateun Voye^ Bouvot, tom. II. verbo certifia
cateur, quefi. 2. Boerius, décif. %yy. ni 3. Loyfeau ,
dés off. lii>, ƒ, chap. jv-, & du déguerpi liv. III. çhap»
viiji {A )
D i s c u s s i o n d u c e r t i f i c a t e u r . Voye{ci-de*
vant D i s c u s s i o n d e s c a u t i o n s .
D i s c u s s i o n d ë s d o n a t a i r e s . L’enfant qui ne
trouve pas dans la fucceffion dequoi fe remplir de fà
légitime, peut fe pourvoir contre les donataires,
en obfervant feulement de les difeuter chacun dans
l’ordre des donations, c’eft-à-dire en commençant
par la derniere, 6c remontant enfuite aux précéden-*
tes de degré en degré. (Â )
D i s c u s s i o n d u f i b é j u s s e u r , voye^ ci-devant
D i s c u s s i o n d e s c a u t i o n s *
D i s c u s s i o n d e l ’h y p o t h e q u e s p é c i a l e
a v a n t l a g é n é r a l e , eft fondée fur la loi 2 ati
code de pignoribus. Comme on peut accumuler dan9
une obligation l’hypotheque générale avec la fpéeia*
t p î >p p p ij