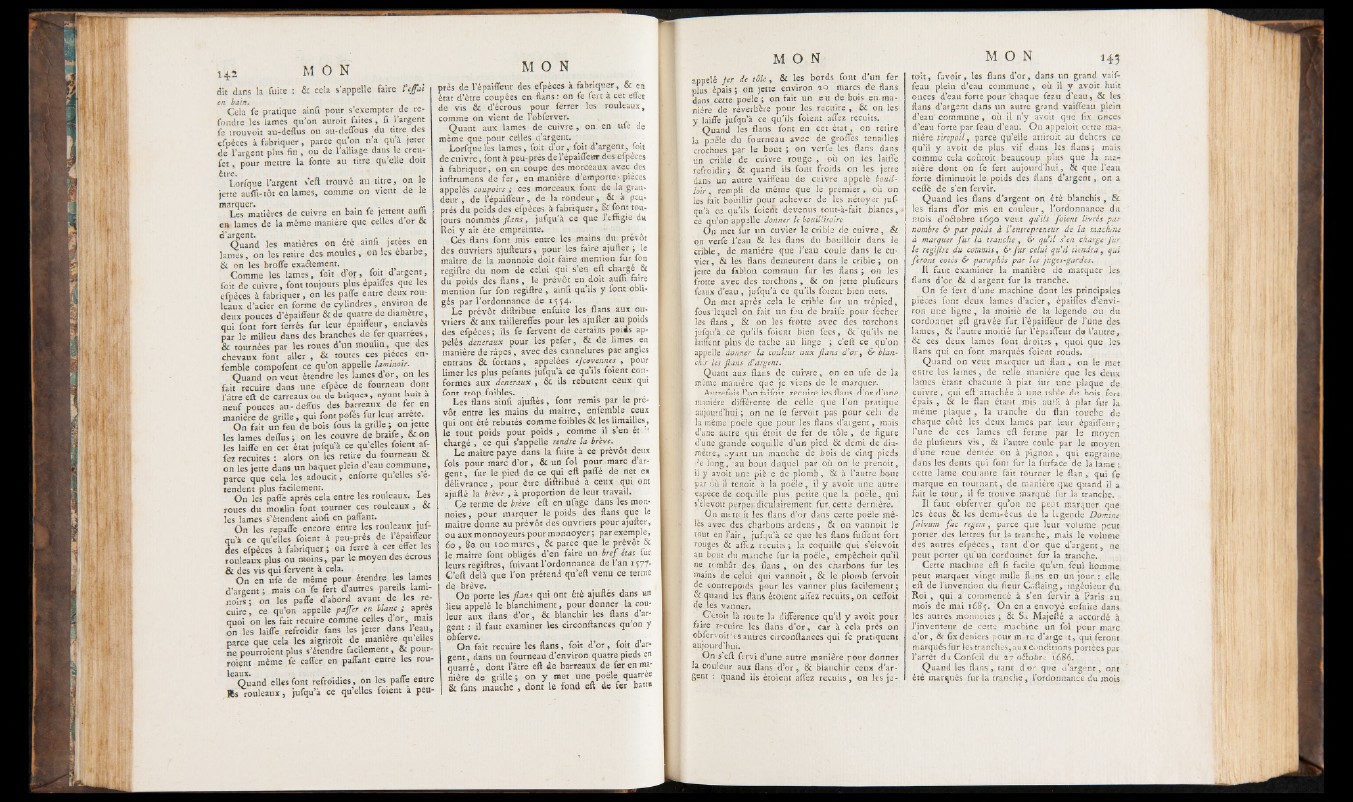
dit dans la fuite : & cela s’appelle faire Vctf.ù
en bain.
Cela fe pratique ainfi pour s’exempter de refondre
les lames qu’on auroit faites, fi l’argent
fe irouvoit au-deffus ou au-deffous du titre des
efpèces à fabriquer, parce qu’on n a qu’à jeter
de l’argent plus fin, ou de l’alliage dans le creu-
f e t , pour mettre la fonte au titre qu’elle doit
être. H H .
Lorfque l’argent s’eft trouve au titre, on le
jette aufli-tôt en lames, comme on vient de le
marquer. . . -
Les matières de cuivre en bain fe jettent aulh
en lames de la même manière que celles d’or &
d’argent. . . ,
Quand les matières on ete ainfi jetees en
lames, on les retire des moules, on les ébarbe,
& on les broffe exactement.
Comme les lames, foit d’o r , foit d argent,
foit de cuivre, font toujours plus épaiffes que les
efpèces à fabriquer, on les paffe entre deux rouleaux
d’acier en forme de cylindres, environ de
deux pouces d’épaiffeur & de quatre de diamètre,
qui font fort ferrés fur leur épaifleur, enclavés
par le milieu dans des branches de fer quarrees,
& tournées par les roues dun moulin, que des
chevaux font aller , & toutes ces pièces en-
femble compofent ce qu’on appelle laminoir.
Quand on veut étendre les lames d o r , on les
fait recuire dans une efpèce de fourneau dont
l’âtre eft de carreaux ou de briques, ayant huit a
neuf pouces au - deffus des barreaux de fer en
manière de grille, qui font pofes fur leur arrête.
On fait un feu de bois fous la grille ; on jette
les lames deffus ; on les couvre de braife, & on
les laiffe en cet état jufqu’à ce qu elles foient af-
fez recuites : alors on les retire du fourneau oc
on les jette dans un baquet plein d eau commune,
parce que cela les adoucit, enforte qu elles s e-
tendent plus facilement.
On les paffe après cela entre les rouleaux. Les
roues du moulin font tourner ces rouleaux , &
les lames s’étendent ainfi en paffant. #
On les repaffe encore entre les rouleaux jul-
qu’à ce qu’elles foient à peu-près de l’épaiffeur
des efpèces à fabriquer ; on ferre a cet effet les
rouleaux plus ou moins, par le moyen des écrous
& des vis qui fervent à cela.
On en ufe de même pour étendre les lames
d’a rg en tm a is on fe fert d’autres pareils laminoirs
; on les paffe d’abord avant de les recuire,
ce qu’on appelle pajfer en blanc ; apres
quoi on les fait recuire comme celles d’or , mais
on les laiffe refroidir fans les jeter dans l’eau,
parce que cela les aigriroit de maniéré qu elles
ne pourroient plus s’étendre facilement, & pour-
roiçnt même fe caffer en paffant entre les routeaux.
§ ' -
Quand elles font refroidies, on les paffe entre
%s rouleaux, jufqu’à ce qu’elles foient à peuprès
de l’épaiffeur des efpèces à fabriquer, & en
état d’être coupées en flans : on fe fert à cet effet
de vis & d’écrous pour ferrer les rouleaux,
comme on vient de l’obferver.
Quant aux lames de cuivre, on en ufe de
même que pour celles d’argent.
Lorfque les lames, foit d o r f o i t d’argent, foit
de cuivre, font à.peu-près de l’èpaiffenr des efpèces
à fabriquer, on en coupe des morceaux avec des
inftrumens de fer, en manière d’emporte-pièces
appelés coupoirs ,* ces morceaux font de .la,grandeur
, de l’épaiffeur, de la rondeur, & à peu-
près du poids des efpèces à fabriquer, & font toujours
nommés flans,, jufqu’à ce que l’effigie dut
Roi y ait été .empreinte. - ;
Ces flans font mis entre les mains du prévôt
des ouvriers ajufteurs, pour les faire ajufter ; le
maître de la monnoie doit faire mention fur fon
regiftre du nom de celui qui s’en eft chargé &
du poids des flans, le prévôt en doit aufli faire
mention fur fon regiftre , ainfi qu ils y font obli*
; gés par l’ordonnance de 1554-
j Le prévôt diftribue enfui te les flans aux ouvriers
& aux taillereffes pour les ajufter au poids
des efpèces ; ils fe fervent de certains poids appelés
deneraux pour les pefer, & de limes en
manière de râpes, avec des cannelures par angles
entrans & fortans, appelées tfeovennes , pour
limer les plus pefants julqu’à ce qu’ils foient conformes
aux deneraux , & ils rebutent ceux qui
font trop foibles. t
Les flans ainfi ajuftés, font remis par le prévôt
entre les mains du maître, enfemble ceux
qui ont été rebutés comme foibles 3c les limailles t
le tout poids pour poids , comme il s en ét
chargé , ce qui s’appelle rendre la brève.
Le maître paye dans la- fuite à ce prévôt deux
fols pour marc d’o r , & un fol pour. marc d argent
, fur le pied de ce qui eft paffé de net en
délivrance, pour être difttibue a ceux qui ont
ajufté la brève,, à proportion de leur travail.
Ce terme d« brève eft en ufage dans les mon-
noies, pour marquer le poids des flans que le
maître donne au prévôt des ouvriers pour ajufter,
ou aux monnoyeurs pour monnoyer ; par exemple,
6 0 ,8 0 ou 100marcs, 3c parce que le prévôt &
le maître font obligés d’en faire un bref état fur
leurs regiftres, fuivant l’ordonnance de 1 an 1577*
C ’eft delà que l’on prétend qu’eft venu ce terme
dq brève.
On porte les flans qui ont été ajuftés dans un
lieu appelé le blanchiment, pour donner la couleur
aux flans-d’o r , 3c blanchir les flans d’argent
: il faut examiner les circonftances qu’on y
obferve. |
On fait recuire les flans, foit d’o r , foit d argent
, dans un fourneau d’environ quatre pieds en
quarré, dont l’âtre eft de barreaux de fer en manière
de grille ; on y met une poêle q u a r r é e
& fans manche , dont le fond eft de fer battu
M O N
appelé fer de tôle, & les bords font d'un fer
plus épais ^ on jette environ 20 marcs de flans
dans cette poêle ; on fait un eu de bois en.manière
de réverbère pour les recuire , 8c on les
y laiffe jufqu’à ce qu’ils foient affez recuits.
'Quand les flans font en cet état, on retire
la poêle du fourneau avec de groffes tenailles
crochues par le bout ; on verfe les flans, dans
un crible de cuivre rou ge , où on les laiffe
refroidir; & quand ils font froids on les jette
dans un autre vaifl’eau de cuivre appelé boiùl-
îoir\ rempli de même que le premier, où on
les fait bouillir pour achever de les nétoyer jufqu’à
ce qu’ils foient devenus tout-à-fait blancs,
ce qu’on appelle donner le bouülitoire
On met fur un cuvier le crible de cuivre, &
on verfe l’eau & les flans du bouilloir dans le
crible, de manière que l’eau coule dans le cuvier,
& les flans demeurent dans le crible; on
jette du fiiblqn commun fur les flans ; on les
frotte avec des torchons , & on jette plufieurs
féaux d’eau , jufqu’à ce qu’ils foienrbien nets.
On met après cela le crible fur un trépied,
fous lequel on fait un feu de braife pour fécher
les flans , & on les frotte avec des torchons
jufqù’à.ce qu’ils foient bien fecs, 3c' qu’ils ne
laiffent plus de tache au linge ; c’eft ce qu’on
appelle donner la couleur aux flans d’or, & blanchir
les flans d'argent.
Quant aux flans de cuivre, on en ufe de la
même manière que je viens de le marquer.
Autrefois l’on faifoit recuire les flans d’or d'une
manière différente de celle que l’on pratique
aujourd’hui;, on ne fe fervoit pas pour cela de
la même poêle que pour les flans d’argent, mais
d’une autre qui étoit de fer de tôle, de figure
d’une grande coquille d’un pied & demi de diamètre,
ayant un manche de bois de cinq pieds
de long, au bout duquel par où on le prenoit,
il y avoit uns piè e de plomb, & à l’autre bout
par où il tenoit à la poêle, il y avoit une autre
espèce de coquille plus petite que la poêle, qui
s’élevoit perpendiculairement fin\ cette dernière.
On me rtc it les flans d’oj* dans cette poêle mêlés
avec des charbons ardens, & on vannoit le
tout en l’air, jufqu’à ce que les flans fuffent fort
rouges & affez recuits; la coquille qui s’élevoit
au bout du manche fur la poêle, empêchoit qu’il
ne tombât des flans , ou des charbons fur les
mains de celui qui vannoit , & le plomb fervoit
de contrepoids pour les vanner plus facilement;
& quand les flans étoient affez recuits, on ceffoit
de les vanner.
O’étoit ià toute la différence qu’il y avoit pour
^a*re recuire les flans d’o r , car à cela près on
©bferveit'es autres circonftances qui fe pratiquent
aujourd’hui.
On s’eft fervi d’une autre manière pour donner
la couleur aux flans d’o r , & blanchir ceux d’argent
: quand ils étoient affez recuits, on les je-
M O N 143
toit, favoir, les flans d’o r , dans un grand vaif-
feau plein d’eau commune, où il y avoit huit
onces d’eau forte pour chaque feau d’eau, & les
flans d’argent dans un autre grand vaiffeau plein
d’eau'commune, où il n’y avoit que fix onces
d’eau forte par feau d’eau. On appeloit cette manière
tirepoil, parce qu’elle attiroit au dehors ce
qu’il y avoit de plus vif dans les flans ; mais
comme cela coûtoit beaucoup plus que la manière
dont on fe fert aujourd'hui, & que l’eau
forte diminuoit le poids des flans d’argent, on a
ceffé de s’en fervir.
Quand les flans d’argent on été blanchis, 8c
les flans d’or mis en couleur, l’ordonnance du
mois d’oâobre 1690 veut qiiils foient livrés par
nombre 6* par poids à Ventrepreneur de la machine
à marquer fur la tranche , & qiüil s'en charge fur
le regiftre du commis, & fur celui qu'il tiendra, qui
feront cotés & paraphés par les juges-gardes. .
Il faut examiner la manière de marquer les
flans d’or & d argent fur la tranche.
On fe fert d’une machine dont les principales
pièces font deux lames d’acier, épaiffes d’environ
une ligne, la moitié de la légende ou du
cordonnet eft gravée fur. l’épaiffeur de l’une des
lames, & l’autre moitié fur l’épaiffeur d» l’autre,
& ces deux lames font droites , quoi que les
flans qui en font marqués foient ronds.
Quand on veut marquer un flan , on le met
entre les lames, de telle manière que les deux
lames étant chacune à plat fur une plaque de
cuivre, qui eft attachée à une table de bois fort
épars , & le flan étant mis au (fi à plat fur la
même plaque , la tranche du flan touche de
chaque côté les deux lames, par leur épaiffeur ;
l’une de ces lames eft ferme par le moyen
de plufieurs v is , & l’autre coule par le moyen
d’une roue dentée on à pignon, qui engraine,
dans les dents qui font fur la furface de la lame :
cette lame coulante fait tourner le flan, qui fe
marque en tournant, de manière que quand il a
fait le tour, il fe trouve marqué fur ,1a tranche.
Il faut obferver qu’on ne peut marquer que
les écus & les demi-écus de la kgencle Domine
falvum fac regern, parce que leur volume peut
porter des lettres fur la tranche, mais le volume
des autres efpèces, tant d'or que d’argent, ne
peut porter qu’un cordonnet fur la tranche.
Cette machine eft fi facile qu’un, feul homme
peut marquer vingt mille fl.-ns en un jour : elle
eft de l’invention du fleur Caftaing, ingénieur du
Roi , qui a commencé à s’en fervir à Paris au
mois de mai 1685. On en a envoyé enfuite dans
les autres monnoies ; & Sa Majefté a accordé à
,1’inventeur de cette machine un fol pour marc
d’or, & fix deniers pour m rç d’argent, qui, feront
marqués fur les tranches, aux. conditions portées par
l’arrêt du Confeil du 27 oefobr-j 1686..
Quand les flans,, tant d or que d’argent, ont
été marqués fur la tranche, l’ordonnance du mois