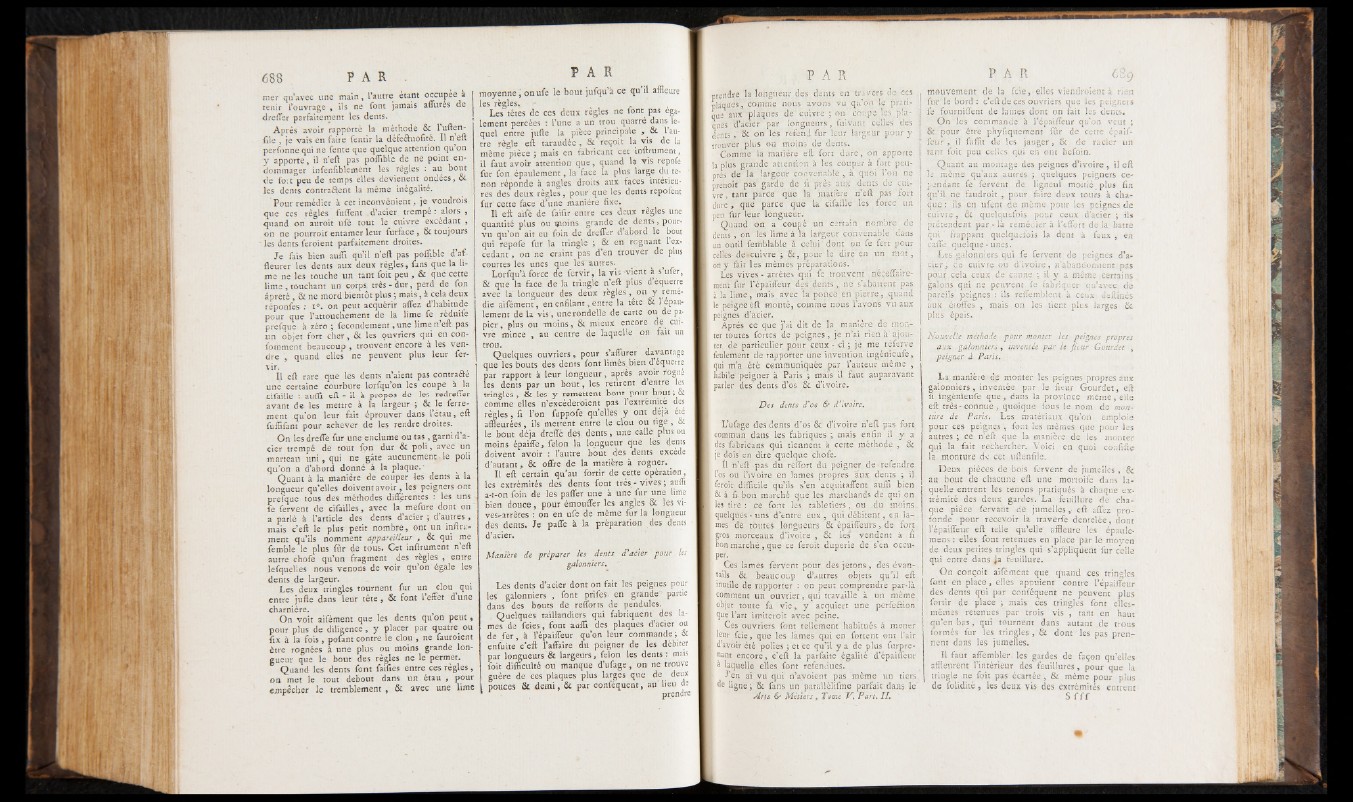
688 P A R .
mer qu’avec une main, l’autre étant occupée a
tenir l’ouvrage , ils ne font jamais affurès de
dreffer parfaitement les dents.
Après avoir rapporté la méthode & 1 uften-
£le , je vais en faire fentir la défeéluofité. Il n eft
perfonne qui ne fente que quelque attention qu on
y apporte, il n’eft pas poflible de ne point endommager
infenfiblement les règles : au bout
de fort peu de temps elles devienent ondees, &
les dents contrarient la même inégalité.
Pour remédier à cet inconvénient, je voudrois
que ces règles fuffent d’acier trempé : alors ,
quand on auroit ufé tout le cuivre excedant ,
on ne pourroif entamer leur furface , & toujours
les dents feroient parfaitement droites.
Je fais bien aufli qu’il n’eft pas poflible d affleurer
les dents aux deux règles, fans que la lime
ne les touche un tant foit peu , & que cette
lime , touchant un corps, très - dur, perd de fon
âpreté , & ne mord bientôt plus ; mais, à cela deux
réponfes : i°. on peut acquérir affez d’habitude
pour que l’attouchement de la lime fe réduife
prefque à zéro ; fecondement, une lime n eft pas
un objet fort cher, & les ouvriers qui en con-
fomment beaucoup , trouvent encore a les vendre
, quand elles ne peuvent plus leur fer-
vir. ,
Il eft rare que les dents n’aient pas contracte
une certaine courbure lorfqu’on les coupe à la
cifaille : aufll eft - il à propos de les redreffer
avant de les mettre à la largeur ; &^le ferrement
qu’on leur fait éprouver dans 1 étau, eft
fuffifant pour achever de les rendre droites.
On les dreffe fur une enclume ou tas , garni d a-
cier trempé de tout fon dur & poli, avec un
marteau uni, qui ne gâte aucunement• le poli
qu’on a d’abord donné -à la plaque.'
Quant à la manière de couper les dents à la
longueur qu’elles doivent avoir , les peigners ont
prefque tous des méthodes différentes : les uns J
fe fervent de cifàilles, avec la mefure dont on
a parlé à l’article des dents d’acier ; d’autres,
mais c’eft le plus petit nombre, ont un inftri>
ment qu’ils nomment appareïlleur , & qui me
femble le plus fûr de tous. Cet infiniment n’eft
autre chofe qu’un fragment des règles , entre
lefquelles nous venons de voir qu’on égale les
dents de largeur.
Les deux tringles tournent fur un clou ( qui
entre jufte dans leur tête, & font l’effet d une
charnière.
On voit aifément que les dents qu on peut,
pour plus de diligence, y placer par quatre ou
fix à la fois, pofant contre le clou , ne fauroient
être rognées à une plus ou moins grande longueur
que le bout des règles ne le permet.
Quand les dents font faifies entre ces règles,
on met le tout debout dans un etau , pour
empêcher le tremblement, & avec une lime
P A R
moyenne \ on ufe le bout jufqu’à ce qu il affleure
les règles. •'
Les têtes de ces deux règles ne font pas également
percées l’une a un trou quarrè dans^ lequel
entre jufte la pièce principale , & l’autre
règle eft taraudée, & reçoit la vis de la
même pièce ; mais en fabricant cet instrument,
il faut avoir attention que, quand la vis repofe
fur fon. èpaulement, la face la plus large du tenon
réponde à angles droits aux faces intérieures
des deux règles, pour que les dents repofent
fur' cette face d’une manière fixe.
Il eft aifé de faifir entre ces deux réglés une
quantité plus ou îjioins grande de dents, pourvu
qu’on ait eu foin de dreffer d’abord le bout
qui repofe fur la tringle ; & en rognant 1 ex- .
cedant, on ne craint pas d’en trouver de plus
courtes les unes que les autres.
Lorfqu’à force de fervir, la vis 'vient à sufer,
& que la face de la tringle n’eft plus d’équerre
avec la longueur des deux règles ,^on y remédie
aifément, en enfilant, entre la tete & 1 epau-
lement de la v is , une rondelle de carte ou de papier
, plus ou moins, & mieux encore de^ cuivré
mince , au centre de laquelle on fait un
trou.
Quelques ouvriers, pour s’affurer davantage
que les bouts des dents font limes^bien d equerre
par rapport à leur longueur, après avoir rogne
les dents par un bout, les retirent d entre les
tringles, &Jes y remettent bout pour boùt;&
comme elles n’excéderoient pas l’extrémité des
règles, fi l’on fuppofe qu’elles y ont déjà été
affleurées, ils mettent entre le clou ou tige , &
le bout déjà dreffé des dents , une càlle plus ou
moins épaiffe, félon la longueur que les dents
doivent avoir : l’autre bout des dents excede
d’autant, & offre de la matière à rogner.
Il eft certain qu’au fortir de cette opération,
les extrémités des dents font très - vives ; aufli
a-t-on foin de les paffer une à une fur une lime
bien douce, pour émouffer les angles & les vi-
ves-arrêtes : on en ufe de même fur la longueur
des dents. Je paffe à la préparation des dents
d’acier.
Manière de préparer les dents d’acier pour les
galonniers.
Les dents d’acier dont on fait les peignes pour
les galonniers , font prifes. en grande1 partie
dans des bouts de refforts de pendules.
Quelques taillandiers qui fabriquent des la-1
mes de fcies, font aufli des plaques d’acier ou
de / e r , à l’épaiffeur qu’on leur commande ; &
enfuite c’eft l’affaire du peigner de les débiter
par longueurs & largeurs, félon les dents: mais
foit difficulté ou manque d’ufage, on ne trouve
guère de ces plaques plus larges que de deux
pouces & demi, & par conféquent, au’ lieu de
prendre
P A R
prendre la longueur des dents en travers de ces
plaqués, comme nous avons vu qu’on le pratique
aux plaques de cuivre ; on coupe les plaques
’d’acier par longueurs, fulvant celles des ■
dents, & on lés refend fur leur largeur pour y
trouver plus ou moins de dents.
Comme la matière eft fort dure, on apporte
la plus grande attention à tes couper à fort peu-
prés de la largeur convenable , à quoi l’on ne
prenoit pas garde de fi près aux dents de cuivre,
tant parce que la matière n’eft pas fort
dure, que parce que la cifaille les force un
peu fur leur longueur.
Quand on a coupé' un certain nombre de
dents, on les lime à la largeur convenable dans
un outil femblable à celui dont on fe fert pour
celles de*cuivre ; & , pour le dire en un mot ,
on y fait les mêmes préparations.1
Les vives - arrêtes qui fe .trouvent néçeffaîre-
ment fur 1’épaiffeur des.dents , ne s’abattent pas
à la lime, mais,avec la poncé en pierre, quand
le peigne éft monté, comme nous l’avons vu aux
peignes d’acier.
Après ce que j’ai dit de la manière de monter
toutes fortes de peignes, je n’ai rien à ajouter
de particulier p.our ceux - ci ; je me réferve
feulement de rapporter une invention ingénieufe,
qui m’a été communiquée par l’auteur même ,
habile peigner à Paris ; mais il faut auparavant
parler des dents d’ôs & d’ivoire.
Des dents d’os & d’ ivoire.
L’ufage des dents d’os & d’ivoire n’eft pas fort,
commun dans les fabriques ; mais enfin il y a
: des fabricans qui tiennent à cette méthode , &
je dois en dire quelque chofe.
Il n’eft pas du reffort du peigner de refendre
l’os ou l’ivoire en lames propres aux dents ; il
feroir difficile qu’ils s’en acquitaffent aufli bien
& à fi-bon marché que les marchands de qui on
I les tire : ce font les tabietiers, ou du moins.
[ quelques - uns d’entre eux , qui débitent, en la-
| mes de toutes longueurs & épaiffeurs, de fort
| gros morceaux d’ivoire , & les vendent à fi
[ Bon marché , que ce feroit düperie de s’en occu-
I Per-
Ces lames fervent pour des jetons, des évan-,
I tails & beaucoup d’autres objets qu’il eft
1 inutile de rapporter : on peut comprendre par-là
comment un ouvrier , qui travaille à un même
objet toute fa v ie , y acquiert une perfeérion
que l’art imiteroit avec peine.
Ces ouvriers font tellement habitués à mener
leur fcie, que les lames qui en fortent ont l’air
d’avoir été polies ; et ce qu’il y a de plus furpre-
uant encore, c’eft la parfaite égalité d’épaiffeur
a laquelle elles font refendues.
J’en ai vu qui n’ayoient pas même un tiers
de ligne ; & fans un parallélifmé parfait dans le'
Ans 6* Métiers, T »me V. Part. II.
P A R 689
mouvement de la fcie,- elles viendroient à rien
fur le bord : c’eft de ces ouvriers que les peigners
fe fourniflent de lames dont on fait les dents.
On les commande à l’épaiffeur qu’on veut ;
& pour être phyfiquement fûr de cetre épaif-
feur , il fuffit de les jauger, .& de racler un
tant foit peu celles qui en ont befoin.
Quant au montage des peignes d’ivoire , il eft
le même qu’aux autres ; quelques peigners cependant
fe fervent de ligneul moitié plus fin
qu’il ne faudroit , pour faire deux tours à chaque
: ils en ufent de même pour les peignes de
cuivre , & quelquefois pour ceux d’acier ; ils
prétendent p a r l à remédier à l’effort de la batte
qui frappant quelquefois la dent à faux , en
çaffe quelque - unes.
• Les galonniers qui fe fervent de peignes d’acier
, de cuivre ou d'ivoire, n’abandonnent pas
pouf cela ceux de canne ; il y a même cerrains
galons qui ne peuvent fe fabriquer qu’avec de
pareils peignes : ils reffemblent à ceux deftinés
aux étoffes , mais on les tient plus larges &
plus épais.
Nouvelle méthode\ pour monter les peignes propres
a u x galonniers y inventée par le Jicur Gourdet ,
peigner à Paris.
La manière dp monter les peignes propres aux
galonniers, inventée par le fleur Gourdet, eft
fi ingénieufe que, dans la province même, elle
eft très - connue, quoique fous le nom de monture
dé Paris. Les matériaux qu’on emploie
pour ces peignes ", font les mêmes que pour les
autres ; ce n’eft que la manière de les monter
qui la fait rechercher. Voici en quoi confifte
la monture de cet uftenfiie.
Deux pièces de bois fervent de jumelles , &
au bout de chacune eft une mortoife dans laquelle
entrent les tenons pratiqués à chaque extrémité
des deux gardes. La feuillure de chaque
pièce fervan't de jumelles eft affez profonde
pour recevoir la traverfe dentelée, dont
répaiffeur eft telle qu’elle affleure les épaule-
mens ï elles font retenues en place par le moyen
de deux petites tringles qui s'appliquent fur celle
qui entre dans Ja feuillure.
On conçoit aifément que quand ces tringles
font en place, elles appuient contre l’épaifleur
des dents qui par conféquent ne peuvent plus
fortir de place ; mais ces tringles font elles-
mêmes retenues par trois vis , tant en haut
qu’en bas, qui tournent dans autant de trous
formés fur les tringles, & dont les pas prennent
dans les jumelles.
Il faut affembler les gardes de façon qu’elles
affleurent l’intérieur des feuillures, pour que la
tringle ne foit pas écartée , & même pour plus
de iolidité, les deux vis des extrémités entrent
S f f f