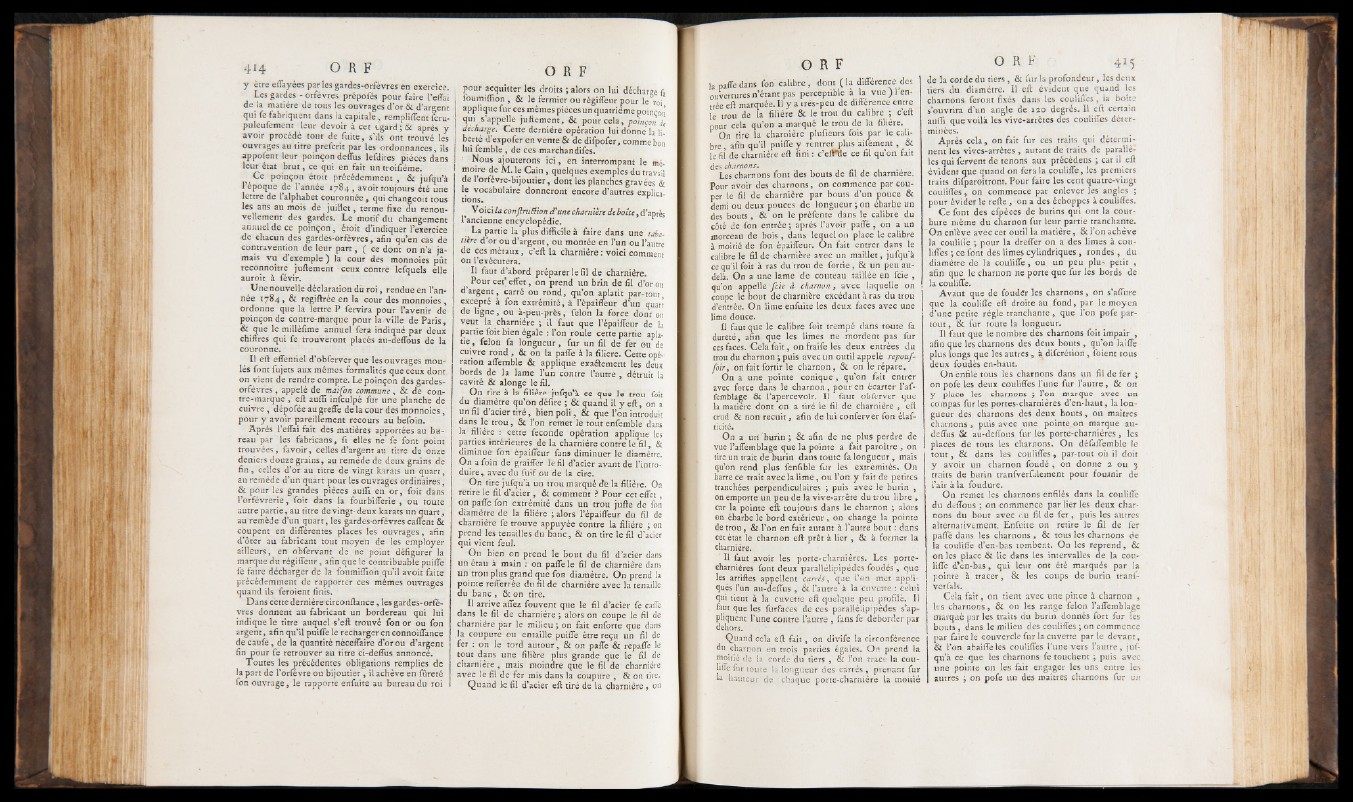
y être effayées parles gardes-orfèvres en exercice.
Les gardes - orfèvres prépofés pour faire l’effai
de la matière de tous les ouvrages d’or & d’argent
qui Ce fabriquent dans la capitale, rempliffent fcru-
puleufemenc leur devoir à cet egard ; & après y
avoir procédé tout de fuite, s’ils ont trouvé lès
ouvrages au titre prefcrit par les ordonnances, ils
appofent leur poinçon deflus lefdires pièces dans
leur état brut, ce qui en fait un troiûème.
Ce poinçon étoit précédemment , & jufqu'à
l’époque de l’année 1784 , avoit toujours été une
lettre de l’alphabet couronnée, qui changeoit tous
les ans au mois de juillet, terme fixe du renouvellement
des gardes. Le motif du changement
annuel de ce poinçon, étoit d’indiquer l’exercice
■ de chacun des gardes-orfèvres, afin qu’en cas de
contravention de leur part, | ce dont on n’a jamais
vu d’exemple ) la cour des monnoies pût
reconnoître juftement ceux contre lefquels elle
auroit à févir.
Une nouvelle déclaration dii roi, rendue en l’année
1784 , & regiftrée en la cour des monnoies -,
ordonne que la lettre P fervira pour l’avenir de
poinçon de contre-marque pour la/ville de Paris,
& que le milléfime annuel fera indiqué par deux
chiffres qui fe trouveront placés au-deffous de la
couronne.
Il eft effentiel d’obferver que les ouvrages moulés
font fujets aux mêmes formalités que ceux dont
on vient de rendre compte. Le poinçon des gardes-
orfèvres , appelé de maifon commune, & de contre
marque , eft auffi inlculpé fur une planche de
cuivre , dépofée au greffe de la cour des monnoies,'
pour y avoir pareillement recours au befoin.
Après l’effai fait des matières apportées au bureau
par les fabricans, fi elles ne fe font point
trouvées, favoir, celles d’argent au titre de onze
deniers douze grains, au remède de deux grains de
fin, celles d’or au titre de vingt karats un quart,
au remède d’un quart pour les ouvrages ordinaires,
& pour les grandes pièces aufli en or, foit dans
l’orfèvrerie, foit dans la fourbifferie , ou toute
autre partie, au titre de vingt-deux karats un quart,
au remède d’un quart, les gardes-orfèvres caftent &
coupent en différentes places les ouvrages, afin
d’ôter au fabricant tout moyen de les employer
ailleurs, en obfervant de ne point défigurer la
marque du régiffeur, afin que le contribuable puiffe
fe faire décharger de la foumiftion.qu’il avoit faite
précédemment de rapporter ces mêmes ouvrages
quand ils feroient finis.
Dans cette dernière!circonftance, les gardes-orfé-
vres donnent au fabricant un bordereau qui lui
indique le titre auquel s’eft trouvé fon or ou fon
argent, afin qu’il puiffe le recharger en connoiffance
de caufe, de la quantité néceffaire d’or ou d’argent
fin pour fe retrouver au titre ci-deffus annoncé.
Toutes les précédentes obligations remplies de
la part de l’orfevre ou bijoutier , il achève en fûreté
fon ouvrage, le rapporte enfuite au bureau du roi
. pour acquitter les droits ; alors on lui décharge fa
foumiftion, 8c le fermier ou régiffeur pour le roi
applique fur ces mêmes pièces un quatrième poinçon
qui s’appelle juliement, 8c pour cela, poinçon de
décharge. Cette dernière opération lui donne la li-
berté d’expofer en vente & de difpofer, comme bon
lui femble, de ces marchandifes.
Nous ajouterons ic i , en interrompant le mémoire
de M. le Cain , quelques exemples du travail
de l’orfévre-bijoutier, dont les planches gravées &
le vocabulaire donneront encore d’autres explica-
tions. r
Voici la con flrùSlion (Tune charnière de boîte, d’après
l’ancienne encyclopédie.
La partie la plus difficile à faire dans une tabatière
d’or ou d’argent, ou montée en l’un ou l’autre
de ces métaux, c’eft la charnière : voici comment
on l’exécutera.
Il faut d’abord préparer le fil de charnière.
I Pour cef effet, on prend un brin de fil d’or ou
d argent, carré ou rond, qu’on aplatit par-tout
excepté à fon extrémité, à l’épaiffeur d’un quart
de ligne, ou à-peu-près, félon la force dont* on
veut la charnière ; il faut que l’épaiflfeur de la
partie foit bien égale : l’on roule cette partie aplatie,
félon fa longueur, fur un fil de fer ou de
cuivre rond , & on la paffe à la filiere. Cette opération
affemble & applique exa&ement les deux
bords de la lame l’un contre l’autre , détruit la
cavité & alonge le fil.
On tire à la filière jufqu’à ce que le trou foit
du diamètre qu’on défire ; 8c quand il y eft, on a
un fil d’acier tiré, bien poli , 8c que l’on introduit
dans le trou, 8c l’on remet le tout enfemble dans
la filière : cette fécondé opération applique les
parties intérieures de la charnière contre le fil, &
diminue fon épaiffeur fans diminuer le diamètre.
On a foin de graifler le fil d’acier avant de l’introduire,
avec du fuif ou de la cire.
On tire jufqu’à un trou marqué de la filière. On
retire le fil d’acier , 8c comment ? Pour cet effet ,
on paffe fon extrémité dans un trou jufte de fon
diamètre de la filière ; alors l’épaifleur du fil de
charnière fe trouve appuyée contre la filière ; on
prend les tenailles du banc, & on tire le fil d’acier
qui vient feul.
Ou bien on prend le bout du fil d’acier dans
un etau à main : on paffe le fil de charnière dans
un trou plus grand que fon diamètre. On prend la
pointe refferrée du fil de charnière avec la tenaille
du banc , & on tire.
II arrive affez fouvent que le fil d’acier fe cafté
dans le fil de charnière ; alors on coupe le fil de
charnière par le milieu ; on fait enforte que dans
la coupure eu entaille puiffe être reçu un fil de
fer : on le tord autour, & on paffe & repaffe le
tout dans une filière plus grande que le fil de
charnière , mais moindre que le fil de charnière
avec le fil de fer mis dans la coupure , & on tire.
Quand k fil d’acier eft tiré de la charnière, on
la paffe dans fon calibre, dont (la différence des
ouvertures n’étant pas perceptible à la vu e ) l’entrée
eft marquée.Il y a rrës-peu de différence entre
le trou de la filière 8c le trou du calibre ; c’eft
pour cela qu’on a marqué le trou de la filière.
V On tire la charnière plufieurs fois par le calibre
j afin qu’il puiffe y rentrer plus aifément, &
le fil de charnière eft fini : c’effitle ce fil qu’on fait
des charnôns.
Les charnôns font des bouts de fil de charnière.
Pour avoir des charnôns, on commence par couper
le fil de charnière par bouts d’un pouce &
demi ou deux pouces de longueur ; on ébarbe un
des bouts , & on le prèfente dans le calibre du
côté de fon entrée; après l’avoir paffé, on a un
morceau de bois , dans lequel on place le calibre
à moitié de fon épaiffeur. On fait entrer dans le
calibre le fil de charnière avec un maillet, jufqu’à
ce qu’il foit à ras du trou de fortie, 8c un peu au-
delà. On a une lame de couteau taillée en feie ,
qu’on appelle feie à chamon, avec laquelle on
coupe le bout de charnière excédant à ras du trou
d’entrée. On lime enfuite les deux faces avec une
lime douce.
Il faut que le calibre foit trempé dans toute fa
dureté, afin que les limes ne mordent pas fur
ces faces. Cela fait, on fraife les deux entrées du
trou du chamon ; puis avec un outil appelé repouf-
foir, on fait fortir le charnon, & on le répare.
On a une pointe conique, qu’on fait entrer
avec force dans le charnon, pour en écarter l’af-
femblage 8c l’apercevoir. Il faut obferver que
la matière dont on a tiré le fil de charnière , eft
crud & non recuit, afin de lui conferver fon élaf-
ticité.
On a uri 'burin ; & afin de ne plus perdre de
vue l’affemblage que la pointe a fait paroître , on
tire un trait de burin dans toute fa longueur, mais
qu’on rend plus fenfible fur les extrémités. On
barre ce trait avec la lime, ou l’on y fait de petites
tranchées perpendiculaires ; puis avec le burin ,
on emporte un peu de la vive-arrête du trou libre ,
car la pointe eft toujours dans le charnon ; alors
on ébarbe le bord extérieur, on change la pointe
de trou, & l’on en fait autant à l’autre bout : dans
cet état le charnon eft prêt à lier , 8c à former la
charnière.
Il faut vavoir les porte-charnières. Les porte-
charnières font deux parallélipipèdes foüdés , que
les artiftes appellent carrés, q u e l ’o n met appliqués
l’un au-deffus , 8c l’autre à la cuvette : celui
qui tient à la cuvette eft quelque peu profilé. Il
faut que les furfaces de ces parallélipipèdes s’appliquent
l’une contre l’autre , fans fe déborder par
dehors.
Quand cela eft fait, on divife la circonférence
du charnon en trois parties égales. On prend la
moitié de la corde du tiers , & l’on trace la couliffe
fur toute la longueur des ca'rrés , prenant fur
la hauteur de : chaque porte-charnière la moitié
de la corde du tiers, 8c fur la profondeur, les deux
tiers du diamètre. Il eft évident que quand les
charnôns feront fixés dans les couliffes, la boîte
s’ouvrira d’un angle de 120 degrés. Il eft certain
aufli que voilà les vive-arrêtes des couliffes déterminées.
Après cela, on fait fur ces traits qui déterminent
les vives-arrêtes , autant de traits de parallèles
qui fervent de tenons aux précédens ; car il eft
évident que quand on fera la couliffe, les premiers
traits difparoîtront. Pour faire les cent quatre-vingt
couliffes, on commence par enlever les angles ;
pour évider le refte, on a des échoppes à couliffes.
Ce font des efpèees -de burins qui ont la courbure
même du charnon fur leur partie tranchante.
On enlève avec cet outil la matière, 8cl’on achève
la coulifi'e ; pour la dreffer on a des limes à couliffes
; ce font des limes cylindriques, rondes , du
diamètre de la couliffe, ou un peu plus petit ,
afin que le charnon ne porte que fur les bords de
la couliffe.
Avant que de foudêr les charnôns, on s’affure
que la couliffe eft droite au fond, par le moyen
d’une petite règle tranchante, que l’on pofe partout
, & fur toute la longueur.
Il faut que le nombre des charnôns foit impair ,
afin que les charnôns des deux bouts, qu’on laiffe
plus longs que les autres, àt diferétion, fôient tous
deux foudés en-haut.
On enfile tous les charnôns dans un fil de fer ;
on pofe les deux couliffes l’une fur l’autre, & on
y place les charnôns ; l’on marque avec un
compas furies portes-charnières d’en-haut, la longueur
des charnôns des deux bouts, ou maîtres
charnôns, puis avec une pointe_on marque au-
deffus 8c au-deffous fur les porte-charnières , les
places de tous les charnôns. On défaffemble le
tout, 8c dans les couliffes, par-tout où il doit
, y avoir un charnon foudé , on donne 2 ou 3
traits de burin tranfverfalement pour fournir de
l’air à la foudure.
On remet les charnôns enfilés dans la couliffe
du deffous ; on commence par lier les deux char-
nons du bout avec élu fil de fe r , puis les autres
alternativement. Enfuite on retire le fil de fer
paffé dans les charnôns, 8c tous les charnôns de
la couliffe d’en-bas tombent. On les reprend, 8c
on les place 8c lie dans les intervalles de la cou-
liffe d’ en-bas, qui leur ont été marqués par la
pointe à tracer, 8c les coups de burin tranf-
verfals.
Cela fait, on tient avec une pince à charnon ,
les charnôns, 8c on les range félon l’affemblage
marqué par les traits du burin donnés fort fur les
bouts, dans le milieu des couliffes ; on commence
par faire le couvercle fur la cuvette par le devant,
8c l’on abaiffe les couliffes l’une vers l’autre, jufqu’à
ce que les charnôns fe touchent ; puis avec
une pointe on les fait engager les uns entre les
autres ; on pofe un des maîtres charnôns fur un