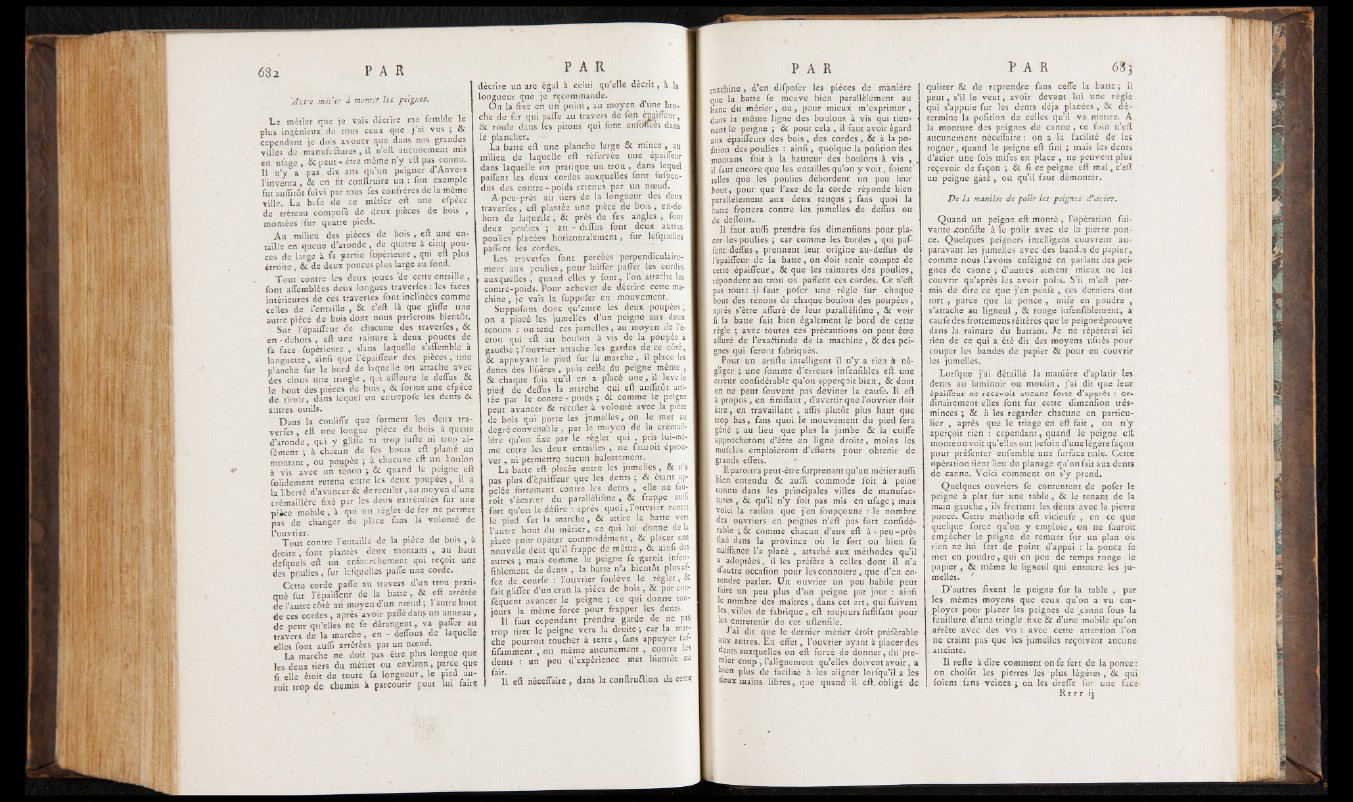
'Autre métier à monter les peignes.
L - métier que je Vais décrire me femble le
plus ingénieux. de tous ceux que j’ai vus ; &
cependant je dois avouer que dans nos grandes
villes de manufaâures, il n’eft aucunement mis
en ufage , & peut - être même n’y eft pas^ connu.
Il n’y a pas dix ans qu’un peigner d’Anvers
l’inventa, & en fit conftruire un : fon exemple
fut auflitôt fuivi par tous fes confrères de la même
ville. La bafe de ce métier eft une efpèce
de tréteau compofè de deux pièces de bois ,
montées i fur quatre pieds.
Au milieu des pièces de bois, eft une entaille
en queue d’aronde, de quatre à cinq pouces
de large à fa partie fupérieure, qui eft plus
étroite , & de deux pouces plus large au fond.
Tout contre les deux joues 'de cette entaille ,
font affemblées deux longues traverfes : les faces
intérieures de ces traverles font inclinées comme
celles de l'entaille , & c’eft là que glifle une
autre pièce de bois dont nous parlerons bientôt.
■ Sur l’èpaiffeur de chacune des traverfes, &
en - dehors , eft une rainure à deux pouces de
fa face fupérieure , dans laquelle s affemble à
languette , ainfi que l’épaiffeur des pièces , une
planche fur le bord de laquelle on attache avec
des clous une tringle, qui affleure le deffus &
le bout des pièces de bois , & formejtne efpèce
de tiroir, dans lequel on entrepofedes dents &
autres outils.
Dans la couliffe que forment les deux traverfes
, eft une longue pièce de bois à queue
d’aronde, qui y glifle ni trop jufte ni trop ai-
férnent ; à chacun de fes bouts eft planté un
montant, ou poupée à chacune eft un boulon
à vis avec un tenon ; & quand le peigne eft
folidement retenu entre les deux poupées, U a
la liberté d’avancer & de reculer , au moyen d une
crémaillère fixé par les deux extrémités fur une
pièce mobile , à qui un réglet de fer ne permet
pas de changer de place fans la volonté de
l’ouvrier. - ,
Tout contre l’entaille de la piece de bois , a
droite, font plantés deux montai« , au haut
defquels eft un enfoürchement qui reçoit une
des poulies, fur lefquelles paffe une corde.
Cette corde paffe au travers d’un trou pratiqué
décrire un arc égal à celui qu’elle décrit, à la
longueur que je recommande.
On la fixe en un point, au moyen ■ d’une broche
fur l’épaifleur de la batte , & eft arrêtée
de l’autre côté au moyen d’un noeud ; l’autre bout
de ces cordes , apres avoir paffe dani, un anneau ,
de peur qu’elles ne fe dérangent, va paffer au
travers de la marche, en - deffous de laquelle
elles font aufli arrêtées par un noeud.
La marche ne doit pas être plus longue que
les deux tiers du -métier ou environ, parce que
ft elle étoit de toute fa longueur, le pied au-
roit trop de chemin à parcourir pour lui faire
de fer qui paffe au travers de fon épailTeur,
& roule dans les pitons qui font enfoncés dans
le plancher.
La batte eft une planche large & mince , au
milieu de laquelle eft rèfervée une épaiffeur
dans laquelle on pratique, un trou , dans lequel
paffent les deux cordes auxquelles font fufpen-
dus des contre-poids retenus par un noeud.
A-peu-près au tiers de la longueur des deux
traverfes, eft plantée une pièce de bois ; en-dehors
de laquelle, & près de fes angles , font
deux poulies ; au - deffus font deux autres
poulies placées horizontalement, fur lefquelles
paffent les cOrdès. - ^ ’
• Les traverfes font percées perpendiculairement
aux poulies, pour laiffer paffer les cordes
auxquelles, quand elles y font, 1 on. attache les
contre-poids. Pour achever de décrire cette machine
, je vais la fuppofer en mouvement.
Suppofons donc qu’entre les deux poupées;
on a placé les jumelles d un peigne aux deux
tenons : on tend ces jumelles, au moyen de l’écrou
qui eft au boulon à vis de la poupée à
gauche ; l’ouvrier attache les .gardes de ce côté,
8c appuyant le pied fur la marche , il place les
dents des lifières, puis celle du peigne même ,
& chaque fois qu’il en a placé une, il jeve le 1
pied de deffus la marche qui eft auflitôt attirée
par le contre - poids ; 8c. comme. le peigne
peut avancer 8t reculer à volonté avec .la pièce
de bois qui porte les jumelles, on le met au
degré convenable , par le moyen de la crémaillère
qu’on fixe par le réglet qui , pris lui-même
entre les deux entaillés , ne fauroit éprouver
, ni permettre aucun balottemenr.
La batte eft placée entre les jumelles, 8t n’a
pas plus d’épaiffeur que les dents ; 8t étant appelée
fortement contre , les dents , elle ne fauroit
s’écarter du parallélifme, 8t frappe aufli
fort qu’on le délire : après quoi, l’ouvrier remet
le pied fur la marche, 8c attire la batte versI
l’autre bout du métier, ce qui lui donne delà
place pour opérer commodément, 8c placer une
nouvelle dent qu’il frappe de même , 8c ainfi des
autres ; mais comme le peigne fe garnit infen-
fiblement de dents , la batte n a bientôt plus afi
fez de courfe : l’ouvrier foulève le réglet, «
fait gliffer d’un cran la pièce de bois , 8c par cou-
féquent avancer le peigne ; ce qui donne tou-l
jours la même force pour frapper les dents.
11 faut cependant prendre garde de ne pas
trop tirer le peigne vers la droite ; car la marche
pourroit toucher à terre , fans appuyer fuf-
fifamment , ou même aucunement ,. contre les
dents : un peu d’expérience met bientôt au
fait. ■
Il eft néceffaire , dans la conftruction de cette
machine, d’en difpofer les pièces de manière
que la batte fe meuve bien parallèlement au
banc du métier, o u , pour mieux m’exprimer,
dans la même ligne des boulons à vis qui tiennent
le peigne ; & pour cela , il faut avoir égard
aux épaiffeurs des bois, des cordes, & à la po-
fnion des poulies : ainfi , quoique la pofition des
montans foit à la hauteur des boulons à vis ,
il faut encorô que les entailles qu’on y voit, foient1
telles que les poulies débordent un peu leur
bout, pour que Taxe de la corde réponde bien
parallèlement aux deux tenons ; fans quoi la
batte frottera contre les jumelles de demis ou
de deffous.
Il faut aufli prendre fes dimenfions pour placer
les poulies ; car comme les tordes , qui paffent
deffus, prennent leur origine au-deffus de
l’épaiffeur de la batte, on doit tenir compte de
cette épaiffeur, & que les rainures des poulies,
répondent au troii ou paffent ces cordes. Ce n’eft
pas tout: il faut pofer une règle fur chaque
bout des tenons de chaque boulon des poupées,
après s’être affuré de leur parallélifme , & voir
fi la batte fuit bien également le bord de cette
règle ; avec toutes ces précautions on peut être
affuré de l’exaétitude de la machine, & des peignes
qui feront fabriqués.
Pour un artifte intelligent il n’y a rien à négliger.
; une fomme d’erreurs infenfibles eft une
erreur confidérable qu’on apperçoit bien, & dont
on ne j)eut fouvent pas deviner la caufe. Il eft
à propos , en finiffant, d’avertir que l’ouvrier doit
être, en travaillant , affis plutôt plus haut que
| trop bas, fans quoi le mouvement du pied fera
I gêné ; au lieu que plus la jambe & la cuiffe
I approcheront d’être en ligne droite, moins les
I mufcles emploieront d’efforts pour obtenir de
I grands effets. •
Ilparoîtra peut-être furprenant qu’un métier aufli
I bien entendu & aufli commode foit à peine
I connu dans les principales villes de manufac-
I tures, & qu’il n’y foit pas mis en ufage ; mais
I voici la raifon que j’en foupçonne : le nombre
I des ouvriers en peignes n’efl pas fort confidé-
I table ;& comme chacun d’eux eft à-peu-près
I fixé dans la province où le fort ou bien fa
I naiüfimce l’a placé , attaché aux méthodes qu’il
I a adoptées , il les préfère à celles dont il n’a
I d’autre occafion pour les connoître, que d’en e-n-
I tendre parler. Un ouvrier un peu habile peut
B faire un peu plus d’un peigne par jour : ainfi
I le nombre des maîtres , dans cet art, qui fuivent
I les,villes de fabrique, eft toujoursfuffifant pour
■ les entretenir de cet uftenfile.
J’ai dit que le dernier métier étoit préférable
I aux autres. En effet, l’ouvrier ayant à placer des
I dents auxquelles on eft forcé de donner, du’pre-
■ roter coup, l’alignement qu’elles doivent avoir, a
■ bien plus de facilité à les aligner lorfqu’il a les
I deux mains libres, que quand il eft. obligé de
quitter & de reprendre fans ceffe la batte ; il
peut, s’il le veut, avoir devant lui une règle
qui s’appuie fur les dents déjà placées , & détermine
la pofition de celles qu’il va mettre. A
la monture des peignes de canne , ce foin n’eft
aucunement néceffaire : on a la facilité de les
rogner, quand le peigne eft fini ; mais les dents
d’acier une fois miles en place , ne peuvent plus
reçevoir de façon ; & fi ce peigne eft mal, c’eft
un peigne gâté , ou qu’il faut démonter.
De la manière de polir les peignes d'acier.
Quand un peigne eft monté , l’opération fui-
vante «confifte à le polir avec de la pierre ponce.
Quelques peigners intelligens couvrent auparavant
les jumelles avec des bandas de papier,
comme nous l’avons enfeigné en parlant des peignes
de canne ; d’autres aiment mieux ne les
couvrir qu’apres les avoir polis. S’il m’eft permis
de dire ce que j’en penfe, ces derniers ont
tort , parce que la ponce , mife en poudre ,
s’attache au ligneul , & ronge infenftblement, à
caufe des frottemens réitérés que le peigneéprouve
dans la rainure du battant. Je ne répéterai ici
rien de ce qui a été dit des moyens ufités pour
couper les bandes de papier & pour en couvrir
les jumelles.
Lorfque j’ai détaillé la manière d’aplatir les
dents au laminoir ou moulin, j’ai dit que leur
épaiffeur né recevoit aucune forte d’apprêt : ordinairement
elles font fur cette dimenfion très-
minces ; & à les regarder chacune en particulier
, après que le triage en eft fait , on n’y
| aperçoit rien : cependant, quand le peigne eft
monté on voit qu’elles ont befoin d’une légère façon
pour préfenter enfemble une furface unie. Cette
opération tient lieu du planage qu’on fait aux dents
de canne. Voici comment on s’y prend.
Quelques ouvriers fe contentent de pofer le
peigne à plat fur une table, & le tenant de la
main gauche , ils frottent les dents avec la pierre
ponce. Cette méthode eft vicieufe , en ce que
• quelque force qu’on y emploie, on ne fauroit
empêcher le peigne de remuer fur un plan où
rien ne -lui fert de point d’appui : la ponce fe
met en poudre, qui en peu de temps ronge le
papier , & même le ligaeul qui entoure les jumelles.
*
D ’autres fixent le peigne fur la table , par
les mêmes moyens que ceux qu’on a vu employer
pour placer les peignes de #canne fous la
feuillure d’une tringle fixe & d’une mobile qu’on
arrête avec des vis : avec cette attention l’on
ne craint pas que les jumelles reçoivent aucune
/ atteinte.
Il relie à dire comment on fe fert de la ponce :
on choifit Les pierres les plus légères, & qui
J foient fans veines ; on les dreffe fur une face-
Rr r r ij