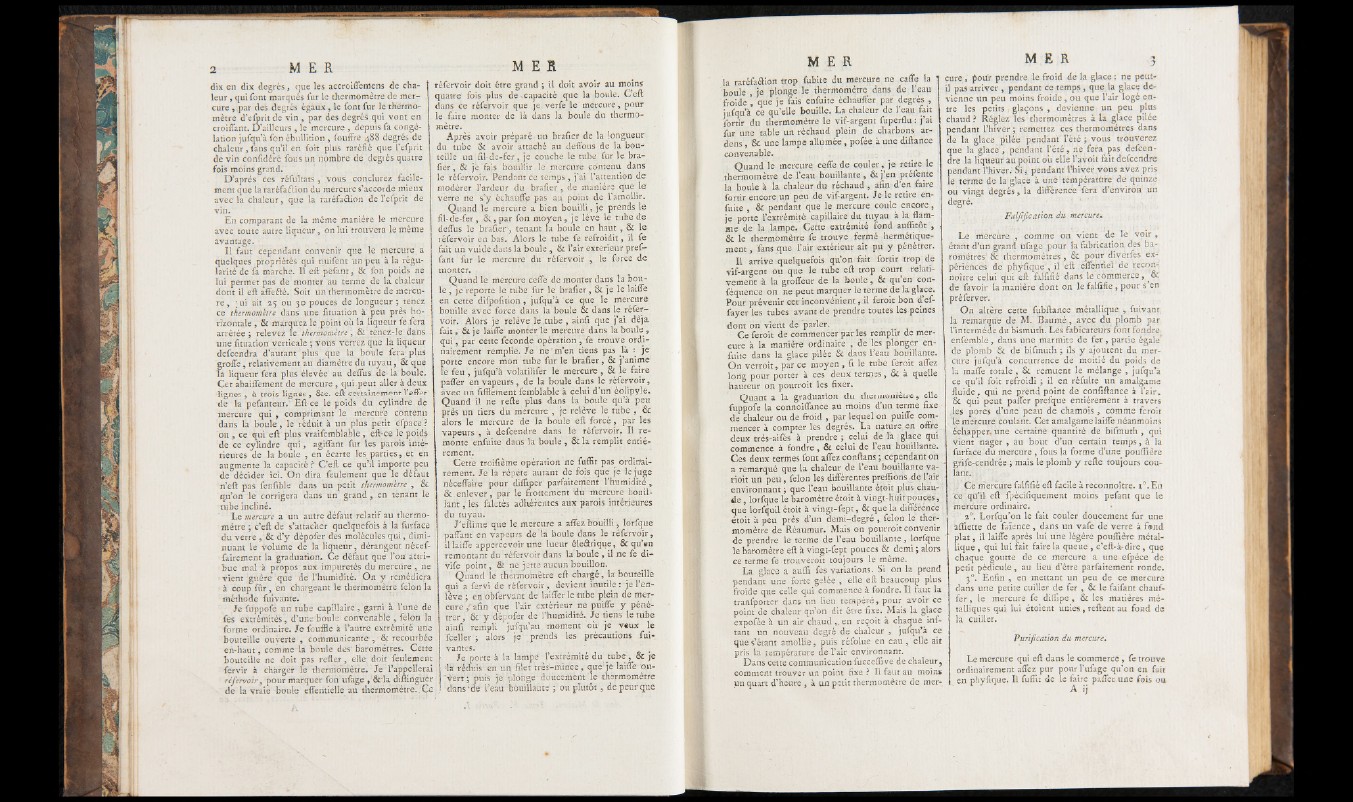
dix en dix degrés, que les accroiffemens de chaleur
, qui font marqués fur le thermomètre de mercure
, ,par des degrés égaux , le font fur le thermomètre
d’efpritde v in , par des degrés.qui vont en
croiflant. D’ailleurs , le mercure, depuis fa congélation
jufqu’à fon ébullition , fouffre 488 degrés de
chaleur, fans qu’il en foit plus raréfié que l’efprit
de vin confidéré fous un nombre dé degtés quatre
fois moins grand.
D ’après ces réfultats, vous conclurez facilement
que la raréfaélion du mercure s’accorde mieux
avec la chaleur, que la raréfaction de l’efprit de
vin.E
n comparant de la même manière le mercure
avec toute autre liqueur, on lui trouvera le même
avantage.
Il faut cependant convenir que le mercure a
quelques propriétés qui nuifent un peu à la régularité
de fa marche. Il eft pèfant, & fon poids ne
lui permet pas de monter au terme de la chaleur
dont il eft affeété. Soit un thermomètre de mercure
, ]ui ait 2,5 ou 30 pouces de longueur ; tenez
ce thermomètre dans une fituation à peu près horizontale
, & marquez le point où la liqueur fé.fera
arrêtée ; relevez le thermomètre, & ténez-le dans
une fituation verticale ; vous verrez que la liqueur
defcendra d’autant plus que la boule fera- plus
groffe , relativement au diamètre du tuyau, & que
la liqueur fera plus élevée au deiïùs de la boule.
Cet abaiffement de mercure , qui .peut aller à deux
lignes , à trois lignes , &c. eft certainement l’effet'
de la pefanteur/ Éft-ce lé poids du cylindre de
mercure qui , comprimant le mercure contenu
dans la boule, le réduit à un plus petit éfpacé?
on , ce qui eft plus vraifemblable , eft-ce le poids
de ce cylindre qui, agiffant fur les parois intérieures
de la boule , en écarte les parties, et en
réfervoir doit être grand ; il doit avoir au moins
quatre fois plus de vcapacité que la boule. C’eft
dans ce réfervoir que je verfe le mercure, pour
le faire monter de là dans la boule du thermomètre.
augmente la capacité ? C ’eft ce qu’il importe peu
de décider ici. On dira feulement que le défaut
n’eft pas fenfible dans un petit thermomètre^ &
qu’on le corrigera dans un grand, .en tenant le ■
tube incliné.
Le mercure a un autre défaut relatif au thermo- j
mètre ; c’eft de s’attacher quelquefois à la furface .
du verre , & d’y dépofer des molécules qui , dimi- !
nuant le volume de la liqueur, dérangent nécef-
fairement la graduation. Ce défaut que l’on attri- .
bue mal à propos aux impuretés du merciïre, ne .
vient guère que de l’humidité. On y remédiera
à coup fur, en chargeant le thermomètre félon la
méthode fuivânte.
Je fuppofe un tube capillaire, garni à l’une de
fes extrémités , d’une boule convenable , félon la
forme ordinaire. Je fouffle à l’autre extrémité une
bouteille ouverte , communicante , & recourbée
en-haut, comme la boule des' baromètres. Cette
bouteille ne doit pas relier, elle doit feulement
fervir à charger le thermomètre. Je l’appellerai
réfervoir, pour marquer fon ufage , ‘ôrla diftingiièr
de la vraie boule effentielle au thermomètre.;Ce
Après avoir préparé un brafier de la longueur
du tube & avoir attaché au defîbus de la bouteille
un fil-de-fer, je couche le tube fur le brafier,
& jé fais bouillir le mercure contenu dans
le réfervoir. Pendant Ce temps , j’ai l’attention de
modérer l’ardeur du brafier , de manière que le
verre ne s’y échauffe pas au point de l’amollir.
Quand le mercure a bien bouilli, je prends le
fil-de-fer, &., par fon moyen, je lève le tube de
deffus le brafier", tenant la boule en haut, & le
réfervoir en bas. Alors le tube fe refroidit, il fe
fait un vuide dans là boule , & l’air extérieur pref-
fàrit fur le mercure' du' réfervoir , le force de
monter. •
Quand le mercure ceffe de monter dans la boule
, je reporte le tube fur le brafier, & je le laiffe
en cette difpofition, jufqu’à ce que le mercure
bouille avec force dans la boule & dans le réfervoir.
Alors je relève lé ,tube , ainfi que j’ai déjà
fait, & je laiffe monter le mercure dans la boule ,
qui', par cette fécondé opération, fe trouve ordinairement
remplie. Je ne m’en tiens pas là : je
porte encore mon tube fur le brafier, & j’anime
le feu , jufqu’à volatilifer le mercure , & le faire
paffer en vapeurs , de la boule dans le réfervoir,
avec un fiffleinent femblable à celui d’un éolipyle.
Quand il ne refte plus dans la boute qu’à peu
près un tiers du mercure , je relève le tube , &
alors le mercure de la boule eft forcé, par les
vapeurs , à defcendre dans le réfervoir. Il remonte
enfuite dans la boule , & la remplit entié^
remènt.
Cette troifième opération ne fuffit pas^ ordinairement.
Je la répète autant de fois que je le juge
néceffaire pour diffiper parfaitement l'humidité ,
& . enlever, par le frottement du mercure bouillant
g les faletés adhérentes aux parois intérieures
du tuyau. .
J’eftime que le mercure a affez bouilli 5 ïorfque
paffant en Vapeurs de la boule dans le réfervoir,
il laiffe appercevoir une lueur éledrique, & qu’en
remontant du réfervoir dans la boule , il ne fe di-
vife point, & ne jette aucun bouillon.
Quand le thermomètre eft chargé, la bouteille
qui a fervi de réfervoir , devient inutile : je l’enlève
; en obfervant de laiffer le tube plein de mercure
/ afin que l’air extérieur ne puiffe y pénétrer
, & ' y dépofer de rhumidité. Je tiens le tube
ainfi rempli jufqu’au montent où' je veux le
ïceller ; alors jé prends les précautions fui*
vantes.
Jq porte à la lampe l’extrémité du tube, & je
4a réduis en un filer très-mince , que jé laiffe ouvert
j puis jé plonge doucement le thermomètre
dans ‘ de l’eau bouillante ; ou plutôt, de peur que
la raréfaftion trop fubite du mercure ne cafte la
boule , je plonge-le thermomètre dans de l’eau
froide que je fais enfuite échauffer par degrés ,
jufqu’à ce qu’elle bouille. La chaleur de l’eau fait
Sortir du thermomètre le vif-argent fuperflu: j’ai
fur une table un réchaud plein de charbons ar-
dens, & une lampe allumée, pofée à une diftance ;
convenable.
Quand le mercure ceffe de couler, je retire le j
thermomètre de l’eau bouillante, &j,en prefente
la boule à la chaleur du réchaud , afin.d’en faire
fortir encore^un peu de vif-argent. Je-le retire en-
fuite , & pendant que le mercure coule encore,
je porte l’extrémité capillaire du tuyau à la flamme
de la ,lampe. Cette extrémité fond aulîitôt ,
& le thermomètre fe trouve fermé hermétiquement,
fans que l’air extérieur ait pii y pénétrer.
Il arrive quelquefois qu’on fait fortir trop de
vif-argent ou que le tube eft trop court relativement
à la groffeur de la boule, & qu en con-
féquence on ne peut marquer le terme de la glace.
Pour, prévenir cer inconvénientil feroit bon d’ef-
fayer les tubes avant de prendre toutes les peines
dont on vient de parler. «
Ce. feroit de commencer par les remplir de mercure
à la manière ordinaire , de lés plonger en-
fuite dans la glace pilée & daus l’eau bouillante.
On Verroit, par ce moyen , fi le tube feroit affez
lorfg pour porter à ces deux termes, & à quelle
hauteur on pourroit les fixer.
Quant à la graduation du thermontètre, elle
fuppofe la connoiffance au moins d’un terme fixe
de chaleur ou de froid , par lequel on puiffe commencer
à compter les degrés. La nature, en offre
deux très-aifés à prendre ; celui de la glace qui
commence à fondre, & celui de l eau bouillante.
Ces deux termes font affez conftans ; cependant on
a remarqué que la chaleur de l’eau bouillante va-
rioit un peu, félon les différentes préfixons fie l’air
environnant j que l’eau bouillante etoit plus chaude
, Ïorfque le baromètre étoit à vingt-huit pouces,
que lorfquil étoit à vingt-fept, & que la différence
étoit à peu près d’un demi-degré , félon le thermomètre
de Réaumur. Mais on pourroit convenir
de prendre le terme de l’eau bouillante, Ïorfque
le baromètre eft à vingt-fept pouces & demi ; alors
ce terme fe trouveroit toujours le même.
La glace a aufli fes variations. Si on la prend
pendant une forte gelée , elle eft beaucoup plus
froide que celle qui commence à fondre. Il faut la
tranfporter dans un lieu tempéré, pour avoir ce
point de chaleur qu’on dit être fixe. Mais la glace
expofée à un air chaud „ e n reçoit à chaque inf-
ta.nt un nouveau degré de chaleur , jufqu’à ce
que s’étant amollie, puis réfolue en eau, elle ait
pris la température de l’air environnant.
Dans cette communication fuccefîive de chaleur,
comment trouver un point fixe ? Il faut au moins
un quart d’heure, à un petit thermomètre de mercure,
poifr prendre ;le froid delà glace: ne peut-
il pas arriver , pendant ce temps, que la glace devienne
un peu moins froide, ou que l’air logé entre
les petits glaçons , devienne un peu plus
chaud ? Réglez les thermomètres à la glace pilée
pendant l’hiver ; remettez ces thermomètres dans
de la glace pilée pendant l’été ; vous trouverez
que la glace , pendant l’été', ne fera pas defcendre
la liqueur au point où elle l’àvoit fait defcendre
pendant l’hiver.; Si |j pendant l'hiver vous avez pris
le terme de la glacé à uné'tempérafüfe de quinze
ou vingt degrés , la différence fera d’environ un
degré.
Falfification du mercure.
Le mercure , comme on vient de le voir ,
étant d’un grand ufage pour la fabrication des baromètres
& thermomètres , & jpour di ver fes expériences
de pliÿfique , il eft effenfiel de recon-.
; noître celui qui eft. falfifié dans le commerce, &
I de fa voir la manière dont on le falfifié , pour s en
p réfer ver.
On altère cette fubftance métallique , fuivant,
la remarque de M. Baumé, avec du plomb par
l'intermède du bismuth. Les fabicateurs font fondre
enfemble, dans une marmite de fe r , partie égale
de plomb & de bifmuth ; ils y ajoutent du mercure
jufqu’à concurrence de moitié du poids de
la maffe totale, 8c remuent le mélange , jufqu’à
ce qu’il foit refroidi ; il en réfulte un amalgame
fluide, qui ne prend point de confiftance à l’air,
& qui peut paffer prefque entièrement à travers
des pores d’une peau de chamois , comme feroit
le mercure coulant. Cet amalgame laiffe néanmoins
échapper* une certaine quantité de bifmuth , qui
vient nager , au bout d’un certain temps, à la
furface du mercure, fous la forme d’une poufiière
- grife-cendrée ; mais le plomb y refte toujours coulant.
d Ce mercure falfifié eft facile à reconnoître. i°. En
ce qu’il eft fpécifiquement moins pefant que le
mercure ordinaire.
^ 2°. Lorfqu’on le fait couler doucement fur une
affiette de faïence , dans un vafe de verre à f®nd
plat, il laiffe après lui une légère poufiière métallique
, qui lui fait faire la queue , c’eft-à-dire, que
chaque goutte de ce mercure a une efpèce de
petit pédicule, au lieu d’être parfaitement ronde.
30. Enfin , en mettant un peu de ce mercure
dans une petite cuiller de fer , & le faifant chauffer
, le mercure fe diflipe , & les matières métalliques
qui lui étoient unies, reftent au fond de
la cuiller.
Purification du mercure.
Le mercure qui eft dans le commercé, fe trouve
ordinairement affez pur pour l’ufage qu’on en fait
en phyfique. Il fuffit de le faire paffer une fois ou
A ij