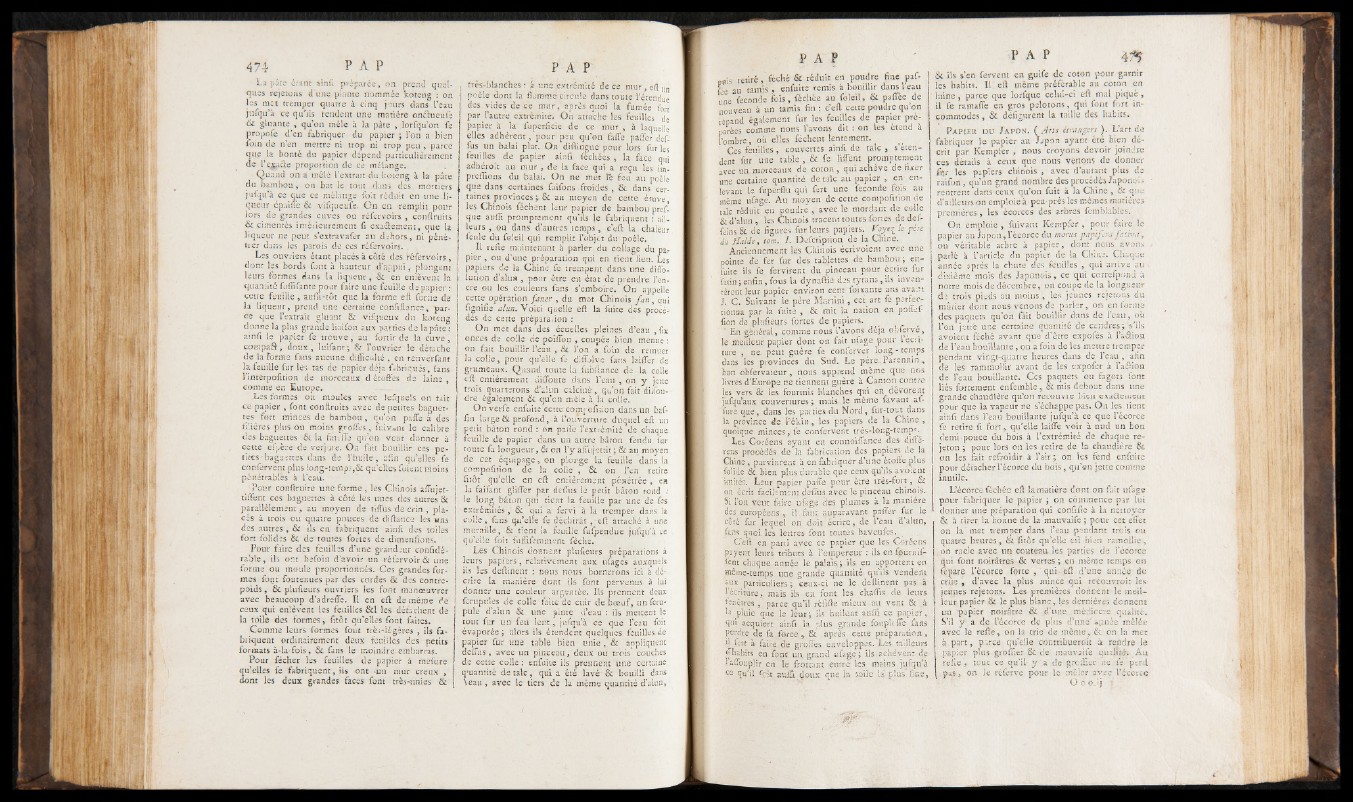
La pâte étant ainfi préparée, on prend quelques
rejetons d'une plante nommée koteng : on
les met tremper quatre à cinq jours dans l’eau
jufqu’à ce qu’ils rendent une matière onéhieufe
& gluante , qu’on mêle à la pâte , lorfqu’on fe
propofe d’en fabriquer du papier ; l’on a bien
foin de n’en mettre ni trop ni trop peu, parce
que la bonté du papier dépend particulièrement
de 1 exacte proportion de ce mélange.
Quand on a mêlé l'extra;t du koteng à la pâte
du bambou , on bat le tout dans des mortiers
jufqu’à ce que ce mélange foit réduit en une -liqueur
épaifle & vifqueufe. On en remplit pour
lors de grandes cuves ou réfervoirs , conftruits
& cimentés intérieurement fi cxaélement, crue la
liqueur ne peut s’extravafer au dehors, ni pénétrer
dans les parois de ces réfervoirs. .
Les ouvriers étant placés à côté des réfervoirs ,
dont les bords font à hauteur d’appui, plongent
leurs formes dans la liqueur, 8c en enlèvent la
quantité fufîifante pour faire une feuille de papier :
cette feuille , aufîi-tôt que la forme eft ferrie de
la liqueur, prend une certaine confiftance, parce
que l’extrait gluant & vifqueux du koteng
donne la pins grande liaifon aux parties de la pâte:
ainfi le papier fe trouve, au fortir de la cuve,
compaft, doux , luifant; & l’ouvrier le détache
de la Forme fans aucune difficulté , en renvè.rfant
la feuille fur les tas de papier déjà fabriqués, fans
l’interpofition de morceaux d étoffes de laine ,
comme en Europe.
Les formes ou moules avec lefqueîs on fait
ce papier , font conftruits avec de petites baguettes
fort minces de bambou, qu’on psffe à des
filières plus ou moins groffes, fuiv^nt le calibre
des baguettes & la fimffe qu’on veut donner à
cette efpèce de ver jure. On fait bouillir ces petites
baguettes dans de l’huile, ah h qu’elles-fe
confervent plus long-temps,& qu elles fuient moins
périétrables à l ’eau.
Pour conftruire une forme , les Chinois afiùjet-
tiffent ces baguettes a cote les unes des autres &
parallèlement, au moyen de tlffus de crin , placés
à trois ou quatre pouces de diftance les uns
des autres , & ils en fabriquent ainfi des toiles
fort fôlides 8c de toutes fortes de dimenfions.
Pour faire des feuilles d’une grandeur confidé-
rable, ils ont befoin d’avoir un réfervoir & une
forme ou moule proportionnés. Ces grandes for- i
mes font foutenues par des cordes & des contrepoids
, 8c plufieiirs ouvriers les font manoeuvrer
avec beaucoup d’adreffe. Il en eft de même de
ceux qui enlèvent les feuilles &l. les détachent de
la toile des formes, fitôt qu’elles font faites.
Comme leurs formes font trè>-îégères , ils fabriquent
ordinairement deux feuilles des petits
formats à-la-fois, 8c fans le moindre embarras.
Pour fécher les feuilles de papier à raefure
qu’elles fe fabriquent, ils ont >4111 mur creux ,
dont les deux grandes faces font très-unies &
1 frès-bianches : à -une extrémité de ce mur, eft lm
poêle dont la flammé circule dans toute l’étendue
des vides de ce mur, après quoi la fumée f0rf
par l’autre extrémité; On attache les feuilles de
papier à la fuperficie de ce mur, à laquelle
elles adhèrent, pour peu qu’on faffe paffer def-
fus un balai plat. On diftingue pour lors fur les
feuilles de papier ainfi féchées , la face qui
adhéroit au mur , de la face qui a reçu les im-
preffions du balai. On ne met le feu au poêle
que dans certaines faifons froides , 8c dans certaines
provinces ÿ 8c au moyen de cette étuve
les Chinois féchent leur papier de bambou presque
auiïi promptement qu’ils }e fabriquent : ailleurs
, ou dans d’autres tertjps , c’eft la chaleur
feule du foleil qui remplit l’objet du poêle.
. H tefte maintenant à parler du collage du par
pier , ou d’une préparation qui en tient lieu. Les
papiers de la Chine fe trempent dans une diffo-
lution d’alun , pour être en état de prendre l’encre
ou les couleurs fans s’emboire. On appelle
cette opération faner , du mot Chinois fan , qui
fignifie alun. Voici quelle eft la fuite des procédés
de cette prépararion :
On met dans-des écuelles pleines d’eau , fa
onces de colle de poiffon , coupée bien menue:
on fait bouillir l’eau , & l'on a foin de remuer
la colle , pour qu’elle fe diffolve fans laiflër de
grumeaux. Quand toute la fiibliance de la colle
elt entièrement diffoute dans l’eau , on y jette
trois quarterons d’alun calciné., qu’on fait diîfou-
dre également 8c qu’en mêle à la colle.
On verfe enfuite cette comj oiition dans un baf-
fm large & profond, à l’ouverture duquel eft un
périt bâton rond : on palfe l’extrémité de chaque
feuille de papier dans un autre, baron fendu fur
toute fa longueur, & on l’y affujettit ; & au moyen
de cet équipage, on plonge la feuille dans la
compofition de la colie , 8c on l’en retire
fl tôt qu’elle en eft entièrement pénétrée , en
la faifant griffer par ddTus le petit bâton rond :
le long bâton qui tient la feuille par une de fes
extrémités / 8c qui a fervi à la tremper dans la
colle, fans qu’elle fe déchirât, eft attaché à une
muraille, Si tient la feuille fufpendue jufqu’à ce
qu’elle foit fuffifemment fèche.
Les Chinois donnent plufieurs préparations à
leurs papiers, relativement aux ufages auxquels
ils les deftinent : nous nous bornerons ici à décrire
la manière dont ils font parvenus à lui
donner une couleur argentée. Ils prennent deux
fcrupuîes de colle faite de cuir de boeuf, un feru-
pule d’alun & une pinte d’eau : ils mettent le
tout fur un feu lent, jufqu’à ce que l’eau foit
évaporée ; alors ils étendent quelques feuilles- de
papier fur une table bien unie & appliquent
demis , avec un pinceau, deux ou trois couches
de cette colle: enfuite ils prennent une certaine
quantité de talc, q uia été lavé-& bouilli dans
\eau, avec le tiers de la même quantité d’alun,
P A P
pais retiré, féchè & réduit en poudre fine paf-
fée au tamis , enfuite remis à bouillir dans Veau
une fécondé fois, féchèe au foleil, & pafîee de
nouveau à un tamis fin : c’eil celte poudre qu’on
répand également fur les feuilles de papier pré- i
parées comme nous l’avons dit : on les étend à
l’ombre, où elles féchent lentement.
Ces feuilles , couvertes ainfi de talc , s’étendent
fur une table , & fe liffent promptement
avec un. morceaux de coton, qui achevé de fixer
une certaine quantité de talc au papier , en enlevant
le fuperfln qui fert une fécondé .fois au
même ufàge. Au moyen de cette compofition de
talc réduit en poudre , avec le mordant de colle
& d’alun, les Chinois tracent toutes fortes de dei-
feins.& de figures fur leurs papiers. Voyc$ le père
du Halde, tam. I. Defcription de la Chine.
Anciennement les Chinois écrivoient avec une
pointe de fer fur des tablettes de bambou; en-
fuite ils fe fervirent du pinceau pour écrire fur
fatin ; enfin, fous la dynaftié des tyrans, ils inventèrent
leur- papier environ cent foixante ans avant J. C. Suivant le père Martini, cet art fe perfectionna
par la fuite , 8c mit la nation en poffef -
fion de plufieiirs fortes de papiers.
En général, comme nous l’avons déjà obferve,
le meilleur papier dont on fait ufage pour 1 écriture
, ne. peut guère fe conferver long-temps
dans les provinces du Sud. Le père_Parennin ,
bon obfervateur, nous apprend même que nos
livres d’Europe rie tiennent guère à Canton contre
les vers & les fourmis blanches qui en dévorent
jufqu’aux couvertures; mais, le même favant af-
Ture que, dans les parties du Nord, fur-tout dans
la province de Pékin, les papiers de la Chine,
quoique minces,' fe confervent t r è s - lo.ri g-1 c m p
Les Coréens ayant eu connoiffance des diâé-
rens procédés de la fabrication des papiers^ de la
Chine, parvinrent à en fabriquer d’une étoffe plus
folide & bien plus durable que ceux qu’ils avaient
knités. Leur papier paffe pour être très-fort, &
on écrit facilement deflus avec le pinceau chinois.
Si Ton veut faire ufiige des plumes à la manière
des européens , il.faut auparavant paffer fur le
côté fur lequel on doit écrire, de l’eau d’alun,
fans quoi les lettres font toutes baveufes.
C’eft en parti avec ce papier que les Coréens
payent leurs tributs à l’empereur : ils en fournif-
ient chaque vannée le palais^ ils. en apportent en
même-temps une grande quantité qu’ils vendent
aux particuliers ; ceux-ci ne le deftinent pas à
l’écriture, mais ils en font les. chaffis de leurs
fenêtres , parce qu’il réfifte mieux au vent 8c ,à
la pluie que le leur; ils'huilent anffi ce papier,
qui. acquiert ainfi la plus grande foupk fie fans
perdre de fa force, & après cette préparation,
]!; f*rt à faire dé groffes enveloppes. Les tailleurs
«habits en font un grand ufage; ils.achèvent de
1 ufl'oqplir en le frottant entre les mains jufqn’à
ce qu’U suffi. doux que la î*pile la plus fine,
P AP 4#
8c ils s’en fervent en guife de coton pour garnir
les habits. I l . eft même préférable au coton en
laine, parce que lorfque celui-ci eft mal piqué,
il fe ramaffe en gros pelotons, qui font fort incommodes
, & défigurent la taille des habits.
Papier du Japon. ( Arts étrangers ). L’art de
fabriquer le papier au Japon ayant été bien décrit
par Kempfer , nous croyons devoir joindre
ces détails à ceux que nous venons de donner
fejr les papiers chinois , avec d’autant plus de
raifon, qu’un grand nombre des procédés Japonoi;
rentrent dans ceux qu’on fuit à la Chine , & que
d’ailleurs on emploie à-peu-près les mêmes matières
premières , les écorces des arbres femblables.
On emploie , fuivant Kempfer , pour faire le
papier au Japon, l’écorce du morus papifera fativa,
ou véritable arbre à papier, dont nous avons .
parlé à l’ article du papier de la Chine. Chaque;
année après la chute des feuilles , qui arrive au \
dixième mois des Japonois, ce qui correfpond à
notre mois de décembre, on coupe de la longueur
de trois pieds au moins ^ les jeunes rejetons du
mûrier dont nous venons de parler, on en forme
des paquets qu’on fait bouillir dans de l’eau, où
l’on jette une certaine quantité de cendres ; s’ils
avoient féché avant que d’être expofés à l’a&ioa
de l’eau bouillante, on a foin de les mettre tremper
pendant vingt-quatre heures dans de l’eau , afin
de les rammoHir avant de les expofer à l’aérion
de l’eau bouillante. Ces paquets ou fagots font
liés fortement enfemble, & mis debout dans une
grande chaudière qu’on recouvre bien exa&ement
pour que la vapeur ne s’échappe pas. On les tient
ainfi dans Veau bouillante jufqu’à ce que l’écorce
fe retire fi fort, qu’elle laiffe voir à nud un bon
demi-pouce du bois à l’extrémité de chaque rejeton
; pour lors on les retire de la chaudière &
pn les fait refroidir à l’air ; on les fend enfuite
pour détacher l’écorce du bois, qu’on jette comme
inutile.
L’écorce fée née eft la matière dont on fait ufage
pour fabriquer le papier ; on commence par lui
donner une préparation qui confifie à la nettoyer
& à tirer la bonne de la mauvaife ; pour cet effet
on la met tremper dans l’eau pendant trois ou
quatre heures, 8c fitôt qu’elle eft bien ramollie,
;on racle avec un couteau les parties de l’écorce
qui font noirâtres & vertes ; en même temps ou
fépare l’écorce forte , qui-eft d’une année de
crue , d’avec la plus mince qui recouvroit les
jeûnes rejetons. Les premières donnent le meil-
• leur papier & le plus blanc, les dernières donnent
un 'papier noirâtre & d'une médiocre qualité.
S’il y a de l’écorce de plus d’une année mêlée
avec le refte, on la trie de même, & on la met
à part, parce quelle contribueroit à rendre le
papier plus greffier & de mauvaife qualité; Au
relie, tout ce qu’il y "a de greffier ne fe perd
pas, on le rèferve pour le mêler avec l’éecrce
O o o„ij ï