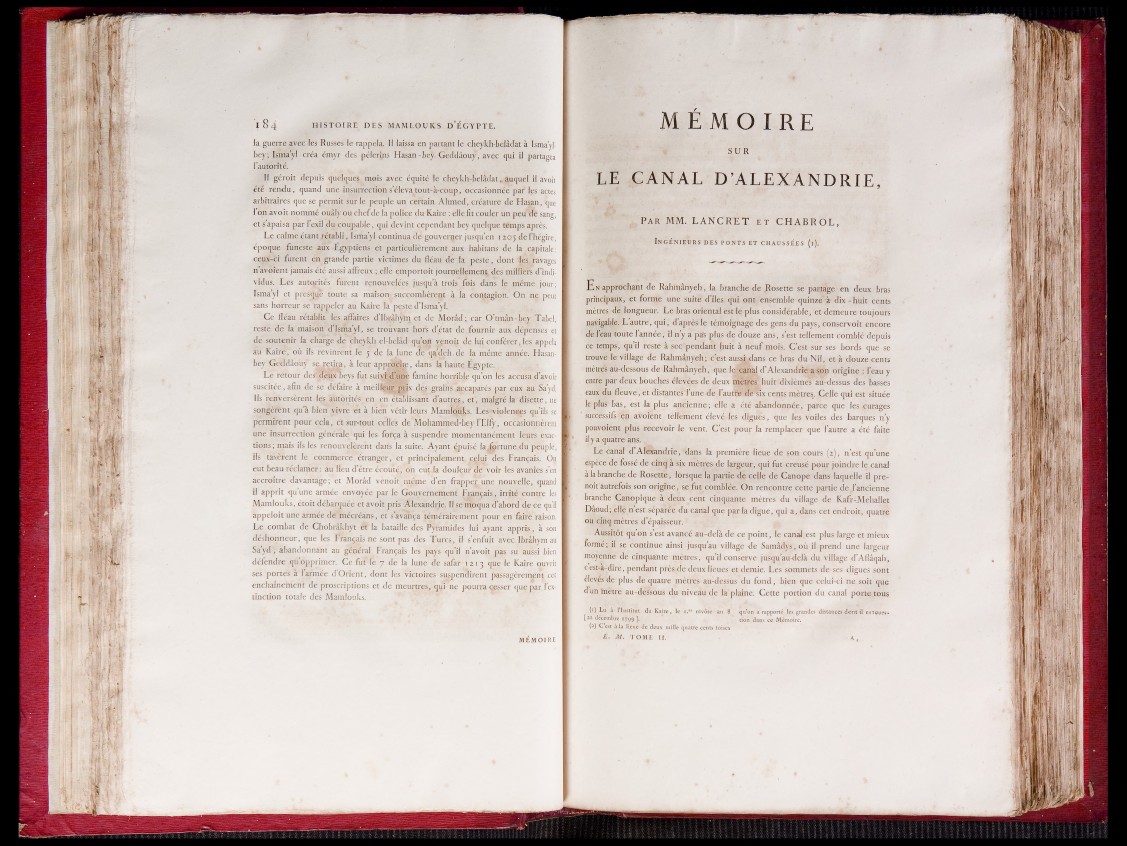
i 8 4 H I S T O I R E D E S MAML O U1CS D EGY PT E.
la guerre avec les Russes le rappela. Il laissa en partant le cheykh-belâdat à Ismayl-
bey ; Ismayl créa émyr des pèlerins Hasan-bey Geddâouy, avec qui il partagea
l’autorité.
Il géroit depuis quelques mois avec équité le cheykh-belâdat, auquel il avoit
été rendu, quand une insurrection s’éleva tout-à-coup, occasionnée par les actes
arbitraires que se permit sur le peuple un certain Ahmed, créature de Hasan, Lie
l’on avoit nommé ouâly ou chef de la police du Kaire : elle fit couler un peu de sang,
et s apaisa par l’exil du coupable, qui devint cependant bey quelque temps après.
Le calme étant rétabli, Ismayl continua de gouverner jusqu’en 1205 de l’hégire,
époque funeste aux Egyptiens et particulièrement aux habitans de la.capitale:
ceux-ci furent en grande partie victimes du fléau de fa peste, dont les ravages
n’avoient jamais été aussi affreux ; elle emporteit journellement, des milliers d’individus.
Les autorités furent renouvelées jusqu’à trois fois dans le même jour;
Ismayl et presque toute sa maison, succombèrent à la contagion. On ne peut
sans horreur se rappeler au Kaire la peste d’Isma’yl.
Ce fléau rétablit les affaires d’Ibrâhym et de Morâd; car O’tmân-bey Tabel,
reste de la maison d’Isma’y l, se trouvant hors d’.ctat de fournir aux dépenses et
de soutenir la charge de cheykh el-belàd qu’on venoit de lui conférer, les appela
au Kaire, ou ils revinrent le y de la lune de qa’deh.de la même année. Hasan-
bey Geddâouy se retira, à leur apprtiche, dans la haute Egypte....
Le retour des deux beys fut suivi d’une famine horrible qu’on les accusa d’avoir
suscitée, afin de se défaire à meilleur pjix des grains .accaparés par eux au Sa’yd.
Ils renversèrent les autorités en en établissant d’autres., et, malgré la disette, 11e
songèrent qu’à bien vivre et à bien vêtir leurs Mamloüks. Les ►violences qu’ils se
permirent pour cela, et sur tout celles de Mohammed-bey l’Elfÿ, occasionnèrent
une insurrection générale qui les força à suspendre momentanément leurs exactions;
mais ils les renouvelèrent dans la suite. Ayant épuisé la Jprtune du peuple,
ils taxèrent le commerce étranger, et principalement celui des Français. O11
eut beau réclamer : au lieu d’être écouté, on eut la douleur de: voir les avanies s’en
accroître davantage; et Morâd venoit même d’en frapper une nouvelle, quand
il apprit quune armée envoyée par le Gouvernement Français, irrité contre les
Mamloüks, étoit débarquée et avoit pris Alexandrie. Il se moqua d’abord de ce qu’il
appeloit une armée de mécréans, et s’avança témérairement pour en faire raison.
Le combat de Chobrâkhyt et la bataille des Pyramides lui ayant appris, à son
déshonneur, que les Français ne sont pas des Turcs, il s’enfuit avec Ibrâhymau
Sayd, abandonnant au général Français les pays qu’il n’avoit pas su aussi bien
défendre qu’opprimer. Ce fut le 7 de la lune de safar 121 3 que le Kaire ouvrit
ses portes a 1 armée d Orient, dont les victoires suspendirent passagèrement cet
enchaînement de proscriptions et de meurtres, qui ne pourra cesser que par l’extinction
totale des Mamloüks.
m é m o i r e
MÉMOIRE
S U R
LE CANAL D’ALEXANDRIE,
P a r MM. L A N C R E T e t C H A B R O L ,
I n g é n i e u r s d e s p o n t s e t c h a u s s é e s ( i ) .
E n approchant de Rahmânyeh, la branche de Rosette se partage en deux bras
priheipaux, et fonne une suite d’îles qui ont ensemble quinze à dix - huit cents
mètres de longueur. Le bras oriental est le plus considérable, et demeure toujours
navigable. L ’autre, qui, d’après le témoignage des gens du pays, conservoit encore
de l’eau toute l’année, il n’y a pas plus de douze ans, s’est tellement comblé depuis
ce temps, qu’il reste à sec'pendant huit à neuf mois. C’est sur ses bords que se
trouve le village de Rahmânyeh; c’est ausâxfans ce bras du Nil, et à douze cents
métrés au-dessous de Rahmânyeh, que le canal d’Alexandrie a son origine : l’eau y
entre par deux bouches élevées de deux mètres huit dixièmes au-dessus des basses
eaux du fleuve, et distantes l’une de l’autre de six cents mètres. Celle qui est située
le plus bas, est la plus ancienne; elle a été abandonnée, parce que les curages
successifs^en avoient tellement élevé les digues, que les voiles des barques n’y
pouvoient plus recevoir le vent. C ’est pour la remplacer que l’autre a été faite
il y a quatre ans.,
Le canal d Alexandrie, dans la première lieue de son cours. (2), n’est qu’une
espece de fossé de cinq à six mètres de largeur, qui fut creusé pour joindre le canal
a la branche de Rosette, lorsque la partie de celle de Canope dans laquelle il pre-
noit autrefois son origine, se fut comblée. On rencontre cette partie de l’ancienne
branche Canopique à deux cent cinquante mètres du village de Kafr-Mehallet
Daoud; elle n est séparée du canal que parla digue, qui a, dans cet endroit, quatre
ou cinq mètres d’épaisseur.
Aussitôt qu on s est avancé au-delà de ce point, le canal est plus large et mieux
forme; il se continue ainsi jusqu’au village de Samâdys, où il prend une largeur
moyenne de cinquante mètres, qu’il conserve jusqu’au-delà du village d’Aflâqali,
cest-a-dire, pendant près de deux lieues et demie. Les sommets de ses digues sont
élevés de plus de quatre mètres au-dessus du fond, bien que celui-ci ne soit que
d un Inetre au-dessous du niveau de la plaine. Cette portion du canal porte tous
(1) Lu a 1 Institut du Kaire { le i.er nivôse
22 décembre 1799 ].
[2) C est à ia lieue de deux mille quatre cents t
Ê . M . T O M E II.
8 qu’on a rapporté les grandes distances dont il estaues-
tion dans ce Mémoire.