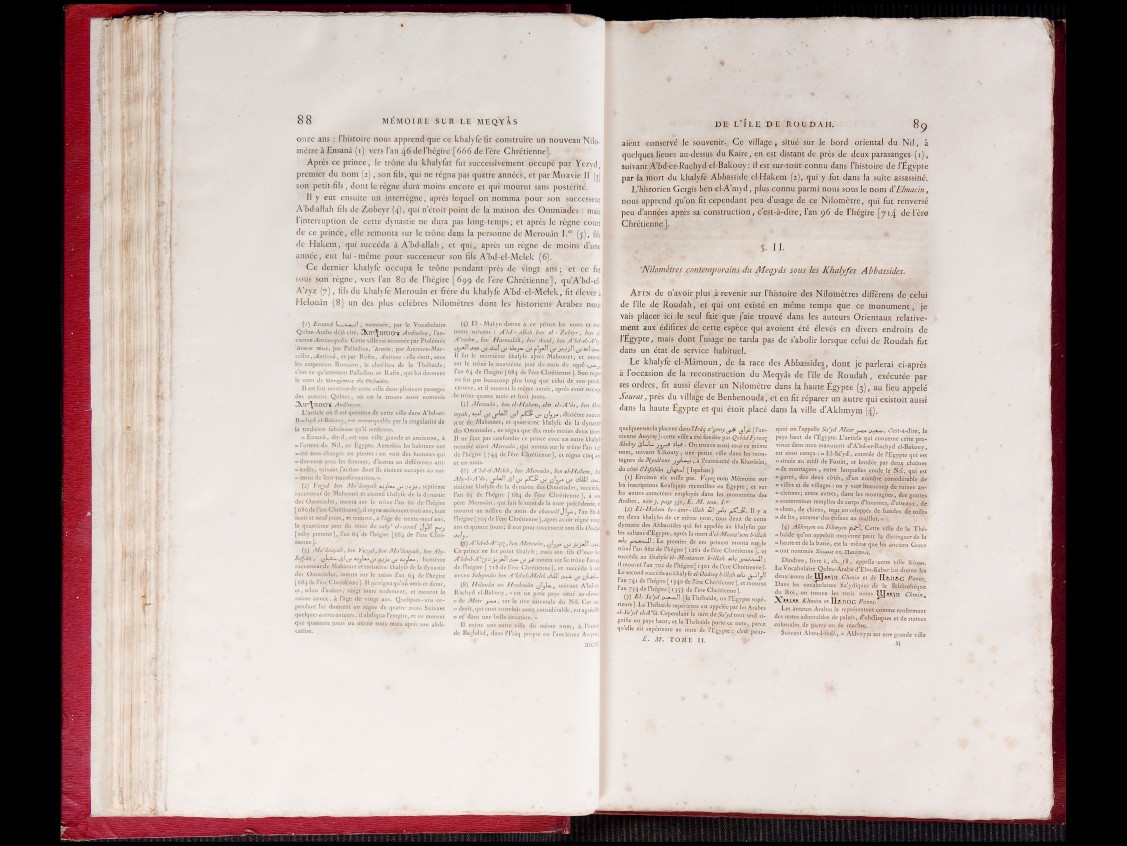
onze ans : l’histoire nous apprend que ce khalyfe fit construire un nouveau Nilo-
Biètre à Ensanâ (i) vers l’an 4 6 de l’hégire [666 de l’ère Chrétienne}:
Après ce prince, le trône du khalyfat fut successivement occupé par Yezyd S
premier du nom (2), son fils, qui ne régna pas quatre années, et par Moavie II M
son petit-fils, dont le règne dura moins encore et qui mourut sans postérité.
Il y eut ensuite un interrègne, après lequel on nomma pour son successeur I
A ’hd-allah fils de Zoheyr (4), qui n’étoit point de la maison des Ommiades : mais I
Iinterruption de cette dynastie ne dura pas long-temps; et après le règne courtI
de ce prince, elle remonta sur le trône dans la personne de Merouân I ." (5), fils
de Hakem, qui succéda à A ’bd-allah , et qui, après un règne de moins d’une I
année, eut lui-même pour successeur son fils A ’bd-'el-Melek (6).
Ce dernier khalyfe occupa le trône pendant ' près de vingt ans ; et ce fut I
sous son règne, vers l’an 80 de l’hégire [699 de lere Chrétienne], qu’A ’bd-el-l
A ’zyz (7), fils du khalyfe Merouân et frère du khalyfe A ’bd-el-Melek, fit élever il
Helouân (8) un des plus célèbres Nilomètres dont les historiens Arabes nous
(1) Ensanâ l— , nommée, par le Vocabulaire
■Qobte-Arabe déjà cité, Andinoou, l’ancienne
Antinoopolis. Cette ville est nommée par Ptolémée
Am w -mfjç; par Palladius, ‘Arvrév; par Ammien-Mar-
cellin, Antinoü , et par Rufin, Antinoo : elle étoit, sous
les empereurs Romains, le chef-lieu de la Thébalde;
cest ce qu’attestent Palladius et Rufin, qui lui donnent
le nom de MuTÇÿwoA/c vis QnfbaiJbç.
11 est fait mention de cette ville dans plusieurs passages
des auteurs Qobtes, où on la trouve aussi nommée
Andinoou.
L ’article où il est question de cette ville dans A’bd-er-
Rachyd el-Bakouy, est remarquable par la singularité de
la tradition fabuleuse qu’il renferme.
« Ensanâ, dit-il, est une ville grande et ancienne, à
» l’orient du N il, en Egypte. Autrefois les habitans ont
a» été tous changés en pierres : on voit des hommes qui
»dorment avec les femmes, d’autres en différentes atti-
» tudes, suivant l’action dont ils étoient-occupés au mo-
» ment de leur transformation. »
(2) Yezyd ben M o ’âouyah u jü u ^ , septième
successeur de Mahomet et'sëcond khalyfe de la dynastie
des Ommiades, monta sur le trône l’an 60 de l’hégire
[ 680 de l’èrc Chrétienne]; il régna seulement trois ans, huit
mois et neuf jours, et mourut, à l’âge de trente-neuf ans,
le quatrième jouT du mois de raby’ el-aouel JjVI g j j
[raby premier], l’an 64 de l’hégire [684 de l’ère Chrétienne].
(3) M o ’âouyah, ben Yezyd, ben M o ’âouyah, ben Aby-
Sojÿan , qLôlw UjUm , huitième
successeur de Mahomet et troisième khalyfe de la dynastie
des Ommiades, monta sur le trône l’an 64 de l’hégire
[684 de l’ère Chrétienne]. 11 ne régna qu’un mois et demi,
et, selon d’autres, vingt jours seulement, et mourut la
même année, à l’âge de vingt ans. Quelques-uns cependant
lui donnent un règne de quatre mois. Suivant
quelques autres auteurs, il abdiqua l’empire, et ne mourut
que quarante jours ou même trois mois après son abdication.
(4) El - Makyn donne à ce prince les noms et sur-
noms suivans : Al bd - allah ben el - Zobeyr, ben tl-
A ’ouârn, ben Harmalah, ben Asad, ben A ’bd-el-A’ry
[ y » A»| Oac, 1
II fut le neuvième khalyfe après Mahomet, et montaj
sur le trône le neuvième jour du mois de regeb o a . j J
l’an 64 de l’hégire [684 de l’ère Chrétienne]. Son règneI
ne fut pas beaucoup plus long que celui de son prédé-l
cesseur, et il mourut la même année, après avoir occupél
le trône quatre mois et huit jours.
(5) Merouân, ben el-Hakem, ebn e l-A ’âs,ben OmM
myah, q j ^ ( j î j j* , diixieme succès-1
seur de, Mahomet, et quatrième khalyfe de la dynastieB,
des Ommiades, ne régna que dix mois moins deux jours.
Il ne faut pas confondre ce prince avec un autre khalyfej
nommé aussi Merouân, qui monta sur le trône l’an 127m •
de l’hégire [744 de l’ère Chrétienne], et régna cinqamH
et un mois.
{6) A ’bd-el-Melek, ben Merouân, ben el-Hakem, k il
Aby-l-A’âs, joUJI ^ ^ cilUl i\ae, |
sixième khalyfe de la dynastie des Ommiades, succéda,H
l’an 65 de l’hégire [ 684 de l’ère Chrétienne], à sooH
père Merouân, qui fart le sujet de la note précédente, « H
mourut au milieu du mois de chaouâl J l^ i, l’an 86 di
l’hegire [705 de l’ère Chrétienne], après avoir régné vingt!
ans et quinze jours; il eut pour successeur son fils
(7) A ’bd-el-AJzyz, ben Merouân, (jLj-o ^ JjJjJI
Ce prince ne fut point khalyfe ; mais son fils O’mar kl
A ’bd-el-A’z y z 0-^ q jmo n t a sur le trône l’an 95
de l’hegire [ 718 de l’ère Chrétienne], et succéda à son
neveu Soleymân ben A ’bd-el-Melek cslUf ^ yLcL..
(8) Helouân ou Houlouân y Lia. , suivant A’bd-er-l
Rachyd el-Bakouy, «est un petit pays situé au-dessus
» de Mesr , sur la rive orientale du Nil. Cet en-
» droit, qui etoit autrefois assez considérable, est agréable|
» et dans une belle situation. »
11 existe une autre ville du même nom, à l’orient|
de BaghdAd, dans l’ I’râq propre ou l’ancienne Assyrii
aienn
hï-f biiifns
1SSF
aient conservé le souvenir. Ce village, situé sur le bord oriental du N il, à
quelques lieues au-dessus du Kaire, en est distant de près de deux parasanges m
suivant A’bd-er-Rachyd el-Bakouy: il est sur-tout connu dans l’histoire de l’Égypte
par la mort du khalyfe Abbasside el-Hakem (2), qui y iut dans la suite assassiné.
L ’historien Gergis ben el-A’myd, plus connu parmi nous sous le nom d'Elmacin,
nous apprend qu’on fit cependant peu d’usage de ce Nilomètre, qui fut renversé
peu d’années après sa construction, c’est-à-dire, l’an 96 de l’hégire [7 14 de 1ère
Chrétienne].
{ II-
'Nilomètres contemporains du Meqyâs sous les Khalyfes Abbassides.
A f in de n’avoir plus à revenir sur l’histoire des Nilomètres différens de celui
de l’île de Roudah, et qui ont existé en même temps que ce monument, je
vais placer ici le seul fait que j’aie trouvé dans les auteurs Orientaux relativement
aux édifices de cette espèce qui avoient été élevés en divers endroits de
I Égypte, niais dont l’usage ne tarda pas de s’abolir lorsque celui de Roudah fut
dans un état de service habituel.
Le khalyfe el-Mâmoun, de la race des Abbassides, dont je parlerai ci-après
a 1 occasion de la reconstruction du Aâeqyas de 1 île de Roudah , exécutée par
ses ordres, fit aussi élever un Nilomètre dans la haute Égypte (3), au lieu appelé
Sourat, près du village de Benbenouda, et en fit réparer un autre qui existoit aussi
dans la haute Égypte et qui étoit placé dans la ville d’Akhmym (4).
quelques-uns la placent dans VIrâq a’gemy ^ ^ [l’ancienne
Assyrie] : cette ville a été fondée par QobâdFyrouz
Sasâny ¿LvLv j jyfP ¿Là . On trouve aussi sous ce même
nom, suivant Yakouty, une petite ville dans les montagnes
de Nysâbour jjjLajÔ , à l’extrémité du Khorâsân,
du côté d’Isfahân qI^u.1 [Ispahan].
(1) Environ six mille pas. Voyez mon Mémoire sur
les inscriptions Koufiques recueillies en Égypte, et sur
les autres caractères employés dans les monumens des
Arabes, notej, page j jo , È. M . tom. I ."
(2) El-Hakem be-amr-illah ,wl A ? -II. II y a
eu deux khalyfes de ce mente nom, tous deux de cette
dynastie des Abbassides qui fut appelée au khalyfat par
les sultans d’Egypte, après la mort à’el-Mosta’sem b-illah
wlj . Le premier de ces princes monta sur le
trône l’an 660 de l’hégire [ 1261 de l’ère Chrétienne], et
succéda au khalyfe el-Mostanser b-illah «m(j i ..{ f .
il mourut l’an 701 de l’hégire [ 1301 de l’ère Chrétienne].
Le second succédaau khalyfe el-Ouâteq b-illah «L ¿ j U I
l’an 741 de l’hégire [ 134.0 de l’ère Chrétienne], et mourut
l’an 754 de l’hégire [ 1353 de l’ère Chrétienne].
(3) El- Sa’yd ixui-ajf [laThébaïde, ou l’Egypte supérieure].
LaThébaïde supérieure est appelée par les Arabes
el-Sa’yd el-A’la. Cependant le mot de ia>rftout seul signifie
un pays haut; et la Thébaïde porte ce nom, parce
qu’elle est supérieure au reste de ’l'Egypte : cîest pourÉ
. M . T O M E II.
quoi on l’appelle Sa’yd Mesr ^ o ^ t - , c’est-a-dire, le
pays haut de l’Égypte. L’article qui concerne cette province
dans mon manuscrit d’A’bd-er-Rachyd el-Bakouy,
est ainsi conçu : «El-Sa’yd, contrée de I’Égypte qui est
»située au midi deFostât, et bordée par deux chaînes
»de montagnes , entre lesquelles coule le N i l, qui est
»garni, des deux cotes,td’un nombre considérable de
» villes et de villages : on y voit beaucoup de ruines an-
»ciennes; entre autres, dans les montagnes, des grottes
» souterraines remplies de corps d’hommes, d’oiseaux, de
»chats, de chiens,, tous ^enveloppés de bandes de toiles
» de lin, comme des enfans au maillot. » *.
(4) Akhrnym ou Ikhmym e^ \ . Cette ville de la Thé-
» baïde qu’on appeloit moyenne’ pour la distinguer de la
» haute et de la basse, est la même que les anciens Grecs
» ont nommee Xtupus ou <Hcarom\iç^
Diodore, livre 1, ch.. iS , appelle cette ville Xt^ o.
Le Vocabulaire Qobte-Arabe d’Ebn-Kabar lui donne les
deux noms de Chrnin et de IÏ2..ÎÏ&.C Panas
Dans les vocabulaires Sa’ydiques de la Bibliothèque
du Roi, on trouve les trois noms Chmin,
Khmim et ïl& ttO C Panos.
Les auteurs Arabes la représentent comme renfermant
des restes admirables de palais,,d’obélisques et de statues
colossales de pierre ou de marbre.
Suivant Abou-I-fedâ, « Akhmym est une grande ville
M