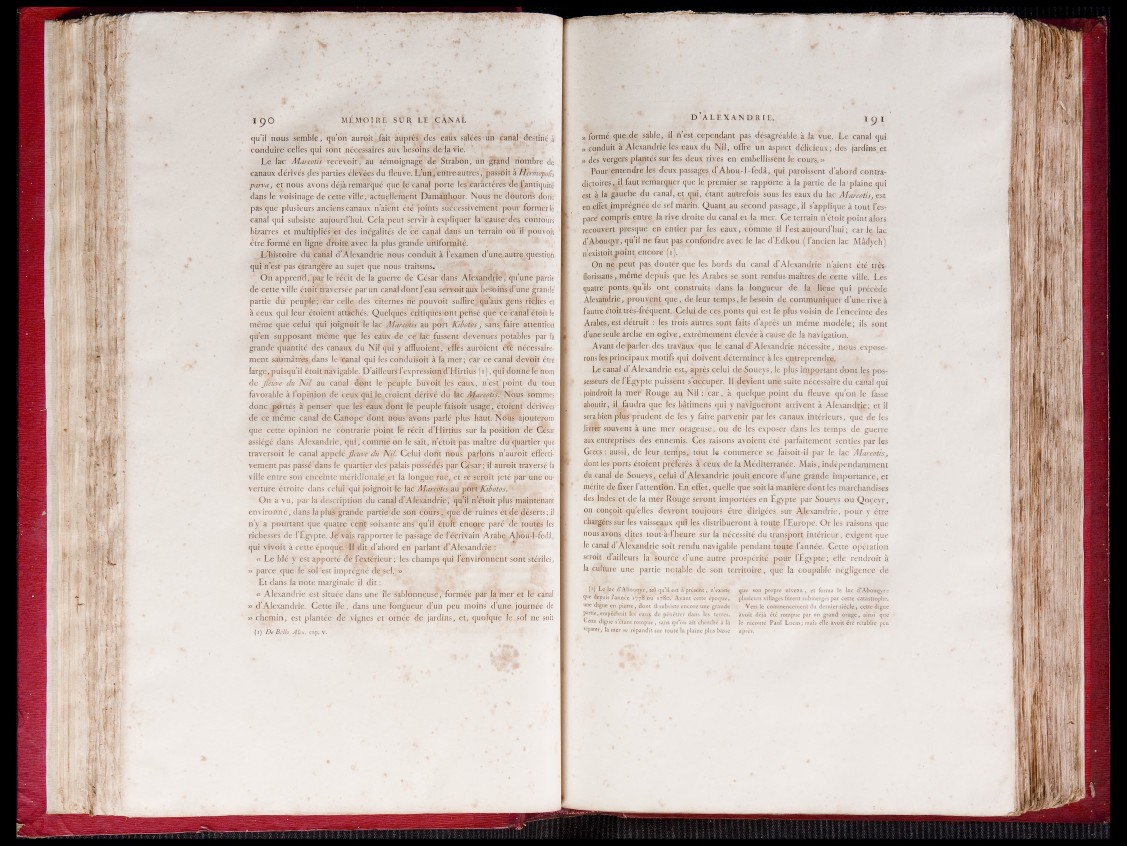
qu’il nous semble, qu’on auroit fait auprès des eadix salées un canal'destiné à
conduire celles qui sont nécessaires aux besoins de la vie.
Le lac Mareotis recevoir, au témoignage de Strabon, ùn grand nombre de
canaux dérivés des parties élevées du fleuve. L ’un, entreautres, passôit à Hermopolis
parva, et nous avons déjà remarqué que le canal porte les Caractères de l’antiquité
dans le voisinage de cette ville, actuellement Damanhour. Nous ne doutons donc
pas que plusieurs anciens canaux n’aient été ’joints successivement pour former lé
canal qui subsiste aujourd’hui. Cela peut servir à expliquer la cause'des contours
bizarres et multipliés et des inégalités de ce canal dans un terrain où il pouvoit
être formé en ligne droite avec la plus grande uniformité.
L ’histoire du canal d’Alexandrie nous conduit à l’examen d’une.autre question
qui n’èst pas étrangère au sujet que nous traitons.
On apprend, par le récit de la guerre de César dans Alexandriequ’une partie
de cette ville étoit traversée par un canal dont l’eau servoit aux besoins d’une grande
partie du peuple;'car celle des citernes ne pouvoit suifieS’sp’âux gens riches et
à ceux qui leur étoient attachés. Quelques critiques ont pensé que ce canal étoit le
même que celui qui joignoit le lac Mareotis au port Kibotos ,r sans faire attention
qtr’en supposant même que les eaux de ce lac fussent devenues potables par la
grande quantité des canaux du Nil qui y affluoient, elles auroient été nécessairement
saumâtres dans le Canal qui les conduisoit à la mer; car ce canal devoit être
large, puisqu’il étoit navigable. D ’ailleurs l’expression d’Hirtius ( i ), qui donné le nom
de fleuve du N il au canal dont le peuple buvoit |es eaux, n’est'point du tout
favorable à l’opinion de ceux qui le .croient dérivé du lac Mareotisi' Nous sommes
donc portés à penser que les eaux dont le peuple faisoit usage, étoient dérivées
de ce même canal de Canope dont nous avons parlé plus haut. Notis ajouterons
que cette opinion ne contrarie point le récit d’Hirtius sur la position de <^sar
assiégé dans Alexandrie, qui, comme on le sait, n’étoit pas maître dû’quartier que
traversoit le canal appelé fleuve du Nil. Celui dont nous parlons n’auroit effectivement
pas passé dans le quartier des palais possédés par César ; il auroit traversé la
ville entre son enceinte méridionale et la longue rue, et se seroit jeté par une ouverture
étroite dans celui qui joignoit le lac Mareotis au r>ort’Kibotos."<
On a vu, par la description du canal d’Alexandrie, qu’il n’étoit plus maintenant
environné, dans la plus grande partie de son côürs, qùéde ruines étde déserts; il
n’y a pourtant que quatre cent soixante ans1 qu’il étoit- encore paré de toutes les
richesses de l’Egypte. Je vais rapporter le passage de l’écrivain Arabe Abou-l-fedâ,
qui vivoit à cette époque. Il dit d’abord en parlant d’Alexandrie :
« Le blé y est apporté dé l’extérieur ; les champs qui l’environnent sont stériles,
» parce que le sol ‘est imprégné de sel. »
Et dans la note marginale il dit ;
« Alexandrie est située dans une île sablonneuse,"formée par la mer et le canal
» d’Alexandrie. Cette île, dans une longueur d’un peu moins d’une journée de
» chemin, est plantée de vignes et ornée de jardins, et, quoique le sol ne soit
(i) De Bello y^lex. cap. v.
D A L E X A N D R I E . I Q I
» formé que de sable, il n’est cependant pas désagréable à la vue. Le canal qui
» conduit à Alexandrie les eaux du Nil, offre un aspect délicieux; des jardins.et
» des vergers plantés' sur les deux rives en embellissent le cours. »
Pour entendre les deux passages d’Abou-l-fedâ, qui paroissent d’abord contra-
diçtoires ,.il faut remarquer que le premier se rapporte à la partie de la1 plaine qui
est à la gauche du canal, et qui, étant autrëfois sous les eaux du lac Mareotis, est
e n effet imprégnée de sel marin. Quant au second passage, il s’applique à tout l’espace'
compris entre la rive droite du canal et la mer. Ce terrain n’étoit point alors
recouvert presque en entier par les eaux, comme il l’est aujourd’hui ; car le lac
d’Abouqyr, qu’il ne faut pas confondre avec le lac d’Edkou ( l’ancien lac Mâdyeh)
n’existoitjioint encore (i).
On ne peut pas douter que les bords du canal d’Alexandrie n’aient été très-
florissans, même depuis que l'es Arabes se sont rendus maîtres de cette ville. Les
quatre ponts qu’ils ont construits dans la longueur de la lieue qui précède
, Alexandrie, prouvent que, de leur temps, le besoin de communiquer d’une rive à
l’autre étoit très-fréquent. Celui de ces ponts qui est le plus voisin de l’enceinte des
Arabes, est détruit : les trois autres sont faits d’après un même modèle; ils sont
d’une seule arche en ogive, extrêmement élevée à cause de la navigation.
Avant de parler.des travaux que le canal d’Alexandrie nécessite, nous exposerons
les principaux motifs qui doivent déterminer à les entreprendre.
Le canal d Alexandrie est, après celui de Soueys, le plus important dont les possesseurs
de l’Egypte puissent s’occuper. Il devient une suite nécessaire du canal qui
joindrait la mer Rouge au Nil : ca r, à quelque point du fleuve qu’on le fasse
aboutir, il faudra que les bâtimens qui y navigueront arrivent à Alexandrie; et il
sera bien plus; prudent de les y faire parvenir parles canaux intérieurs, que de les
.livrer souvent à une mer orageuse, ou de les exposer dans les temps de guerre
aux entreprises des ennemis. Ces raisons avoient été parfaitement senties par les
Grecs : aussi, de leur temps, tout le commerce se faisoit-il par le lac Mareotis,
dont les ports étoient préférés à ceux de la Méditerranée. Mais, indépendamment
du canal de Soueys, celui d’Alexandrie jouit encore d’une grande importance, et
mérite de fixer l’attention. En effet, quelle que soit la manière dont les marchandises
des Indes et de la mer Rouge seront importées en Egypte par Soueys ou Qoçeyr,
on conçoit qu’elles devront toujours être dirigées sur Alexandrie, pour y être
chargées sur les vaisseaux qui les distribueront à toute l’Europe. Or les raisons que
nous avons dites tout-à-l’heure sur la nécessité du transport intérieur, exigent que
le canal d’Alexandrie soit rendu navigable pendant toute l’année. Cette opération
seroit d ailleurs la source d’une autre prospérité poiir l’Egypte; elle rendrait à
la culture une partie notable de son territoire, que la coupable négligence de
pi
!
(i) Le lac d’Abouqyr, tel qu’il est à présent, n’existe
que depuis l’année 1778 ou 1780. Avant cette époque,
une digue en pierre, dont il subsiste encore une grande
partie, empêchoit les eaux de pénétrer dans les terres.
Cette digue s’étant rompue, sans qu’on ait cherché à la
reparer, la mer se répandit sur toute la plaine plus basse
que son propre niveau , et forma le lac d’Abouqyr :
plusieurs villages furent submergés par cette catastrophe.
Vers le commencement du dernier siècle, cette digue
avoit déjà été rompue par un grand orage, ainsi que
le raconte Paul Lucas; mais elle avoit été rétablie peu
après.
I