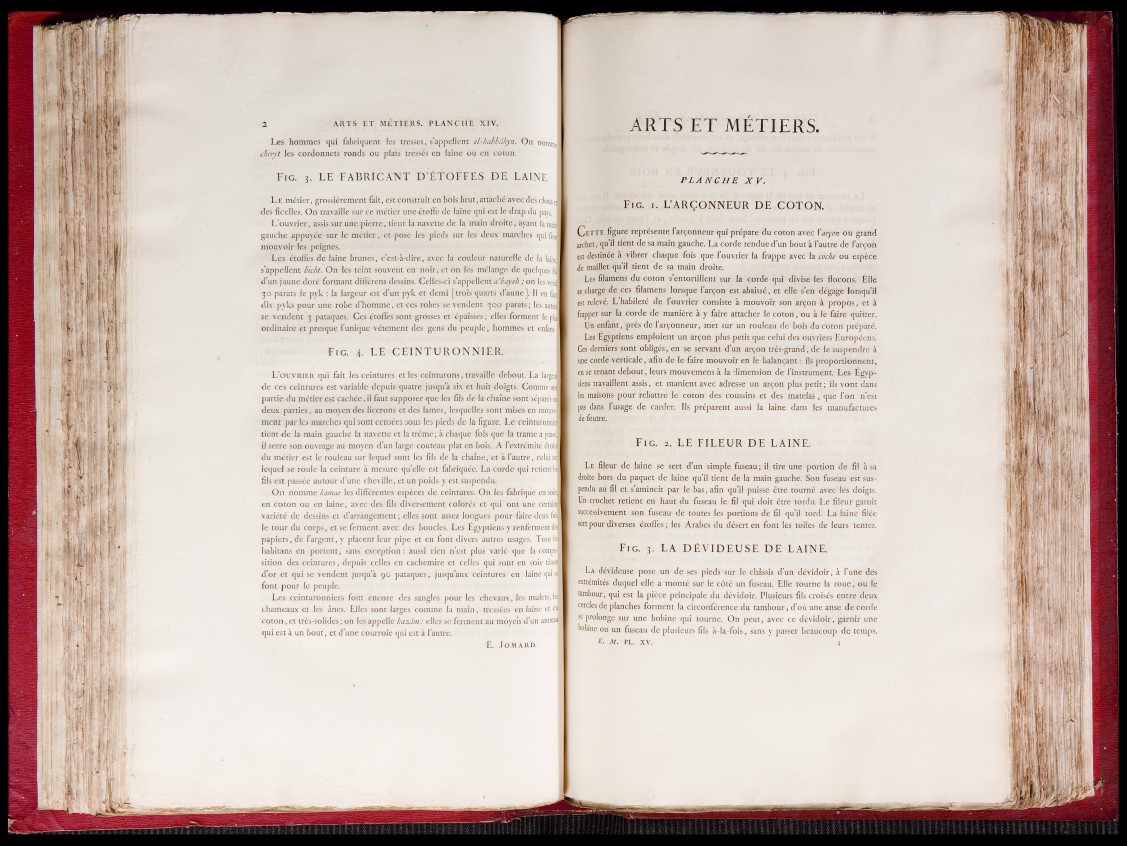
Les hommes qui fabriquent les tresses, s’appellent el-habbâhyn. On noms»
cheryt les cordonnets ronds ou plats tressés en laine ou en coton.
Fie. 3. LE FABRICANT D ’ÉTOFFES DE LAINE, j
L e m é t i e r , g r o s s i è r e m e n t f a i t , e s t c o n s t r u i t e n b o i s b r u t , a t t a c h é a v e c d e s c l o u s a
d e s f i c e l l e s . O n t r a v a i l l e s u r c e m é t i e r u n e é t o f f e d e l a i n e q u i e s t l e d r a p d u pays,
L ’ouvrier, assis sur une pierre, tient la navette de la main droite, ayant la main
gauche appuyée sur le métier, et pose les pieds sur les deux marches qui fon|
mouvoir les peignes.
Les étoffes de laine brunes, c’est-à-dire, avec la couleur naturelle de la laine!
s’appellent bicht. On les teint souvent en noir, et on les mélange de quelques ü||
d’un jaune doré formant diftèrens dessins. Celles-ci s’appellent abayeh ; on les venl
30 parats Je pyk : la largeur est d’un pyk et demi [trois quarts d’aune]. Il en faj
dix pyks pour une robe d’homme, et ces robes se vendent 300 parats; les autres!
se vendent 3 pataquès. Ces étoffes sont grosses et épaisses ; elles forment le plj
ordinaire et presque l’unique vêtement des gens du peuple, hommes et enfans.I
Fig. 4. LE CEINTURONNIER.
L ’o u v r i e r qui fait les ceintures et les ceinturons, travaille debout. La largeul
de ces ceintures est variable depuis quatre jusqu’à six et huit doigts. Comme uni
partie du métier est cachée, il faut supposer que les fils de la chaîne sont séparés el
deux parties, au moyen des licerons et des lames, lesquelles sont mises en mouvtl
ment par les marches qui sont censées sous les pieds de la figure. Le ceinturonniel
tient de la main gauche la navette et la trême ; à chaque fois que la trame a passé!
il serre son ouvrage au moyen d’un large couteau plat en bois. A l’extrémité droite
du métier est le rouleau sur lequel sont les fils de la chaîne, et à l’autre, celuisui
lequel se roule la ceinture à mesure quelle est fabriquée. La corde qui retientlel
fils est passée autour d’une cheville, et un poids y est suspendu.
On nomme kamar les différentes espèces de ceintures. O11 les fabrique en soie!
en coton ou en laine, avec des fils diversement colorés et qui ont une certain!
variété de dessins et d’arrangement ; elles sont assez longues pour faire d eu x fo il
le tour du corps, et se ferment avec des boucles. Les Egyptiens y renfermentdei
papiers, de l’argent, y placent leur pipe et en font divers autres usages. T o u s lest
habitans en portent, sans exception : aussi rien n’est plus varié que la com p o l
sition des ceintures, depuis celles en cachemire et celles qui sont en soie tissu*
d’or et qui se vendent jusqu’à 90 pataquès, jusqu’aux ceintures en laine qui !■
font pour le peuple.
Les ceinturonniers font encore des sangles pour les chevaux, les mulets,te
chameaux et les ânes. Elles sont larges comme la main, tressées en laine et en
coton, et très-solides ; on les appelle liazâm : elles se ferment au moyen d’un anneai*
qui est à un bout, et d’une courroie qui est à l’autre.
E. J o m a r d .
P L ANCHE XV.
F ig. 1. L’ARÇONNEUR DE COTON.
C e t t e figure représente l’arçonneur qui prépare du coton avec Garçon ou grand
archet, qu’il tient de sa main gauche. La corde tendue d’un bout à l’autre de l’arçon
est destinée à vibrer chaque fois que l’ouvrier la frappe avec la coche ou espèce
de maillet qu’il tient de sa main droite.
Les filamens du coton s’entortillent sur la corde qui divise les flocons. Elle
se charge de ces filamens lorsque l’arçon est abaissé, et elle s’en dégage lorsqu’il
est relevé. L ’habileté de l’ouvrier consiste à mouvoir son arçon à propos, et à
frapper sur la corde de manière à y faire attacher le coton, ou à le faire quitter.
Un enfant, près de l’arçonneur, met sur un rouleau de bois du coton préparé.
Les Égyptiens emploient un arçon plus petit que celui des ouvriers Européens.
Ces derniers sont obligés, en se servant d’un arçon très-grand, de le suspendre à
une corde verticale, afin de le faire mouvoir en le balançant : ils proportionnent,
en se tenant debout, leurs mouvemens à la dimension de l’instrument. Les Égyptiens
travaillent assis, et manient avec adresse un arçon plus petit ; ils vont dans
les maisons pour rebattre le coton des coussins et des matelas , que l’on n’est
pas dans l’usage de carder. Us préparent aussi la laine dans les manufactures
de feutre.
F i g . 2 . LE FILEUR DE LAINE.
L e fileur de laine se sert d’un simple fuseau; il tire une portion de fil à sa
droite hors du paquet de laine qu’il tient de la main gauche. Son fuseau est suspendu
au fil et s’amincit par le bas, afin qu’il puisse être tourné avec les doigts.
Un crochet retient en haut du fuseau le fil qui doit être tordu. Le fileur garnit
successivement son fuseau de toutes les portions de fil qu’il tord. La laine filée
sen pour diverses étoffes; les Arabes du désert en font les toiles de leurs tentes.
F i g . 3 . LA D É V IDEUS E DE LAINE.
L a dévideuse pose un de ses pieds sur le châssis d’un dévidoir, à l’une des
extrémités duquel elle a monté sur le côté un fuseau. Elle tourne la roue, ou le
tambour, qui est la pièce principale du dévidoir. Plusieurs fils croisés entre deux
cercles de planches forment la circonférence du tambour, d’où une anse de corde
se prolonge sur une bobine qui tourne. On peut, avec ce dévidoir, garnir une
b o b i n e ou un fuseau de p l u s i e u r s fils à-la-fois, sans y passer beaucoup de temps.