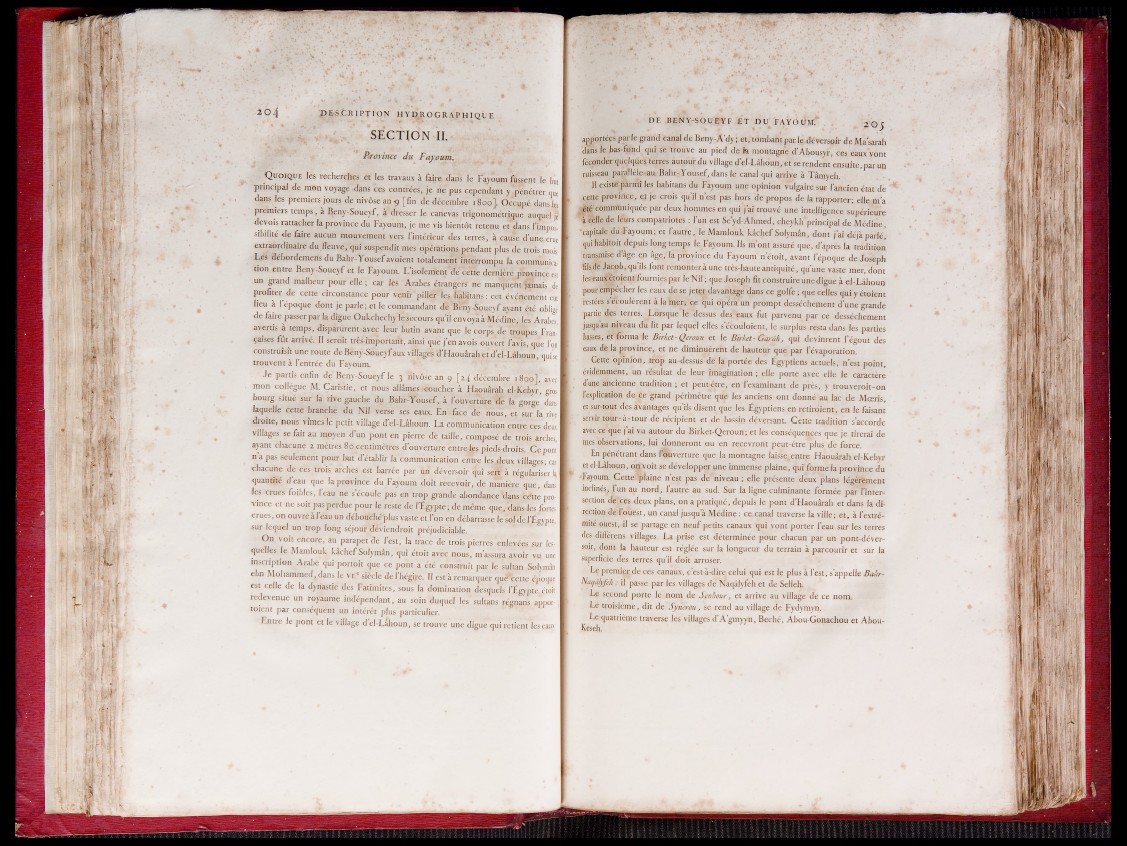
Province du Fayoum.
Q u o iq u e les recherches et les travaux à faire dans le Fayoum fussent le but
principal de mon voyage .dans ces contrées, je ne pus cependant y "pénétrer que
dans les premiers jours de nivôse an 9 [fin de décembre 1800]. Occupé dans fe
premiers temps, à Beny-Soueyf, à dresser le canevas trigonométrique auquel S
devois rattacher la province du Fayoum, je me vis bientôt retenu eEdans l’impos-
sibilite de faire aucun mouvement vers 1 intérieur des terres, à cause d’une crue
extraordinaire du fleuve, qui suspendit mes opérations pendant plus de trois mois.
Les débordemens du Bahr-Yousefavoient totalemenrinterrompu la communication
entre Beny-Soueyf et le Fayoum. L ’isolement de* cette dernière province est
un grand malheur pour elle ; car les Arabes étrangers ne manquent jamais de
profiter de cette circonstance pour venir’piller les hafiitans: cet événement eut
lieu à 1 époque dont je parle; et le commandant de Beny-Soueyf ayant été obligé
de faire passer par la digue Oukchechy le secours qu’il envoya à Médine, les Arabes,
avertis à temps, disparurent avec leur butin avant que le corps de troupes Françaises
.fût arrivé. II seroit très-important, ainsi que j’enavois ouvert l’a'vjs, que l’on
construisît une route de Beny-Soueyf aux villages d’Haouârah et d’el-Lâhoun, qui’se
trouvent à l’entrée du Fayoum.
Je parus enfin de Beny-Soueyf le 3 nivôse an 9 [24 décembre 1800], avec
mon collègue M. Caristie, et nous allâmes - coucher à Haouârah pl-Kebyr, gros
bourg situé sur la rive gauche du Bahr-Yousef, à l’ouverture de la gorge dans
laquelle cette branche du Nil verse ses eaux. En face de nous, et sur la rive
droite, nous vîmes le petit village d’el-Lâhoun. La communication entre ces deux
villages se fait au moyen d un pont en pierre de taille, composé de trois arches,
ayant chacune 2 mètres 80 centimètres d’ouverture entré e s pieds-droits. Ce pont
n a pas seulement pour but d’établir la communication entre les „deux villages; car
chacune de ces trois arches est barrée par un déversoir qui sert à régulariser la I
quantité d’eau que la province du Fayoum doit recevoir, de manière que, dans
les crues foibles, leau ne s’écoule pas en trop grande abondance dans ce'tte province
et ne soit pas perdue pour le reste de l’Égypte ; de même que, dans-lés fortes
crues, on ouvre àl eau un débouché plus vaste et l’on en débarrasse le sol de l’Égypte,
sur lequel un trop long séjour deviendrait préjudiciable.
O n voit encore, au parapet de l’est, la trace de trois pierres‘enlevées sur lesquelles
Je Mamlouk kâchef Solymân, qui étoit avec nous, m’assura avoir vu une
inscription Arabe qui portpit que ce pont a été construit par le sultan Solymân
ebn Mohammed, dans le v i.' siècle de l’hégire. Il est à remarquer quêPcette époque
est celle de la dynastie des Fatimites, sous la domination desquels l’Égypte,étoit
redevenue un royaume indépendant, au soin duquel les’sultans régnans appoi-,
toient par conséquent un intérêt plus particulier.
Entre le pont et le village d’el-Lahoun, se trouve une digue qui retient les eaux
apportées parle grand canal de Beny-A’dy; et, tombantparle déversoir deM à’sarah
dans le bas-fond qui se trouve au pied de la montagne d’Abousyr, ces eaux vont
féconder quelques terres autour du village d’el-Lâhoun, et se rendent ensuite, par un
ruisseau parallèle*au Bahr-Yousef, dans le canal qui arrive à Tâmyeh.
Il existe parmi les habitans du Fayoum une opinion vulgaire sur l’ancien état de '
cette province, et je crois qu’il n’est pas hors de propos de la rapporter; elle m ’a
été’ communiquée par deux hommes en qui j’ai trouvé une intelligence supérieure
à celle de leurs compatriotes : l’un est Se’yd-Ahmed, cheykh principal de Médine,
'capitale du Fayoum; et l’autre, le Mamlouk kâchef Solymân, dont j’ai déjà parié]
qui habitoit depuis long temps le Fayoum. Us m’ont assuré que, d’après la tradition
transmise d’âge m âge, la province du Fayoum n’étoit, avant l’époque de Joseph
ïils d’e Jacob, qu ils font remonter à une très-haute antiquité, qu’une vaste mer, dont
les'eaui étoient fournies par le Nil ; que Joseph fit construire une digue à el-Lâhoun
pour empêcher les eaux de se jeter.davantage dans ce golfe ; que celles qui y étoient
restées s’écoulèrent à la mer, ce qui opéra un prompt dessèchement d’une grande
partie des terres. Lorsque le dessus des'eaux fut parvenu par ce dessèchement
jusqu’au niveau du lit par lequel elles s'écoutaient, le surplus resta dans les parties
basses, et forma le Birket- Qeroun et le Birket- Garâh, qui devinrent l’égout des
eaux de la province, et ne diminuèrent de hauteur que par l’évaporation.
Cette opinion, trop au-dessus de la portée des Égyptiens actuels, n’est point,
évidemment, un résultat de leur imagination ; elle porte avec elle le caractère
dune ancienne tradition ; et peut-être, en l’examinant de près, y trouveroit-on
l’explication de ce grand périmètre que les anciens ont donné au lac de Mceris,
et sur-tout des avantages qu’ils disent que les Égyptiens en retirdient, en le faisant
servir tour-à-tour de récipient et de bassin déversant. Cette tradition s’accorde
avec ce que j ai vu autour du Birket-Qeroun; et les conséquences que je tirerai de
mes observations, lui donneront ou en recevront peut-être plus de force.
En pénétrant dans llSuverture que la montagne laisse,entre Haouârah el-Kebyr
et el-Lâhoun, 011 voit se développer une immense plaine, qui forme la province du
-Fayoum. Cette ‘plaine n’est pas de niveau ; elle présente deux plans légèrement
inclinés, lun au nord, l’autre au sud. Sur la ligne culminante formée par l’intersection
de ces deux plans, on a pratiqué, depuis le pont d'FIaouârah et dans la direction
de 1 ouest, un canal jusqu’à Médine : ce canal traverse la ville; et, à l’extrémité
ouest, il se partage en neuf petits canaux qui vont porter l’eau sur les terres
des difierens villages. La prise est déterminée pour chacun par un pont-déversoir,
dont la hauteur est réglée sur la longueur du terrain à parcourir et sur la
superficie des terres qu’il doit arroser.
Le premigr.de ces canaux, c’est-à-dire celui qui est le plus à l’est, s’appelle Bahr-
Naijâfyfeh : il passe par les villages de Naqâlyfeh et de Selleh.
Lg second porte le nom de Senliour, et arrive au village de ce nom.
Le troisième, dit de Synerou, se rend au village de Fydymyn.
Le quatrième traverse les villages d’A ’gmyyn, Bêché, Abou-Gonachou et Abou-
Keseh.