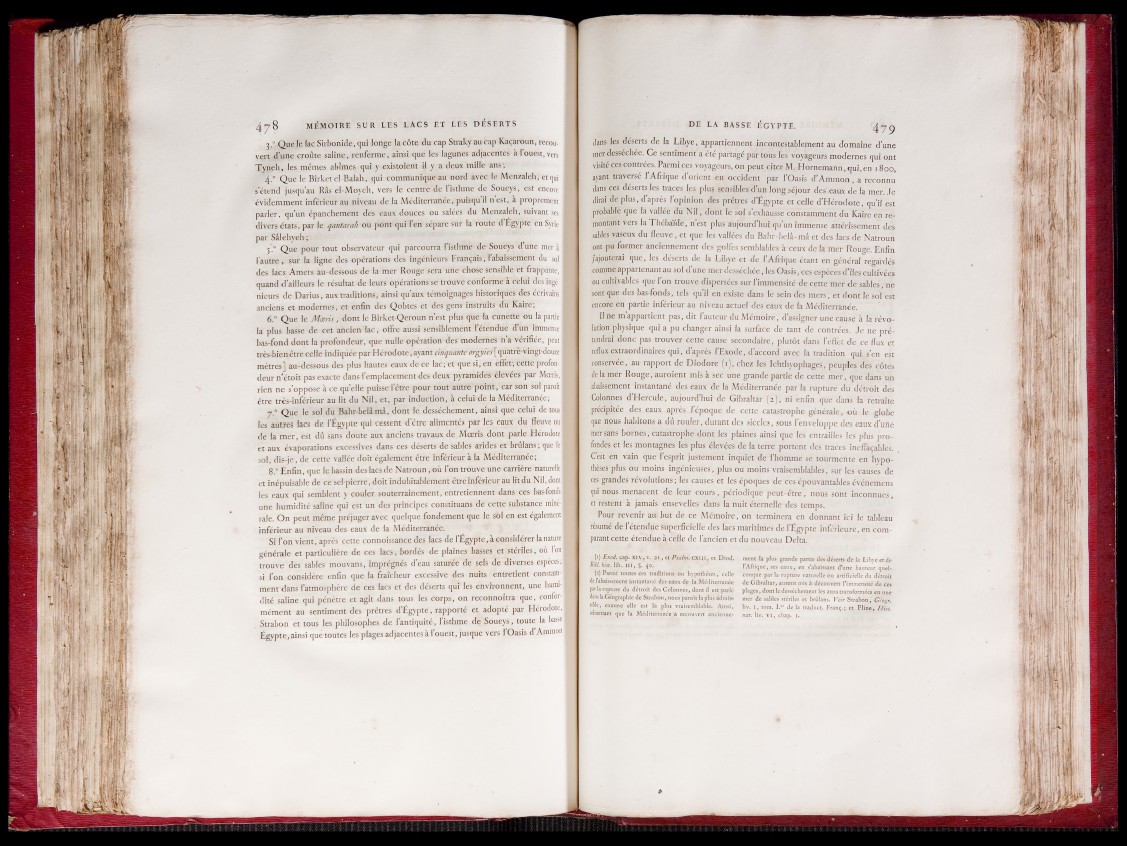
4 7 8 M É M O I R E S U R L E S L A C S E T L E S D É S E R T S
o ° Que le k c Siibofùclè, qui longe la côte du cap Straky au cap Kaçaroun, recouvert
d’une croûte saline, renferme, ainsi que les lagunes adjacentes à 1 ouest, vers
Tyneh, les mêmes abîmes qui y existoient il y a deux mille ans ; 4 .° Que le Birket el-Balah, qui communique au nord avec le Menzaleh, et qui I
s’étend jusqu’au Râs el-Moyeh, vers le centre de 1 isthme de Soueys, est encore I
évidemment inférieur au niveau de la Méditerranée, puisqu il n est, a proprement I
parler, qu’un épanchement des eaux douces ou salées du Menzaleh, suivant ses I
divers états, par le qantarah ou pont qui I en séparé sur la route d Egypte en Syrie I
par Sâlehyeh ;
5.0 Que pour tout observateur qui parcourra l’isthme de Soueys d une mer à I
l'autre, sur la ligne des opérations des ingénieurs Français, l’abaissement du sol i
des lacs Amers au-dessous de la mer Rouge sera une chose sensible et frappante, I
quand d’ailleurs le résultat de leurs opérations se trouve conforme à celui des ingé-1
nieurs de Darius, aux traditions, ainsi qu’aux témoignages historiques des écrivains 1
anciens et modernes, et enfin des Qobtes et des gens instruits du Kaire,
6.° Que le Mæris, dont le Birket-Qeroun n’est plus que la cunette ou la partie I
la plus basse de cet ancien lac, offre aussi sensiblement l’étendue d’un immense I
bas-fond dont la profondeur, que nulle opération des modernes n’a vérifiée, peut I
très-bien être celle indiquée par Hérodote, ayant cinquante itrgy/w [quatre-vingt-douze I
mètres] au-dessous des plus hautes eaux de ce lac; et que si, en effet; cette profon-1
deur n etoit pas exacte dans l’emplacement des deux pyramides élevées par Mæris, I
rien ne s’oppose à ce qu’elle puisse l’être pour tout autre point, car son sol paroîtl
être très-inférieur au lit du Nil, et, par induction, à celui de la Méditerranée;
7.° Que le sol du Bahr-belâ-mâ, dont le dessèchement, ainsi que celui de tous ■
les autres lacs de l’Égypte qui cessent d’être alimentés par les eaux du fleuve oui
de la mer, est dû sans doute aux anciens travaux de Mæris dont parle HérodoteI
et aux évaporations excessives dans ces déserts de sables arides et brûlans; que le
sol, dis-je, de cette vallée doit également être inférieur à la Méditerranée;
g.” Enfin, que le bassin des lacs de Natroun, où l’on trouve une carrière naturelle I
et inépuisable de ce sel-pierre, doit indubitablement être inférieur au lit du Nil, dont I
les eaux qui semblent y couler souterrainement, entretiennent dans ces bas-fondsl
une humidité saline qui est un des principes constituans de cette substance miné-1
raie. On peut même préjuger avec quelque fondement que le sol en est également!
inférieur au niveau des eaux de la Méditerranée.
Si l’on vient, après cette connoissance des lacs de l’Égypte, à considérer la n a t u r e I
générale et particulière de ces lacs, bordés de plaines basses et stériles, où l ’o n 1
trouve des sables mouvans, imprégnés d’eau saturée de sels de diverses espèces;!
si l’on considère enfin que la fraîcheur excessive des nuits entretient constamment
dans l’atmosphère de ces lacs et des déserts qui les environnent, une h u m i dité
saline qui pénètre et agit dans tous les corps, on reconnoîtra que, c o n f o r mément
au sentiment des prêtres d’Egypte, rapporté et adopté par H é r o d o t e ,
Strabon et tous les philosophes de l’antiquité, l’isthme de Soueys, toute la bassej
Egypte,ainsi que toutes les plages adjacentes à l’ouest, jusque vers l’Oasis d ’ A m m o n j
D E L A B A S S E É G Y P T E . 4 7 9
dans les deserts de la Libye, appartiennent incontestablement au domaine d’une
mer desséchée. Ce sentiment a ete partagé par tous les voyageurs modernes qui ont
visité ces contrées. Parmi ces voyageurs, on peut citer M. Hornemann, qui, en 1800,
ayant traversé l’Afrique d’orient en occident par l’Oasis d’Ammon, a reconnu
dans ces déserts les traces les plus sensibles d’un long séjour des eaux de la mer. Je
dirai de plus, d’après l’opinion des prêtres d’Egypte et celle d’Hérodote, qu’il est
probable que la vallce du N il, dont le sol s’exhausse constamment du Kaire en remontant
vers la Thébaïde, n est plus aujourd’hui qu’un immense attérissement des
sables vaseux du fleuve, et que les vallées du Bahr-belâ-mâ et des lacs de Natroun
ont pu former anciennement des golfes semblables à ceux de la mer Rouge. Enfin
j ajouterai que,, les deserts de la Libye et de 1 Afrique étant en général regardés
comme appartenant au sol d’une mer desséchée, les Oasis, ces espèces d’îles cultivées
ou cultivables que 1 on trouve dispersées sur l’immensité de cette mer de sables, ne
sont que des bas-fonds, tels qu’il en existe dans le sein des mers, et dont le sol est
encore en partie inférieur au niveau actuel des eaux de la Méditerranée.
Il ne m appartient pas, dit l’auteur du Mémoire, d’assigner une cause à la révolution
physique qui a pu changer ainsi la surface de tant de contrées. Je ne prétendrai
donc pas trouver cette cause secondaire, plutôt dans l’effet de ce flux et
reflux extraordinaires qui, d après 1 Exode, d accord avec la tradition qui s’en est
conservée, au-rapport de Diodore (1), chez les Ichthyophages, peuples des côtes
delà mer Rouge, auroient mis à sec une grande partie de cette mer, que dans un
abaissement instantané des eaux de la Méditerranée par la rupture du détroit des
Colonnes d Hercule, aujourd’hui de Gibraltar (2), ni enfin que dans la retraite
précipitée des eaux après l’époque de cette catastrophe générale, où le globe
que nous habitons a dû rouler, durant des siècles, sous l’enveloppe des eaux d’une
mer sans bornes, catastrophe dont les plaines ainsi que les entrailles les plus profondes
et les montagnes les plus élevées de la terre portent des traces ineffaçables.
Cest en vain que l’esprit justement inquiet de l’homme se tourmente en hypothèses
plus ou moins ingénieuses, plus ou moins vraisemblables, sur les causes de
ces grandes révolutions ; les causes et les époques de ces épouvantables événemens
qui nous menacent de leur cours, périodique peut-être, nous sont inconnues,
et restent à jamais ensevelies dans la nuit étemelle des temps.
Pour revenir au but de ce A'Iemofre, on terminera en donnant ici le tableau
résumé de 1 étendue superficielle des lacs maritimes de l’Egypte inférieure, en comparant
cette étendue à celle de l’ancien et du nouveau Delta.
(1) Exod. cap. X IV, v. 21, et Psalm. CXIII, et Diod. ment la plus grande partie des déserts de la Libye et de
Bibl. hist. Iib. I I I , S. 4°* l’Afrique, ses eaux, en s’abaissant d’une hauteur quel-
(2) Parmi toutes ces traditions ou hypothèses,' celle conque par la rupture naturelle ou artificielle du détroit
de l’abaissement instantané des eaux de la Méditerranée de Gibraltar, auront mis à découvert l’immensité de ces
par la rupture du détroit des Colonnes, dont il est parié plages, dont le dessèchement les aura transformées en une
dans la Géographie de Strabon, nous paraît la plus admis- mer de sables stériles et brûlans. Voir Strabon, Cécgr.
lible, comme elle est la plus vraisemblable. Ainsi, liv. I , tom. 1. " de la traduct. Franc.; et Pline, Hist.
admettant que la Méditerranée a recouvert ancienne- nat. liv. v i , chap. t.