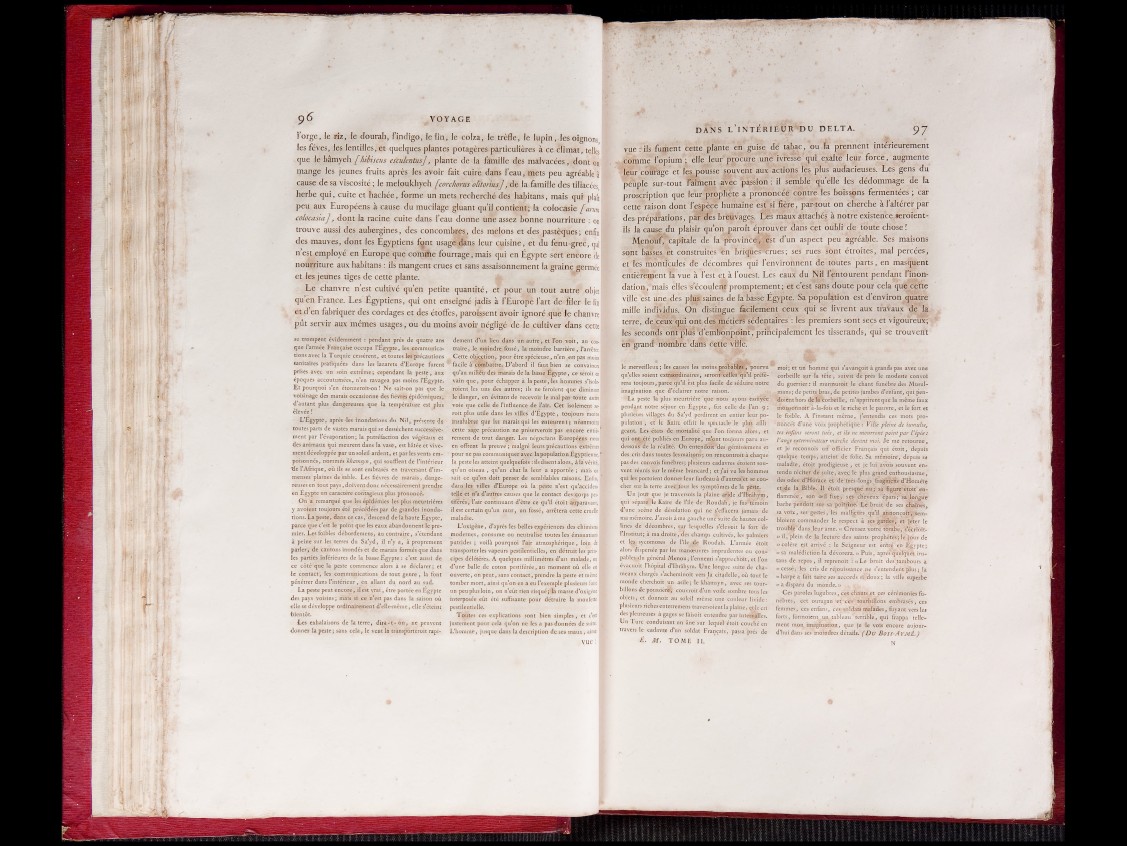
l’orge, le riz, le doural), findigo, le lin, le colza, le trèfle, le lupin,.les oignons 1
les fèves, les lentilles, et quelques plantes potagères particulières à ce climat, telles
que le bâmyeh [hibiscus esculcntus], plante de la famille des malvacées, dont on
mange les jeunes fruits après les avoir fait cuire dans l’eau, mets peu agréable à .
cause de sa viscosité ; le meioukhyeh [ corchorus olitorius] , de la famille des tiliacées, I
herbe qui, cuite et hachée, forme un mets recherché des habitans, mais qui plaîtI
peu aux Européens à cause du mucilage gluant qu’il contient; la colocasie [arwn '{
colocasia] , dont la racine cuite dans l’eau donne une assez bonne nourriture : on I
trouve aussi des aubergines, des concombres, des melons et des pastèques; enfin!
des mauves, dont les Égyptiens font usage'dans leur cuisine, et du fenu-grec, qul|
n est employé en Europe que comme fourrage, mais qui en Égypte sert encore de I
nourriture aux habitans : ils mangent crues et sans assaisonnement la graine germéel
et les jeunes tiges de cette plante.
Le chanvre n’est cultivé qu’en petite quantité, et pour un tout autre objêtl
quen France. Les Egyptiens, qui ont enseigné jadis à l’Europe l’art de filer le lin I
et d en fabriquer des cordages et des étoffes, paraissent avoir ignoré que le chanvrt
pût servir aux mêmes usages, ou du moins avoir négligé de le cultiver dans cette!
se trompent évidemment : pendant près de quatre ans
que l’armée Française occupa l’Egypte, les communications
avec la Turquie cessèrent , et toutes les précautions
sanitaires pratiquées dans les lazarets d’Europe furent
prises avec un soin extrême ; cependant la peste, aux
époques accoutumées., n’en ravagea pas moins l’Egypte.
Et pourquoi s’en étonneroit-on ! Ne sait-on pas que le
voisinage des marais occasionne des fièvres épidémiques,
d'autant plus dangereuses que la température est plus
elevée î
•L’Egypte, après -les inondations du Nil, présente de
toutesparts de vastes marais qui se dessèchent successivement
par l’évaporation ; la putréfaction des végétaux et
des animaux qui meurent dans la vase, est hâtée et vivement
développée par un soleil ardent, et par les vents empoisonnés,
nommés Tdiamsyn, qui soufflent de l’intérieur
■oie l’Afrique, où ils se sont embrasés en traversant d’immenses
plaines de sable. Les fièvres de marais, dangereuses
en tout pays, doivent donc nécessairement prendre
en Egypte un caractère contagieux plus prononcé.
. On a remarqué que les épidémies les plus meurtrières
y avoient toujours été précédées par de grandes inondations.
La peste, dans ce cas, 'descend de la haute Egypte,
parce que c’est le point que les eaux abandonnent le premier.
Les foibles débordemens, au contraire, s’étendant
à peine sur les terres du Sa’yd, il n’y a, à proprement
parler, de cantons inondés et de marais formés que dans
les parties inférieures de la basse Egypte : c’est aussi de
ce côté que la peste commence alors à se déclarer ; et
le contact’, les communications de tout genre, la font
pénétrer dans l’intérieur, en allant du nord au sud.
La peste peut encore, il est vrai, être portée en Egypte
des pays voisins ; mais si ce n'est pas dans la saison où
elle se développe ordinairement d’elle-même , elle s’éteint
bientôt.
Les exhalaisons de la terre, d ira - t-o n , ne peuvent
donner la peste; sans cela, le vent la transporteroit rapidement
d’un lieu dans un autre, et l’on voit, au con*|
traire, le moindre.fossé, la moindre barrière, l’arrcter.I
Cette objection, pour être.spécieuse, n’en .est pas moinsI
* facile à combattre. D’abord il faut bien se convaincre I
qu’au mflièu des marais de la basse Egypte, ce serait e
vain que, pour échapper à la peste, les hommes s’isoleraient,
les uns des autres; ils ne feraient que diminuerI
le danger, en évitant de recevoir le mal par toute autre I
voie que celle de l’influence de l’air. Cet isolement s
roit plus utile dans les villes d’Egypte , toujours moins.
insalubres que les marais qui les entourent; néanmoins!
cette sage précaution ne préserverait pas encore entiè-1
rement de tout danger. Les négocians Européens nous [ !
en offrent la preuve ; malgré leurs précautions extrêmes I
pour ne pas communiquer avec la population Egyptienne, 9
la peste les atteint quelquefois : ils disent alors, à la vérité, f
qu’un oiseau , qu’un chat la leur a apportée ; mais on 9
sait ce qu’on doit penser de semblables raisons. Enfin, [
dans les. villes cFEurope où la peste n’est qu’acciden-1
telle et n’à d’autres causes que le contact desteorps pes- i
tiférés, l’air continuant d’être ce qu’il étoit auparavant,!
il est certain qu’un mur, un fossé, arrêtera cette cruelle |
maladie.
L’oxigène, d'après les belles expériences des chimistes I
modernes, consume ou neutralisé toutes les émanations I
putrides ; voilà pourquoi l’air atmosphérique, loin de I
transporteries vapeurs pestilentiellès, en détruit les prin-1
cipes délétères. A quelques millimètres d’un malade, ou H
d une balle de coton pestiférée, au moment où elle est |
ouverte, on peut, sans contact, prendre la peste et même I
tomber mort, ainsi qu’on en a eu l’exemple plusieurs fois: I
un peu plus loin, on n’eût rien risqué ; la masse d’oxigène I
interposée eût été suffisante pour détruire la moufette I
pestilentielle.
Toutes ces explications sont bien simples, et c’est I
justement pour cela qu’on ne les a pas données de suite. I
L’homme, jusque dans la description de ses maux, aime H
D A N S l ’ î N T É R I È U R ^ D U D E L T A . 97
vue ils fument cette plante en guise dé tabac/ou la prennent intérieurement
comme l’opium ; elle leur procure une ivresse qui exalte'leur force, augmente
leur courage* et les pousse souvent aux actions les plus audacieuses. Les gens du
pétiple sur-tout 1 aiment avec passion: il semblé quelle les dédommage de la
proscription que leur prophète a prononcée contre, les boissons fermentees, car
cette’raison dont l’espèce humaine est si fière, par tout on cherche à l’altérer par
des-préparations, par des breuvages. Les maux attachés à notre existence seraient-
ils la cause du plaisir qu’on paroît éprouver âans cet oubir de toute chose !
Menofrf/rapitale de la”’province, Êkt d’un aspect peu agréable. Ses maisons
sont basses.et construites 'fen triquerrerues ; ses rues sont étroites, mal percées,
et lès monticules de décombres qui l’environnent de toutes parts, en masquent
entièrement la vue à l’est et à l’ouest. Les eaux du Nil l’entourent pendant l’inondation,‘
mais elles's’écoulent promptement; et c’est sans doute pour cela quejièîte
ville est une des plus: saines de la basse Égypte. Sa population est d environ quatre
mille individus. On distingue facilement ceux qui s'e livrent aux travaux de la
terre, de.cèüx qui ont des métiers sédentaires : les premiers sont secs et vigoureux';
les seconds ont p]ûs?d’emBbnpomt, principalement les tisserands, qui se trouvent
èn grand nombre dans cette ville.
le merveilleux ; les causes les moins probables?* pourvu
qu'elles soient extraordinaires, seront celles Tju’il préférera
toujours, parce qi/il est plus facile de séduire notre
imagination que d’éclairer notre raison.
La peste la plus meurtrière 'que- nous ayons essuyée
pendant notre séjour en Egypte , fut celle de -l’an 9 ;
plusieurs villages du Sa’yd perdirent en entier leur population
, et' le Kaire offrit le spectacle Je plus affli
géant. Les états de mortalité que l’on- forma alors, et
qui ontjiété publiés en Europe,’ mipnt toujours paru au-
dessous de la réalité. On entendoitMes géniisSèmens et
des cris dans toutes les maisons1; on rencontrait à chaque
pas des convois funèbres; plusieurs cadavres étoient souvent
réunis'sur le même brancard; et j’ai vu les hommes
qui les portoient donner leur fardeau à d’autresîet se coucher
sur la terre avecjtous les symptômes de la peste.
Un jour que je traversois la plaine aride d’ibrâhym,
qui séparée Kaire de l’île de Roudah', je fùs^temoin
d’une scène de désolation qui ne s’effacera jamais de
ma mémoire. J’avois à ma gauche une suite de hautes collines
de décombres, sur lesquelles s’élevoit le fort de
l’Institut; à ma droite, des champs cultivés, les palmiers
et les. sycomores de l’île.^de Roudah. L’armée étoit
alors dispersée par les manoeuvres imprudentes ou cou- '
pables^du général Menou; l’ennemi s’approchoit, et l’on
evacuoit l’hôpital d’ibrâhym. Une longue suite de chameaux
chargés s’acheminoit vers la citadelle, où fout le
monde cherchoit un asile ; le khamsyn, avec ses tourbillons
de poussière/ couvrait d’un voile sombre tous les
objets, et donnoit au soleil même une couleur livide:
plusieurs riches enterremens traversoient la plaine, etJecri
des pleureuses à gages se faisoit entendre par inteÿâlles.
Un Turc conduisant un âne sur lequel étoit couché en
travers le cadavre d’un soldat Français, passa près de
Ê . M . T O M E II.
moi; et un homme qui s’avançoit à grands pas avec une
corbeille sur la tête, suivit de près le modeste convoi
du guerrier : il murmurait le chant funèbre des Musulmans;
de petits bras, de petites jambes d’enfant, qui pen-
doienthors de la corbeille, m’apprirent que la même faux
moisson noir à-Ia-fois et le riche et le pauvre, et le fort et
le fbible. A l’instant même, j’entendis ces mots pro-
’ noncés d’une voix prophétique : Ville pleine de tumulte,
tes eiifans seront tués, et ils ne mourront point par l'épée:
l'ange exterminateur marche devant moi. Je me retourne,
et je reconnois un officier Français qui étoit, depuis
quelque temps, atteint de folie. Sa mémoire', depuis sa
maladie, étoit prodigieuse, et je lui.avois souvent entendu
réciter de suite, avec le plus grand enthousiasme,
des odes d’Horace et de très -longs fragmens d’Homète
et>de la Bible. II étoit presque nu ; sa figure :étoit enflammée,
son oeil fixe; ses cheveux’ epars;’' sa longue
barbe pendoit sur sa poitrine. Le bruit de ses chaînes,
sa voix, ses gestes, les malheurs qu’il annonçoit|£sern-
bloient commander le respect à ses gardes ' et jeter le
troublé dans leur ame. « Creüsez votre tombé, s’écriôit-
» i l , plein de la lecture des saints prophètes; le/jour de
»colère est arrivé : le Seigneur est entréeh Egypte;
»sa malédiction la dévorera. » Puis, après quelques ins-
tans de repos, il reprenoit : «Le bruit des tambours a
»cessé;‘ les cris de réjouissance.ne s’entenderit-'plus; la
» harpe a fait taire ses accords si doux ; la ville superbe
»adisparu du monde.» .
Ces paroles lugubres, ces chants ,et ces cérémonies funèbres,
cet ouragan ,et cês>’ tourbillons embrasés, ces
femmes, ces enfans, ces soldats malades, fuyant vers les
forts, formoient un tableau terrible, qui frappa tellement
mon imagination, que je le vois encore aujourd’hui
dans ses'moindres détails. (D u B ois-A ym è . )
N