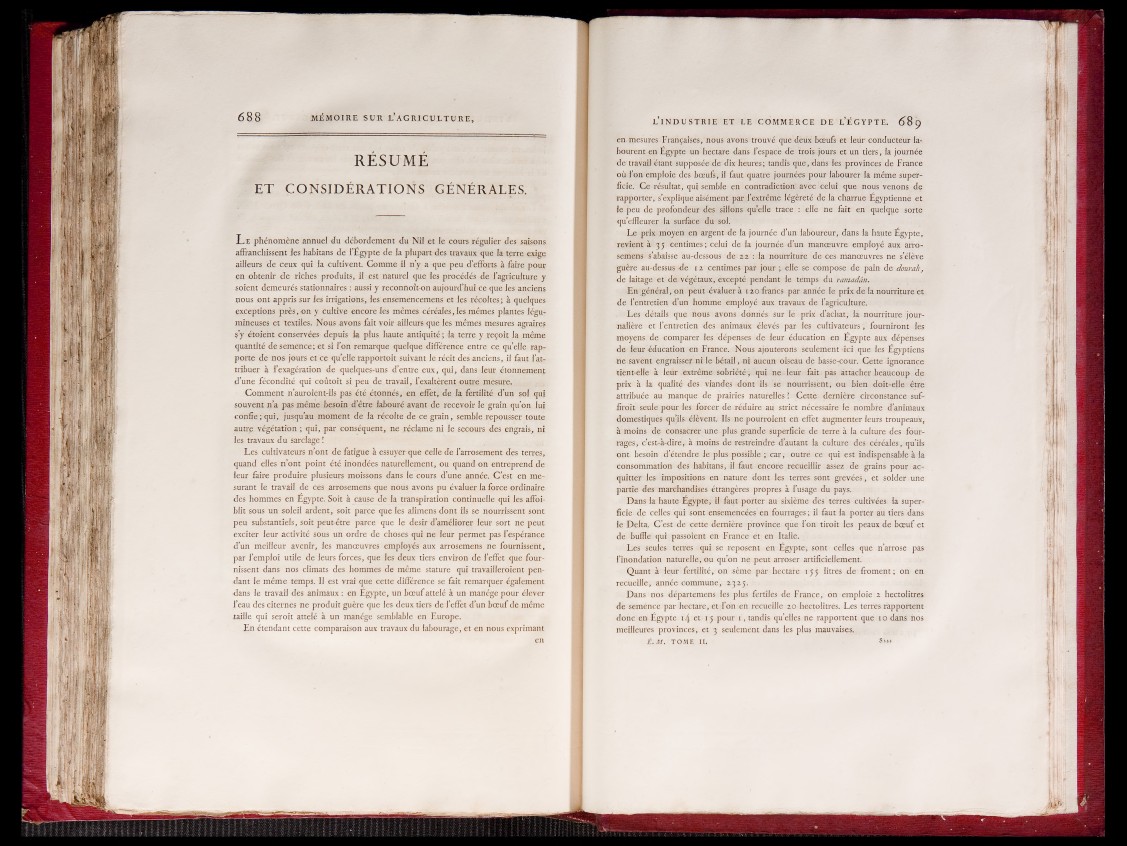
RÉSUMÉ
ET CONSIDÉRATIONS GÉNÉRALES.
L e phénomène annuel du -débordement du Nil et le cours régulier des saisons
affranchissent les habitans de l’Egypte de la plupart des travaux que la terre exige
ailleurs de ceux qui la cultivent. Comme il n’y a que peu defforts à faire pour
en obtenir de riches produits, il est naturel que les procédés de l’agriculture y
soient demeurés stationnaires : aussi y reconnoît-on aujourd’hui ce que les anciens
nous ont appris sur les irrigations, les ensemencemens et les récoltes; à quelques
exceptions près,on y cultive encore les mêmes céréales, les mêmes plantes légumineuses
et textiles. Nous avons fait voir ailleurs que les mêmes mesures agraires
ç’y étoieiit conservées depuis la plus haute antiquité ; la terre y reçoit la même
quantité de semence; et si l’on remarque quelque différence entre ce qu’elle rapporte
de nos jours et ce qu’elle rapportoit suivant le récit des anciens, il faut l’attribuer
à l’exagération de quelques-uns d’çntre eux, qui, dans leur étonnement
d’une fécondité qui coûtoit si peu de travail, l’exaltèrent outre mesure.
Comment n’auroient-ils pas été étonnés, en effet, de la fertilité d’un sol qui
souvent n’a pas même besoin d’être labouré avant de recevoir le grain qu’on lui
confie;qui, jusqu’au moment de la récolte de ce grain, semble repousser toute
autre végétation ; qui, par conséquent, ne réclame ni le secours des engrais, ni
les travaux du sarclage ï
Les cultivateurs n’ont de fatigue à essuyer que celle de l’arrosement des terres,
quand elles n’ont point été mondées naturellement, ou quand on entreprend de
leur faire produire plusieurs moissons dans le cours d’une année. C ’est en mesurant
le travail de ces arrosemens que nous avons pu évaluer la force ordinaire
des hommes en Egypte. Soit à cause de la transpiration continuelle qui les affoi-
blit sous un soleil ardent, soit parce que les alimens dont ils se nourrissent sont
peu substantiels, soit peut-être parce que le désir d’améliorer leur sort ne peut
exciter leur activité sous un ordre de choses qui ne leur permet pas l’espérance
d’un meilleur avenir, les manoeuvres employés aux arrosemens ne fournissent,
par l’emploi utile de leurs forces, que les deux tiers environ de l’effet que fournissent
dans nos climats des hommes de même stature qui travailleroient pendant
le même temps. Il est vrai que cette différence se fait remarquer également
dans le travail des animaux : en Egypte, un boeuf attelé à un manège pour élever
l’eau des citernes ne produit guère que les deux tiers de l’effet d’un boeuf de même
¿taille qui seroit attelé à un manège semblable en Europe.
En étendant cette comparaison aux travaux du labourage, et en nous exprimant
en
en mesures Françaises, nous avons trouvé que deux boeufs et leur conducteur labourent
en Egypte un hectare dans l’espace de trois jours et un tiers, la journée
de travail étant supposée de dix heures; tandis que, dans les provinces de France
où l’on emploie des boeufs, il faut quatre journées pour labourer la même superficie.
Ce résultat, qui semble en contradiction avec celui que nous venons de
rapporter, s’explique aisément par l’extrême légèreté de la charrue Égyptienne et
le peu de profondeur des sillons qu’elle trace : elle ne fait en quelque sorte
qu’effleurer la surface du sol.
Le prix moyen en argent de la journée d’un laboureur, dans la haute Égypte,
revient à 35 centimes; celui de la journée d’un manoeuvre employé aux arrosemens
s’abaisse au-dessous de 22 : la nourriture de ces manoeuvres ne s’élève
guère au-dessus de 1 2 centimes par jour ; elle se compose de pain de doural,
de laitage et de végétaux, excepté pendant le temps du ramadan.
En général, on peut évaluer à r 20 francs par année le prix de la nourriture et
de l’entretien d’un homme employé aux travaux de l’agriculture.
Les détails que nous avons donnés sur le prix d’achat, la nourriture journalière
et l’entretien des animaux élevés par les cultivateurs , fourniront les
■moyens de comparer les dépenses de leur éducation en Égypte aux dépenses
de leur éducation en France. Nous ajouterons seulement ici que les Égyptiens
ne savent engraisser ni le bétail, ni aucun oiseau de basse-cour. Cette ignorance
tient-elle à leur extrême sobriété, qui ne leur fait pas attacher beaucoup de
prix à la qualité des viandes dont ils se nourrissent, ou bien doit-elle être
attribuée au manque de prairies naturelles i Cette dernière circonstance suf-
firoit seule pour les forcer de réduire au strict nécessaire le nombre d’animaux
domestiques qu’ils élèvent. Ils ne pourroient en effet augmenter leurs troupeaux,
à moins de consacrer une plus grande superficie de terre à la culture des fourrages,
c’est-à-dire, à moins de restreindre d’autant la culture des céréales, qu’ils
ont besoin d’étendre le plus possible ; car, outré ce qui est indispensable à la
consommation des habitans, il faut encore recueillir assez de grains pour acquitter
les impositions en nature dont les terres sont grevées, et solder une
partie des marchandises étrangères propres à l’usage du pays.
Dans la haute Egypte, il faut porter au sixième dès terres cultivées la superficie
de celles qui sont ensemencées en fourrages ; il faut la porter au tiers dans
le Delta. C ’est de cette dernière province que l’on tiroit les peaux de boeuf et
de buffle qui passoient en France et en Italie.
Les seules terres qui se reposent en Égypte, sont celles que n’arrose pas
l’inondation naturelle, ou qu’on ne peut arroser artificiellement.
Quant à leur fertilité, on sème par hectare tyy litres de froment; on en
recueille, année commune, 2325.
Dans nos départemens les plus fertiles de France, on emploie 2 hectolitres
de semence par hectare, et l’on en recueille 20 hectolitres. Les terres rapportent
donc en. Égypte i4 et t j pour 1, tandis qu’elles ne rapportent que 10 dans nos
meilleures provinces, et 3 seulement dans les plus mauvaises.
É.M. T O M E I I . Sss*