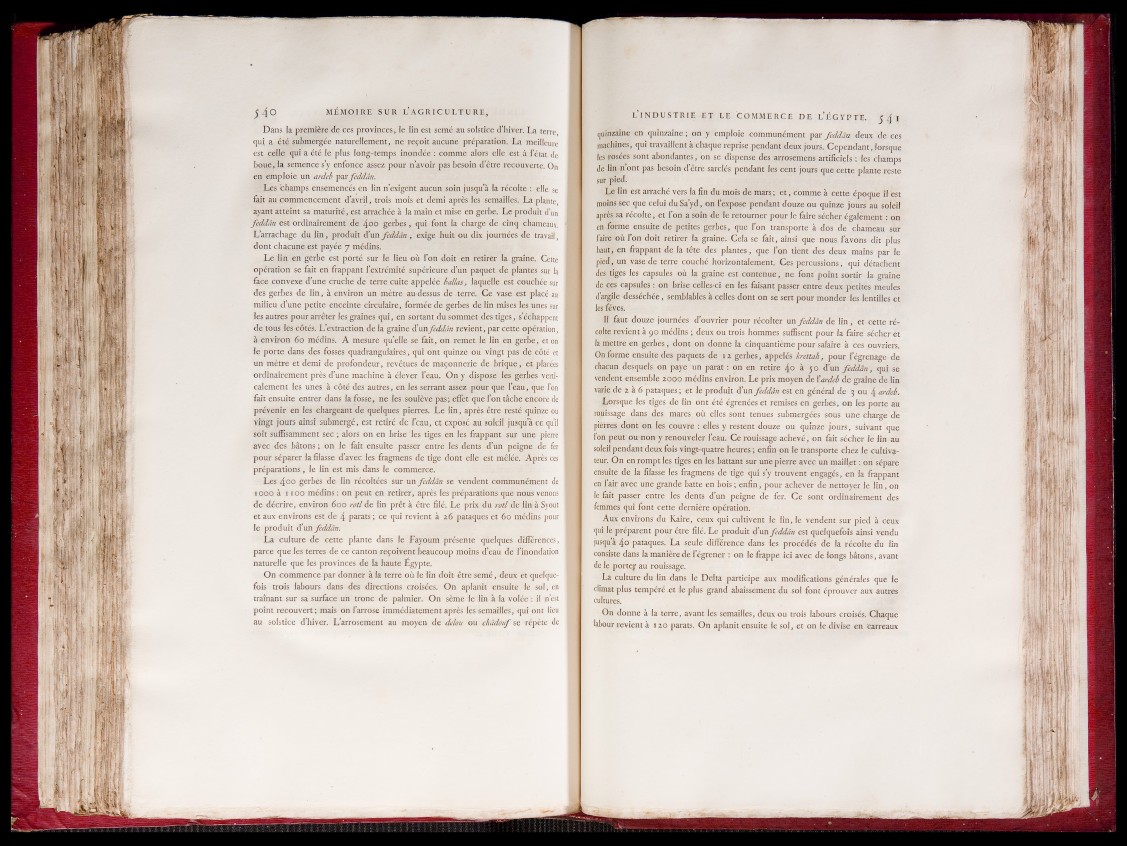
Dans la première de ces provinces, le lin est semé au solstice d’hiver. La tevre
qui a été submergée naturellement, ne reçoit aucune préparation. La meilleure
est celle qui a été le plus long-temps inondée : comme alors elle est à l’état de
boue, la semence s’y enfonce assez pour n’avoir pas besoin d’être recouverte. On
en emploie un ardeb pait feddân.
Les champs ensemencés en lin n’exigent aucun soin jusqu’à la récolte : elle se
fait au commencement d’avril, trois mois et demi après les semailles. La plante,
ayant atteint sa maturité, est arrachée à la main et mise en gerbe. Le produit d’un
feddân est ordinairement de 4 °o gerbes, qui font la charge de cinq chameaux.
L ’arrachage du lin , produit d’un feddân , exige huit ou dix journées de travail,
dont chacune est payée 7 médins.
Le lin en gerbe est porté sur le lieu où l’on doit en retirer la graine. Cette
opération se fait en frappant l’extrémité supérieure d’un paquet de plantes sur la
face convexe d’une cruche de terre cuite appelée ballas, laquelle est couchée sur
des gerbes de lin, à environ un mètre au-dessus de terre. Ce vase est placé au
milieu d’une petite enceinte circulaire, formée de gerbes de lin mises les unes sur
les autres pour arrêter les graines qui, en sortant du sommet des tiges, s’échappent
de tous les côtés. L ’extraction de la graine d’un feddân revient, par cette opération,
à environ 60 médins. A mesure qu’elle se fait, on remet le lin en gerbe, et on
le porte dans des fosses quadrangulaires, qui ont quinze ou vingt pas de côté et
un mètre et demi de profondeur, revêtues de maçonnerie de brique, et placées
ordinairement près d’une machine à élever l’eau. On y dispose les gerbes verticalement
les unes à côté des autres, en les serrant assez pour que l’eau, que l’on
fait ensuite entrer dans la fosse, ne les soulève pas; efïèt que l’on tâche encore de
prévenir en les chargeant de quelques pierres. Le lin, après être resté quinze ou
vingt jours ainsi submergé, est retiré de l’eau, et exposé au soleil jusqu’à ce qu’il
soit suffisamment sec ; alors on en brise les tiges en les frappant sur une pierre
avec des bâtons ; on le fait ensuite passer entre les dents d’un peigne de fer
pour séparer la filasse d’avec les fragmens de tige dont elle est mêlée. Après ces
préparations, le lin est mis dans le commerce.
Les 4° ° gerbes de lin récoltées sur un feddân se vendent communément de
1000 à 1100 médins : on peut en retirer, après les préparations que nous venons
de décrire, environ 600 rotl de lin prêt à être filé. Le prix du rotl de lin à Syout
et aux environs est de 4 parats ; ce qui revient à 26 pataquès et 60 médins pour
le produit d’un feddân.
La culture de cette plante dans le Fayoum présente quelques différences,
parce que les terres de ce canton reçoivent beaucoup moins d’eau de l’inondation
naturelle que les provinces de la haute Egypte.
On commence par donner à la terre où le lin doit être semé, deux et quelquefois
trois labours dans des directions croisées. On aplanit ensuite le sol, en
traînant sur sa surface un tronc de palmier. On sème le lin à la volée : il n’est
point recouvert; mais on l’arrose immédiatement après les semailles, qui ont lieu
au solstice d’hiver. L ’arrosetnent au moyen de delou ou cltâdouf se répète de
quinzaine en quinzaine ; on y emploie communément par feddân deux de ces
machines, qui travaillent à chaque reprise pendant deux jours. Cependant, lorsque
les rosées sont abondantes, on se dispense des arrosemens artificiels ; les champs
de lin n ont pas besoin d’être sarclés pendant les cent jours que cette plante reste
sur pied.
Le lin est arraché vers la fin du mois de mars ; e t , comme à cette époque il est
moins sec que celui duSa’yd, on l’expose pendant douze ou quinze jours au soleil
après sa récolte, et l’on a soin de le retourner pour le faire sécher également : on
en forme ensuite de petites gerbes, que l’on transporte à dos de chameau sur
l’aire où l’on doit retirer la graine. Cela se fait, ainsi que nous l’avons dit plus
haut, en frappant de la tête des plantes, que l’on tient des deux mains par le
pied, un vase de terre couché horizontalement. Ces percussions, qui détachent
des tiges les capsules où la graine est contenue, ne font point sortir la graine
de ces capsules : on brise celles-ci en les faisant passer entre deux petites meules
d’argile desséchée, semblables à celles dont on se sert pour monder les lentilles et
les fèves.
Il faut douze journées d’ouvrier pour récolter xm feddân de lin, et cette récolte
revient à 90 médins ; deux ou trois hommes suffisent pour la faire sécher et
la mettre en gerbes, dont on donne la cinquantième pour salaire à ces ouvriers.
On forme ensuite des paquets de 12 gerbes, appelés krettali, pour l’égrenage de
chacun desquels on paye un parat : on en retire 4 ° à 50 d’un feddân, qui se
vendent ensemble 2000 médins environ. Le prix moyen de l'ardeb de graine de lin
varie de 2 à 6 pataquès ; et le produit d’un feddân est en général de 3 ou 4 ardeb.
Lorsque les tiges de lin ont été égrenées et remises en gerbes, on les porte au
rouissage dans des mares où elles sont tenues submergées sous une charge de
pierres dont on les couvre : elles y restent douze ou quinze jours, suivant que
Ion peut ou-non y renouveler l’eau. Ce rouissage achevé, on fait sécher le lin au
soleil pendant deux fois vingt-quatre heures; enfin on le transporte chez le cultivateur.
On en rompt les tiges en les battant sur une pierre avec un maillet : on sépare
ensuite de la filasse les fragmens de tige qui s’y trouvent engagés, en la frappant
en l’air avec une grande batte en bois ; enfin, pour achever de nettoyer le lin , on
le fait passer entre les dents d’un peigne de fer. Ce sont ordinairement des
femmes qui font cette dernière opération.
Aux environs du Kaire, ceux qui cultivent le lin, le vendent sur pied à ceux
qui le préparent pour être filé. Le produit d’un feddân est quelquefois ainsi vendu
jusqu’à 4o pataquès. La seule différence dans les procédés de la récolte du lin
consiste dans la maniéré de 1 égrener : on le frappe ici avec de longs bâtons, avant
de le portep au rouissage.
La culture du lin dans le Delta participe aux modifications générales que le
climat plus tempéré ,et le plus grand abaissement du sol font éprouver aux autres
cultures.
On donne à la terre, avant les semailles, deux ou trois labours croisés. Chaque
labour revient à 120 parats. On aplanit ensuite le sol, et on le divise en carreaux