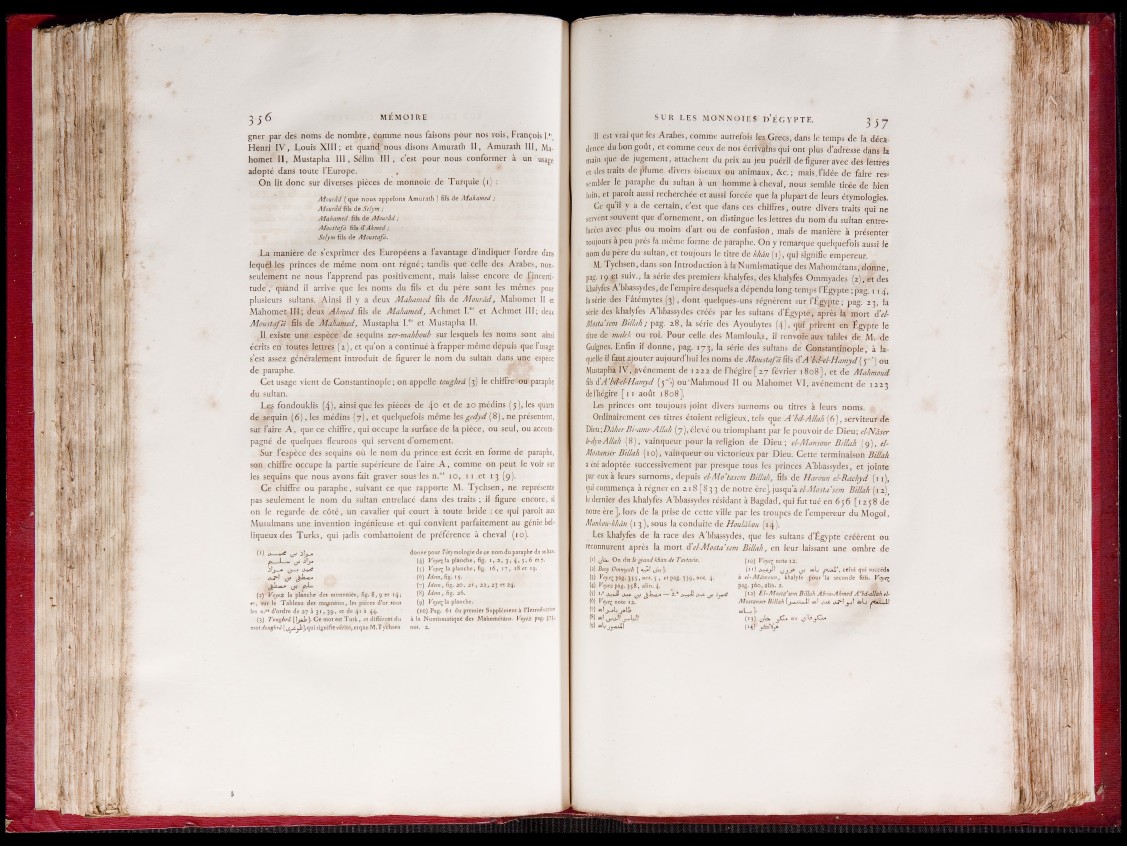
gner par des noms de nombre, comme nous faisons pour nos rois, François I.",
Henri IV , Louis XIII; et quand'nous disons Amurath II, Amurath III, Mahomet
II, Mustapha I I I , Sélim II I, c’est pour nous conformer à un usage
adopté dans toute l’Europe.
On lit donc sur diverses pièces de monnoie de Turquie (i) :
Aiourâd ( que nous appelons Amurath ) fils de Mahamed ;
Aiourâd fils dé Selyni ;
/Mahamed fils de Aiourâd ;
Moustafà fils cT Ahmed ;
Selym fils de Moustafà.
La manière de s’exprimer des Européens a l’avantage d’indiquer l’ordre dans
lequel les princes de même nom ont régné; tandis que celle des Arabes, non-
seulement ne nous l’apprend pas positivement, mais laisse encore de l’incertitude'*
quand il arrive que les noms du fils et du père sont les mêmes pour
plusieurs sultans. Ainsi il y a deux Mahamed fils de Mourâd, Mahomet II et
Mahomet III; deux Ahmed fils de Mahamed, Achmet I." et Achmet III; deux
Moustafà fils de Mahamed, Mustapha I.cr et Mustapha II.
Il existe une espèce de sequins zer-mahboüb sur lesquels les noms sont ainsi
écrits en. tou tes lettres (a), et qu’on a continué à frapper même depuis que l’usage
s’est assez généralement introduit de figurer le nom du sultan dans une espèce
de paraphe.
Cet usage vient de Constantinople ; on appelle toughrâ (3) le chiffre! ou paraphe |
du sultan.
Les fondouklis (4), ainsi que les pièces de 4° et de 20 médins (y), les quarts
de sequin (6 ), les médins (7), et quelquefois même les gedyd (8), ne présentent,
sur faire A , que ce chiffre, qui occupe la surface de la pièce, ou seul, ou accompagné
de quelques fleurons qui servent d’ornement.
Sur l’espèce des sequins où le nom du prince est écrit en forme de paraphe,
son chiffre occupe la partie supérieure de faire A , comme on peut le voir sur
les sequins que nous avons fait graver sous les n.°s 10, 1 1 et 13 (9).
Ce chiffre ou paraphe, suivant ce que rapporte M. Tychsen, ne représente
pas seulement le nom du sultan entrelacé dans des traits ; il figure encore, si
on le regarde de cô té , un cavalier qui court à toute bride : ce qui paroît aux
Musulmans une invention ingénieuse et qui convient parfaitement au génie belliqueux
des Turks, qui jadis combattoient de préférence à cheval (10).
donne pour I’étymologie de ce nom du paraphe du sultan.
(4) Voyez, la planche, fig. i , 2 , 3 , 4 » 5 * 6 it 7.
(5) Koyrç la planche, fig. 16, 17 , 18 et 19.
(6) Idem, fig. 15.
(7) Idem, fig. 20, 2 1 , 22, 23 et 24.
(8) Idem, fig. 26.
(9) Voye^Xo, planche.
(10) Pag. 61 du premier Supplément à l’Iintroduction
à la Numismatiqué des Mahométans. Voyez pag’ 373»
(0 o— ^
—A—1- ü* IIP
f|yg* o—j
o*
u* A-k-
(2) Voyez la planche des monnoiés, fig. 8 ,9 et 14;
et, sur le Tableau des mqpnôies, les pièces d’or sôus
les n.°* d’ordre de 27 à 3 1 , 39, et de 41 & 44*
(3) Toughrâ [[>ih]. Ce mot est Turk , et différent du
mot</oi/gArû[^xji>],qui signifie vérité, etqüe M .Tychsen
11 est vrai que lès Arabes, comme autrefois les Grecs, dans le temps de la décadence
du bon goût, et comme ceux de nos écrivains qui ont plus d’adresse dans la
main que de jugement, attachent du prix au jeu puéril de figurer avec déS lettrés
et des traits de plume divers oiseaux ou animaux, &c. ; mais.l’idée de faire res“
sembler le paraphe du sultan à un homme à cheval, nous semble tirée de bien
loin, et paroît aussi recherchée et aussi forcée que la plupart de ieurs étymologies.
Ce quil y a de certain, cest que dans ces chiffres, outre divers traits qui ne
servent souvent que d’ornement, on distingue les,lettres du nom du sultan entrelacées
avec plus ou moins d’art ou de confusion, mais de manière à présenter
toujours à peu près la même forme de paraphe. On y remarque quelquefois aussi le
nom du pere du sultan, et toujours le titre de khan |ij, qui signifie empereur.
M. Tychsen, dans son Introduction a la Numismatique des Mahométans, donne,
pag. 19 et su*v., la série des premiers khalyfes, des khalyfes Ommyades (2), et des
khalyfes A ’bbassydes, de l’empire desquels a dépendu long temps i’Égypte ; pag. 114,
lasérie des Fâtémytes (3), dont quelques-uns régnèrent sur l’Égypte; pag. 23, la
série des khalyfes A ’bbassydes créés par les sultans d’Égypte, après la mort d’el-
Mostu sem Billah; pag. 28, la série des Ayoubytes (4), qui prirent en Égypte le
titre de malek ou roi. Pour celle des Mamlouks, il renvoie aux tables de M. de
Guignes. Enfin il donne, pag. 173, la série des sultans de Constantinople, à laquelle
il fau| ajouter aujourd’hui les noms de Moustafà fils A’A ’bd-el-Hamyd[y') ou
Mustapha IV, avènement de 1222 de l’hégire [2 7 février 1808], et de Mahmoud
(ils SA 'bd-ePHamyd ( y “'•) ou'Mahmoud II ou Mahomet VI, avènement de 1223
de l’hégire [1 1 août 1808].
Les princes ont toujours joint divers surnoms ou titres à leurs noms.
Ordinairement ces titres etoient religieux, tels que A ‘bd-Allah ( 6 J, serviteur de
Dieu ; Dâher Bi-amr-Allah (7), élevé ou triomphant par le pouvoir de Dieu; cl-Nâscr
h-dyn-Allah (8), vainqueur pour la religion de Dieu ; el-Mansour Billah (9), cl-
Mostanser Billah (10), vainqueur ou victorieux par Dieu. Cette terminaison Billah
a été adoptée successivement par presque tous les princes A ’bbassydes, et jointe
par eux à leurs surnoms, depuis el-Mo’tasem Billah, fils de Haroun el-Rachyd (1 1),
qui commença à régner en 218 [83 3 de notre ère], jusqu’à el-Mosta’sem Billah ( 12),
le dernier des khalyfes A ’bbassydes résidant à Bagdad, qui fut tué en 6y 6 [1258 de
notre ère], lors de la prise de cette ville par les troupes de l’empereur du Mogol,
Mankou-lhân (13 ), sous la conduite de Houlâkou (14).
Les khalyfes de la race des A bbassydes, que les sultans d’Égypte créèrent ou
reconnurent après la mort d el-Mosta’sem Billah, en leur laissant une ombre de
(1) (jU.. On dit le grand khùh de Tartarie. (10) Voyez note 12.
(2) Beny Ommyah [ <çÇ»l viv]. (* ') uj-26 ^ celui qui succéda
(3) y°yei Pag- 355 , not. 5 , et pag. 339, hot. 4- * cl-Mâmoun, khalyfe pour la seconde fols. Voye^
(4) Voyez pag., 358, alin. 4. pag. 360, Slin. 2.
(5) 1,0 — 2.4 iv.c. ^ 1)+^ ( ’ -) Èl-Aiôsiâ'sëiA Billah Abou-Ahnièd A ‘bd-atlàh el-
(6) Voye^ note 12. Mostanser Billah oiSM j-jI àuU
(7) *»l AXll ) ]•
(®) ( 1 3 ) ( jlà » OU