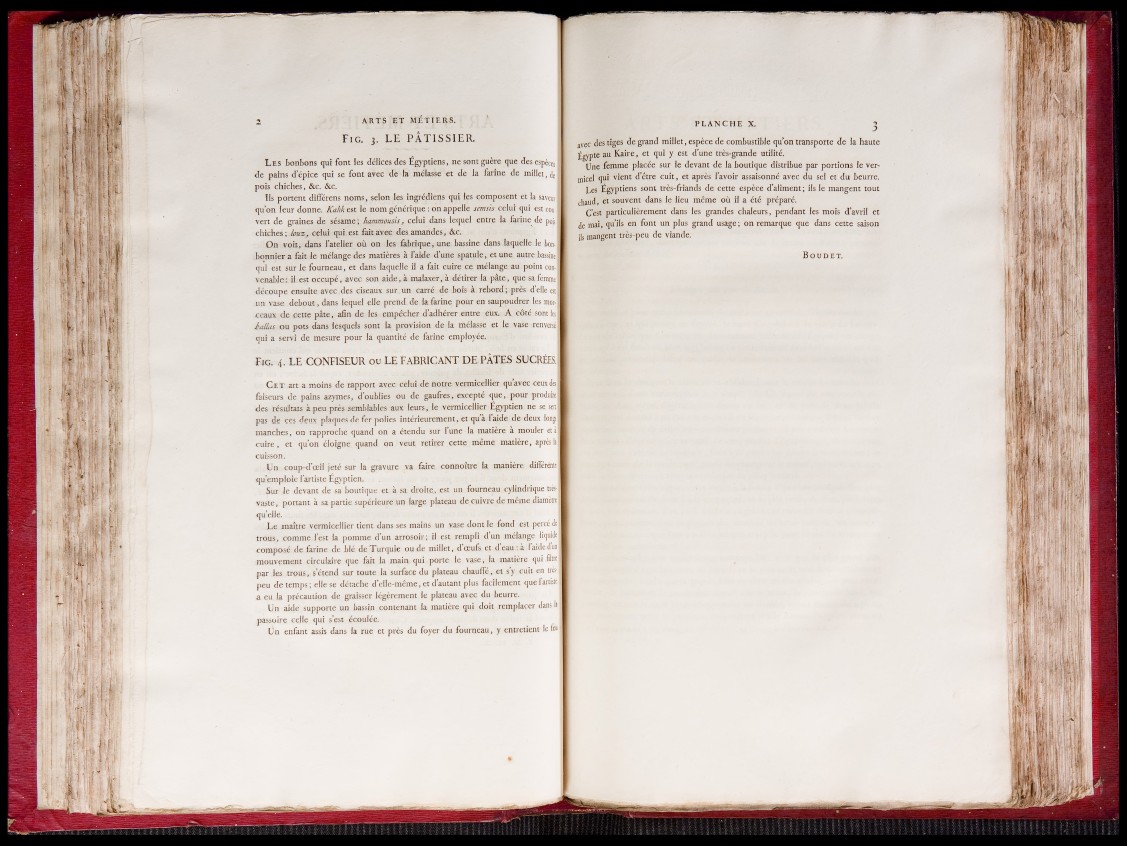
L es bonbons qui font les délices des Égyptiens, ne sont guère que des espèces I
de pains d’épice qui se font avec de la mélasse et de la farine de millet, de I
pois chiches, &c. &c.
Ils portent dilférens noms, selon les ingrédiens qui les composent et la saveurI
qu’on leur donne. K M est le nom générique : on appelle semsis celui qui est cou-l
vert de graines de sésame; hammousis, celui dans lequel entre la farine de poisI
chiches; louz, celui qui est fait avec des amandes, &c.
On voit, dans l’atelier où on les fabrique, une bassine dans laquelle le bon-l
bonniera fait le mélange des matières à l’aide d’une spatule, et une autre bassinel
qui est sur le fourneau, et dans laquelle il a fait cuire ce mélange au point con-l
venabie: il est occupé, avec son aide, à malaxer, à détirer la pâte, que sa femmel
découpe ensuite avec des ciseaux sur un carré de bois à rebord; près d’elle est!
un vase debout, dans lequel elle prend de la farine pour en saupoudrer les mor-l
ceaux de cette pâte, afin de les empêcher d’adhérer entre eux. A côté sont les!
iallas ou pots dans lesquels sont la provision de la mélasse et le vase renversé I
qui a servi de mesure pour la quantité de farine employée.
Fig. 4. LE CONFISEUR ou LE FABRICANT DE PÂTES SUCRÉES.
C e t art a moins de rapport avec celui de notre vermiceilier qu’avec ceuxdesl
faiseurs de pains azymes, d’oublies ou de gaufres, excepte que, pour produitel
des résultats à peu près semblables aux leurs, le vermiceilier Égyptien ne se serti
pas de ces deux plaques de fer polies intérieurement, et qu a 1 aide de deux longs I
manches, on rapproche quand on a étendu sur lune la matière a mouler et il
cuire, et qu’on éloigne quand on veut retirer cette meme matière, après lai
cuisson.
Un coup-d’oeil jeté sur la gravure va faire connoître la maniéré différente I
qu’emploie l’artiste Égyptien.
Sur le devant de sa boutique et à sa droite, est un fourneau cylindrique très- ;
vaste, portant à sa partie supérieure un large plateau de cuivre de meme diamètreI
qu’elle.
Le maître vermiceilier tient dans ses mains un vase dont le fond est percé de J
trous, comme l’est la pomme d’un arrosoir; il est rempli dun mélange liquideI
composé de farine de blé de Turquie ou de millet, d oeufs, et d eau : à 1 aide d uni
mouvement circulaire que fait la main qui porte le vase, la matière qui filtre j
par les trous, s’étend sur toute la surface du plateau chauffé, et s’y cuit en très-1
peu de temps; elle se détache d’elle-même, et d autant plus facilement que IartisteI
a eu la précaution de graisser légèrement le plateau avec du beurre.
Un aide supporte un bassin contenant la matière qui doit remplacer dans la
passoire celle qui s’est écoulée.
Ün enfant assis dans la rue et près du foyer du fourneau, y entretient le feu
avec des tiges de grand millet, espèce de combustible qu’on transporte de la haute
£gypte au Kaire, et qui y est d’une très-grande utilité.
Une femme placée sur le devant de la boutique distribue par portions le ver-
jnicel qui vient d’être cuit, et après l’avoir assaisonné avec du sel et du beurre.
Les Égyptiens sont très-friands de cette espèce d’aliment; ils le mangent tout
ch a u d , et souvent dans le lieu même où il a été préparé.
C’est particulièrement dans les grandes chaleurs, pendant les mois d’avril et
de mai, qu’ils en font un plus grand usage ; on remarque que dans cette saison
ils mangent très-peu de viande.
B o u D E T .