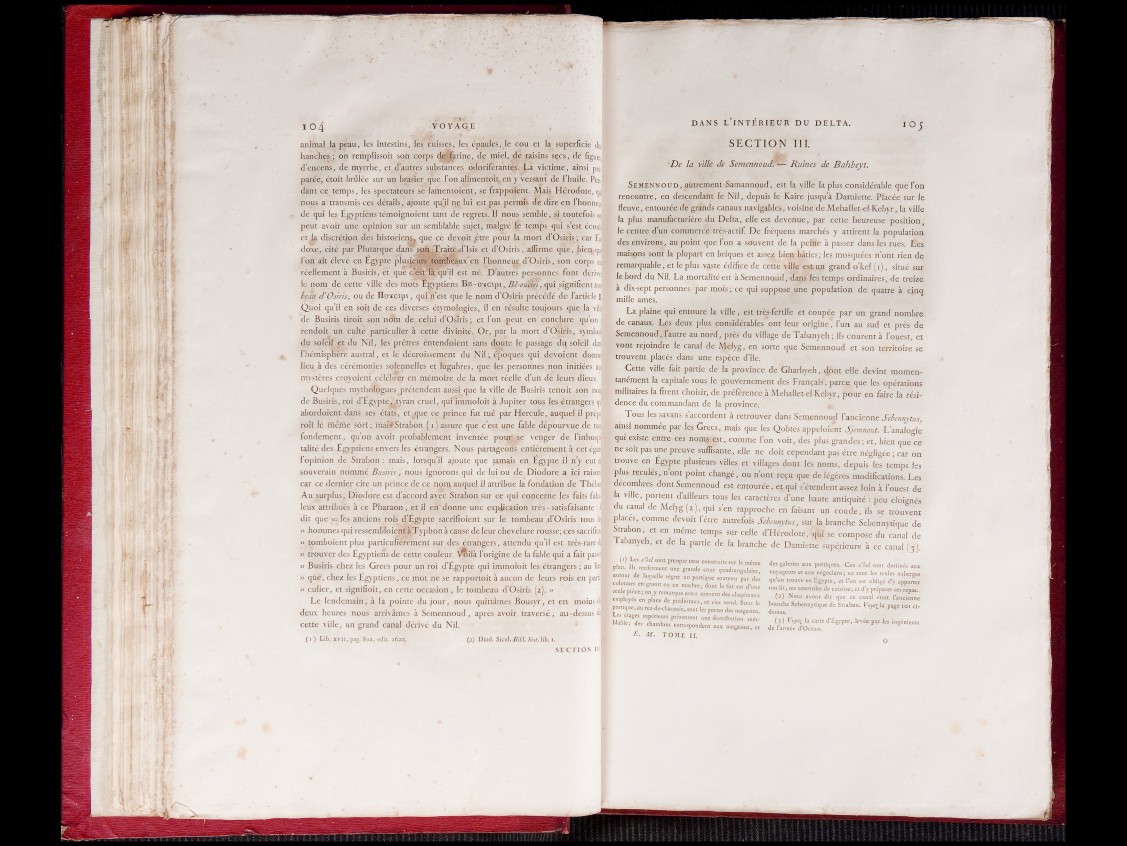
animal la peau, les intestins, les cuisses, les épaules, le cou et la superficie deil
hanches ; on remplissoit son corps de-farine, de miel, de raisins secs, de figuesB
d’encens, de myrrhe, et d’autres substances odoriférantes. La victime, ainsi p r f l
parée, étoit brûlée sur un brasier que l’on alimentoiq.en y versant de l’huile. Pen.H
dant ce temps, les spectateurs se lamentoient, se frajipoient. Mais Hérodote,qfs
nous a transmis ces détails, ajoute qu’il ne lui est pas permis de dire en l’honneul
de qui les Egyptiens témoignoient tant de regrets. 11 nous semble, si toutefois 01B
peut avoir une opinion sur un semblable sujet, malgré le temps qui s’est écouljH
e tia discrétion des historiens., que ce devoit #être pour la mort d’Osiris ; car EyB
doxe, cité par Plutarque dans spn-TraitiLd’Isis et d’Osiris, affirme que, bicnpjmB
l’on ait élevé en Egypte plusieurs tombcauxTij l’honneur d’Osiris, son corps c s l
réellement à Busiris, et que ¿est la’ qü’il est né. D ’autres personnes font dérivci
le nom de cette ville des mots Égyptiens Bit-crtcsps, Bc-ouciri, qui signifient toiÆ
beau d'Osiris, ou de ÜOfCîps, qui n’est que le nom d’Osiris précédé de l’article HH
Quoi qu’il en soit de ces diverses étymologies, il en résulte toujours que la villH
de Busiris tiroit son nom de celui d’Osiris ; et l’on peut en conclure qu’on |fl
rendoit un culte particulier à cette divinité. Or, par la mort d’Osiris, symbole®
du soleil et du Nil, les prêtres énrendoient sans doute le passage du soleil ctanB
l’hémisphère austral, et le décroissement du N i!; époques qui devoient donne
lieu à des cérémonies solennelles et lugubres, que les personnes non initiées ait
mystères croyoient célébrer en mémoire de la mort réelle d’un dé leurs dieux. I
Quelques mythologues prétendent aussi que la ville de Busiris tenoit son not
de Busiris, roi d’Egypte, tyran cruel, qui immoioit à Jupiter tous les étrangers igifl
abordoient dans ses états, et^que ce prince fut tué par Hercule, auquel il prépiB
roit le même sort; mai^Strabon ( i )■ assure que c’est une fable dépourvue de toi
fondement, qu’on avoit probablement inventée pour' -se vepger de l’inhospï ■
talité des Egyptiens envers les étrangers. Nous partageons entièrement à cet égari
l’opinion de Strabon : mais, lorsqu’il ajoute que jamais en Egypte il n’y eutÆ
souverain nommé Busiris, nous ignorons qui de lui ou de Diodore a ici raisonB
car ce dernier cite un prince de ce noiq. auquel il attribue la fondation de ThèteB
A u surplus, Diodore est d’accord avec Strabon sur ce qui concerne Jes faits fa kB
leux attribués à ce Pharaon, et il en* donne une explication très - satisfaisante : ■
dit que «.les anciens rois d’Egypte sacrifioient sur le tombeau .d’Osiris tous le .
» hommes quiressembloientàTyphonàcause de leur chevelure rousse; ces sacrifice
» tomboient plus particulièrement sur des étrangers , attendu qu’il est très-rare <1
» trouver des Égyptiens de cette couleur. Voilà l’origine de la fable qui a fait passa
y Busiris chez les Grecs pour un roi d’Egypte qui immoioit les étrangers ; au lie
y qiie, chez les Egyptiens, ce mot nè se rapportoit à aucun de leurs rois en parti
y culier, et signifioit, en cette occasion, le tombeau d’Osiris (2),»
Le lendemain, à la pointe du jour, nous quittâmes Bousyr, et en moinsIB
deux heures nous arrivâmes à Semennoud, après avoir traversé, au-dessus I f l
cette ville, un grand canal dérivé du Nil.
( i ) Lib. X V I I , pag. 802, edit. 1620. (2) Diod. Sicul. Bibl. hist. lib. I.
S EC TION III.
D e la ville de Semennoud,Ruine s de Bahbeyt.
S e m e n n o u d , autrement Samannoud, est la ville la plus considérable que l’on
rencontre, en descendant le N il, depuis le Kaire jusqu’à Damiette. Placée sur le
fleuve, entourée de grands canaux navigables, voisine de Mehallet-el-Kebyr, la ville
la plus manufacturière du Delta, elle est devenue, par cette heureuse position
le centre d’un commerce très-actif De fréquens marchés y attirent la population
des environs, au point que l’on a sduvent de la peine à passer dans les rues. Les
maisons sont la plupart en briques et assez bien bâties; les mosquées n’ont rien de
remarquable, et le plus vaste édifice de cette ville est un grand o’kel (1), situé sur
le bord du Nil. La mortalité est àSemenno,ud, dans les temps ordinaires, de treize
à dix-sept personnes par mois ; ce qui suppose une population de quatre à cinq
mille ames.
La plaine qui entoure la ville, est très-fertile et coupée par un grand nombre
de canaux. Les deux plus considérables ont leur origine, l’un au sud et près de
Semennoud, l’autre au nord, près du village de Tabanyeh; ils courent à l’ouest, et
vont rejoindre le canal de Melyg, en sorte que Semennoud et son territoire se
trouvent placés dans une espèce d’île.
Cette ville fait partie de la province de Gharbyeh, dont elle devint momentanément
la capitale sous le gouvernement des Français, parce que les opérations
militaires la firent choisir, de préférence à Mehallet-el-Kebyr, pour en faire la résidence
du commandant de la province.
Tous les savans s accordent à retrouver dans Semennoud l’ancienne Sebennytus,
ainsi nommée par les Grecs, mais que les Qobtes appeloient Sjemnout. L ’analogie
qui existe entre ces noms est, comme l’on voit, des plus grandes; et, bien que ce
ne soit pas une preuve suffisante, elle ne doit cependant pas être négligée ; car on
trouve en Egypte plusieurs villes et villages dont les noms, depuis les temps les
plus reculés, n ont point changé, ou n’ont reçu que de légères modifications. Les
décombres dont Semennoud est entourée, et qui s’étendent assez loin à l’ouest de
,1a ville, portent d ailleurs tous les caractères d’une haute antiquité ; peu éloignés
du canal de Melyg (2), qui s’en rapproche en faisant un coude, ils se trouvent
placés, comme devoit l’être autrefois Sebennytus, sur la branche Sebennytique de
Strabon et en même temps sur celle d’Hérodote, qui se compose du canal de
iabanyeh, et de la partie de la branche de Damiette supérieure à ce canal
| (I) Les o’htl sont presque tous construits sur le même
plan. Ils renferment une grande cour quadrangulaire,
autour de laquelle règne un portique soutenu par des
colonnes en granit ou en marbre, dont le fût est d'une
seule piece; on y remarque assez souvent des chapiteaux
employés en place de piédestaux, et vice versa. Sous le
portique, au rez-dochaussée,sont les portes des magasins.
Les Ctages supérieurs présentent une distribution semblable;
des chambres correspondent aux magasins, et
É . M . T O M E I I .
V 5 h
des galeries aux portiques. Ces o’kel sont destinés aux
voyageurs et aux négocians ; ce sont les seules auberges
qu’on trouve en Egypte, et l’on est obligé d’y apporter
son lit, ses ustensiles de cuisine, et d’y préparer ses repas.
(2) Nous avons dit que ce canal étoit l’ancienne
branche Sebennytique de Strabon. Voye^ la page 101 ci-
dessus.
( 3 ) Y°y*l la carte d’Egypte, levée par les ingénieurs
de l’armée d’Orient.