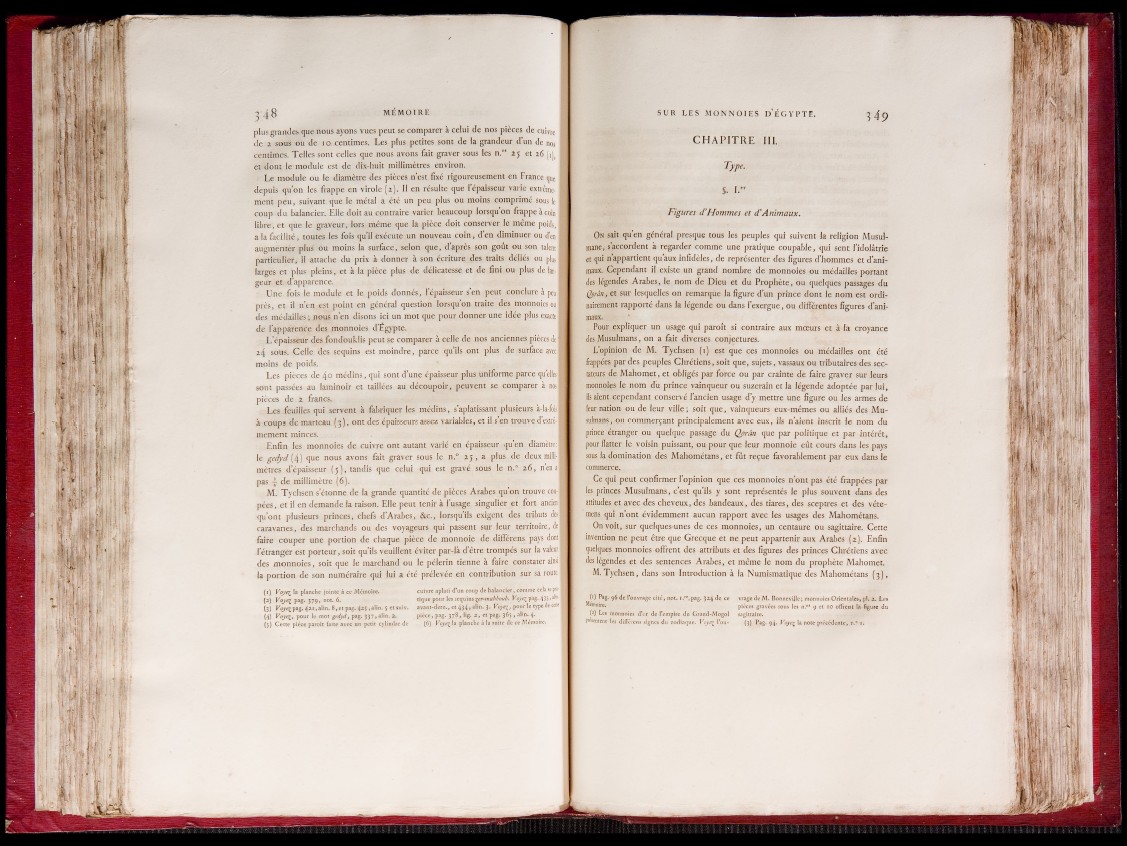
plus grandes que nous ayons vues peut se comparer à celui de nos pièces de cuivre I
de 2 sous ou de i o centimes. Les plus petites sont de la grandeur d’un de nos I
centimes. Telles sont celles que nous avons fait graver sous les n.°‘ 25 et 26 (i),
et dont le module est de dix-huit millimètres environ.
Le module ou le diamètre des pièces n’est fixé rigoureusement en France que I
depuis qu’on les frappe en virole (2). Il en résulte que (épaisseur varie extrême-1
ment peu, suivant que le métal a été un peu plus ou moins comprime sous le I
coup du balancier. Elle doit au contraire varier beaucoup lorsqu’on frappe à coin I
libre, et que le graveur, lors même que la pièce doit conserver le même poids, I
a la facilité, toutes les fois qu’il exécute un nouveau coin, d’en diminuer ou d’en I
augmenter plus ou moins la surface, selon que, d’après son goût ou son talent I
particulier, il attache du prix à donner à son écriture des traits déliés ou plus I
larges et plus pleins, et à la pièce plus de délicatesse et de fini ou plus de far-1
geiir et d’apparence.
Une fois le module et le poids donnés, l'épaisseur s’en peut conclure à peu I
près, et il n’en est point en général question lorsqu’on traite des monnoiesoul
des médailles; nous n’en disons ici un mot que pour donner une idée plus exacte I
de l’apparertee des monnoies d’Égypte.
L ’épaisseur des fondouklis peut se comparer à celle de nos anciennes pièces de I
24 soüs. Celle des sequins est moindre, parce qu’ils ont plus de surface avecl
moins de poids.
Les pièces de 4o médms, qui sont d’une épaisseur plus uniforme parce quelles!
sont passées au laminoir et taillées au découpoir, peuvent se comparer à nos!
pièces de 2 francs.
Les feuilles qui servent à fabriquer les médins, s’aplatissant plusieurs à-la-fois I
à coups de marteau (3), ont des épaisseurs assez variables, et ils ’en trouve d’exttc-J
mement minces.
Enfin les monnoies de cuivre ont autant varié en épaisseur »qu’en diamètre:!
le gedyd (4) que nous avons fait graver sous le n.° 25 , a plus de deux milli-l
mètres d’épaisseur (y ), tandis que celui qui est gravé sous le n.° 26, n’en al
pas 4- de millimètre (6).
M. Tychsen s’étonne de la grande quantité de pièces Arabes qu’on trouve cûu-|
pées, et il en demande la raison. Elle peut tenir à l’usage singulier et fort ancien!
qu’ont plusieurs princes, chefs d’Arabes, &c., lorsqu’ils exigent des tributs des!
caravanes, des marchands ou des voyageurs qui passent sur leur territoire, deI
faire couper une portion de chaque pièce de monnoie de differens pays dont 1
l’étranger est porteur, soit qu’ils veuillent éviter par-là d’être trompés sur la valeuil
des monnoies, soit que le marchand ou le pèlerin tienne à faire constater ainsi!
la portion de son numéraire qui lui a été prélevée en contribution sur sa route !
(1) Vqye^ la planche jointe à ce Mémoire.
(2) Voyez pag. 379, not. 6.
(3) Voyez pag. 421 > alin. 8, et pag. 425 , alin. 5 et fuiv.
(4) Voyez, pour le mot gedyd} pag. 3 3 7 ,alin. 2.
(5) Cette pièce paroît faite avec un petit cylindre de
cuivre aplati d’un coup de balancier, comme cela se pra* 1
tique pour les sequins zer~inahboub. Voyez pâg. 433 » a“n' I
avant-dem., et 434 » alin. 3. Voyez, pour le type de cette 1
pièce, pag. 378, lig. 2 , et pag. 365, alin. 4-
(6) Voyez la planche à la suite de ce Mémoire.
CHAPITRE III.
Type.
§. I ."
Figures d'Hommes et d’Animaux.
O n sait qu’en général presque tous les peuples qui suivent la religion Musulmane,
s’accordent à regarder comme une pratique coupable, qui sent l’idolâtrie
et qui n’appartient qu’aux infidèles, de représenter des figures d’hommes et d’animaux.
Cependant il existe un grand nombre de monnoies ou médailles portant
des légendes Arabes, le nom de Dieu et du Prophète, ou quelques passages du
Qorân, et sur lesquelles on remarque la figure d’un prince dont le nom est ordinairement
rapporté dans la légende ou dans l’exergue, ou différentes figures d’animaux.
Pour expliquer un usage qui paroît si contraire aux moeurs et à la croyance
des Musulmans, on a fait diverses conjectures.
L’opinion de M. Tychsen (t) est que ces monnoies ou médailles ont été
frappées par des peuples Chrétiens, soit que, sujets, vassaux ou tributaires des sectateurs
de Mahomet, et obligés par force ou par crainte de faire graver sur leurs
monnoies le nom du prince vainqueur ou suzerain et la légende adoptée par lui,
ils aient cependant conservé l’ancien usage d’y mettre une figure ou les armes de
leur nation ou de leur ville; soit que, vainqueurs eux-mêmes ou alliés des Musulmans,
ou commerçant principalement avec eux, ils n’aient inscrit le nom du
prince étranger ou quelque passage du Qorân que par politique et par intérêt,
pour flatter le voisin puissant, ou pour que leur monnoie eût cours dans les pays
sous la domination des Mahométans, et fût reçue favorablement par eux dans le
commerce.
Ce qui peut confirmer l’opinion que ces monnoies n’ont pas été frappées par
les princes Musulmans, c’est qu’ils y sont représentés le plus souvent dans des
attitudes et avec des cheveux, des bandeaux, des tiares, des sceptres et des vête-
mens qui n’ont évidemment aucun rapport avec les usages des Mahométans.
On voit, sur quelques-unes de ces monnoies, un centaure ou sagittaire. Cette
invention ne peut être que Grecque et ne peut appartenir aux Arabes (2). Enfin
quelques monnoies offrent des attributs et des figures des princes Chrétiens avec
des légendes et des sentences Arabes, et même le nom du prophète Mahomet.
M. Tychsen, dans son Introduction à la Numismatique des Mahométans (3),
(0 ^ag’ 96 de l’ouvrage cite, not. i .rc, pag. 324 de ce vrage de M. Bonnevillc; monnoies Orientales, pl. 2. Les
Mémoire. pièces gravées sous les n.°* 9 et 10 offrent la figure du
(2) Les monnoies d’or de l’empire du Grand-Mogol sagittaire,
présentent les differens signes du zodiaque. Voyez l’ou- (3) Pag. 94. Voyez la note précédente, n.° 1.