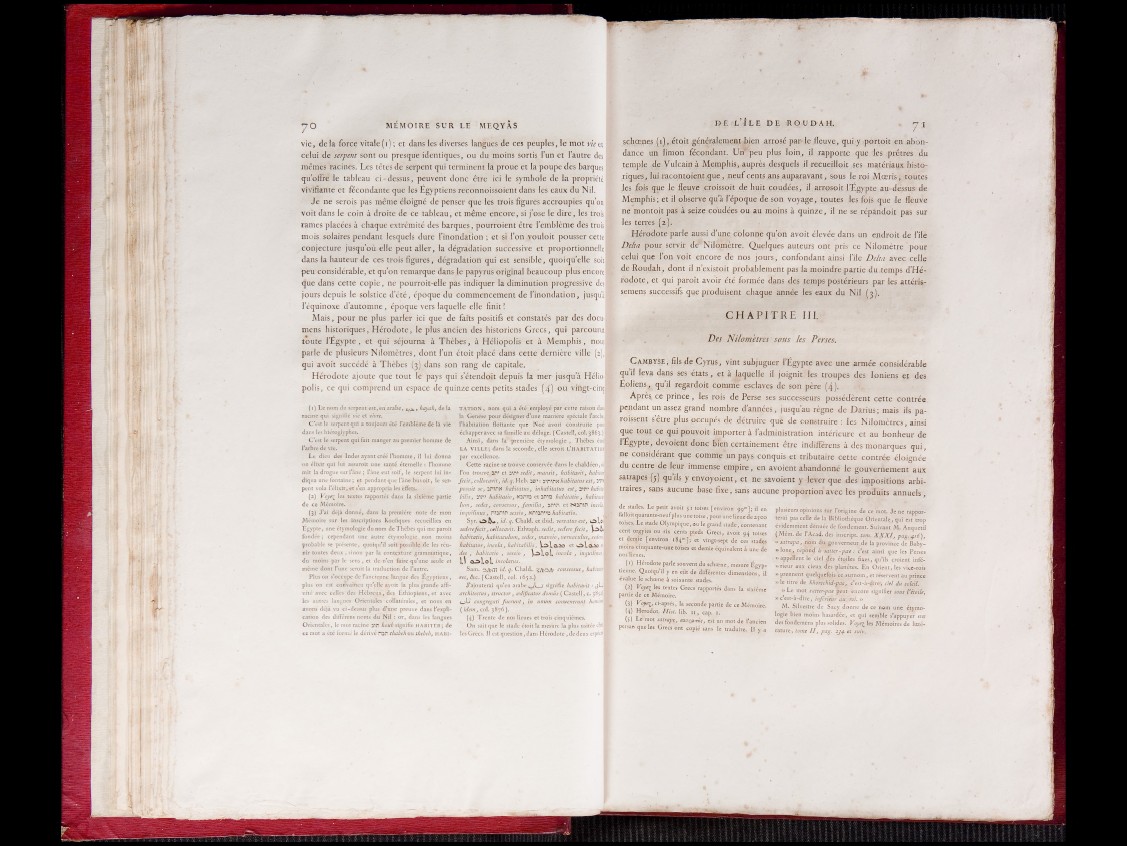
vie, de la force vitale (i) ; et dans les diverses langues de ces peuples, le mot vie et I
celui de serpent sont ou presque identiques, ou du moins sortis l’un et l’autre des ■
mêmes racines. Les têtes de serpent qui terminent la proue et la poupe des barques I
qu’offre' le tableau ci - dessus, peuvent donc être ici le symbole de la propriété I
vivifiante et fécondante que les Egyptiens reconnoissoient dans les eaux du Nil.
Je ne serois pas même éloigné de penser que les trois figures accroupies qu’on I
voit dans le coin à droite de ce tableau, et même encore, si j’ose le dire, les trois H
rames placées à chaque extrémité des barques, pourroient être l’emblème des trois H
mois solaires pendant lesquels dure l’inondation ; et si l’on vouloit pousser cette H
conjecture jusqu’où.elle peut aller, la dégradation successive et proportionnelle!
dans la hauteur de ces trois figures, dégradation qui est sensible, quoiqu’elle s o it!
peu considérable, et qu’on remarque dans le papyrus original beaucoup plus encore I
que dans cette copie, ne pourroit-elle pas indiquer la diminution progressive d e s!
jours depuis le solstice d’été, époque du commencement de l’inondation, jusqu'il
l’équinoxe d’automne, époque vers laquelle elle finit !
Mais, pour ne plus parler ici que de faits positifs et constatés par des d o c u l
mens historiques, Hérodote, le plus ancien des historiens Grecs, qui parcourut!
toute l’Egypte, et qui séjourna à Thèbes, à Héliopolis et à Memphis, no»;?
parle de plusieurs Nilomètres, dont l’un étoit placé dans cette dernière ville (2 ] ,!
qui avoit succédé à Thèbes (3) dans son rang de capitale.
Hérodote ajoute que tout le pays qui s’étendoit depuis la mer jusqu’à Hélio j
polis, ce qui comprend un espace de quinze cents petits stades (4) ou vingt-cini[|
(1) Le nom du serpent est, en arabe, , hayah, de la
racine qui signifie vie et vivre.
C ’est le serpent qui a toujours été l’emblème de la vie
dans les hiéroglyphes.
C ’est le serpent qui fait manger au premier homme de
l’arbre de vie.
Le dieu des Indes ayant créé l’homme, il lui donna
-un élixir qui lui assurait une santé éternelle : l’homme
mit la drogue sur l’âne ; l’âne eut soif, le serpent lui indiqua
une fontaine; et pendant que l'âne buvoit, le serpent
vola l’élixir, et s’en appropria les effets. -
(2) Voye^ les textes rapportés dans la sixième partie
de ce Mémoire.
(3) J’ai déjà donné, dans la première note de mon
Mémoire sur les inscriptions Koufiques recueillies en
Egypte, une étymologie du nom de Thèbes qui me parait
fondée ; cependant une autre étymologie non moins
probable se présente, quoiqu'il soit possible de les réunir
toutes deux , sinon par la contextura grammatique,
du moins par le sens, et de n’en faire qu*une seule et
même dont l’une serait la traduction de l’autre.
Plus on s’occupe de l’ancienne langue des Egyptiens ,
plus on est convaincu qu’elle ayoit la plus grande affinité
avec celles des Hébreux, des Ethiopiens, et avec
les autres langues Orientales collatérales, et nous en
avons déjà vu ci-dessus plus d’une preuve dans l’explication
des différens noms du Nil : or, dans les langues
Orientales, le mot racine ain houb signifie HABITER; de
ce mot a été formé le dérivé nan thabeh ou thebeh, habi-
TA TION , nom qui a été employé par cette raison danH
la Genèse pour désigner d’une manière spéciale l’arche,,
l’habitation flottante que Noé avoit construite pouf ;
échapper avec sa famille au déluge. (Castell, coI.3863.jH
Ainsi, dans la*première étymologie , Thèbes étoiH
LA v il l e ; dans la seconde, elle serait l’h a b itAtiokH
par excellence.
Cette racine se trouve conservée dans le chaIdéen,oiH
l’on trouve 3IV et a»f\* sedit, mansit, habitavit, habita^Ê
fecit, collocavit, id. q. Heb. aiu' : asJVf\x habitants est, awi
posuit se, afnnx habitants, inhdbitatus est, habite-
bilis, airv habitatio, NarOD et 3MO habitatio, habitacu-Wt
lum, sedes, consessus, familia, arvir\ et KafMn incok^Ê
inquilinus, maWlh sessio, itmam’D habitatio.
S y r . o * . , id. q. Chald. et ibid. versatus est, o lo i
sederefecit ,c*llocavit. Ethtaph, sedit, sedere fecit,
habitatio, habitaculuin, sedes, mansio, vemaculus, sedem,H
habitator, incoia, habitabilis, 1,0.20 et o l o ^ o
des , habitatio , sessio , incoia , in q u ilin u s M
1,) OJüLoL incoiai lis.
Sam. âACTf id. q. Chald. ^A^A consessus, habitait]
res, ôte. ( Castell, col. 1652.)
J’ajouterai qu’en arabe < >L ï signifie habitavit : j L v
archi tee tus, structor , ædificator domus ( Castell, c. 3^52)';
c jG congregati fuerunt, in unum convenerunt honûimffi
( idem, col. 3876).
(4) Trente de nos lieues et trois cinquièmes.
On sait que le stade étoit la mesure la plus usitée cher
les Grées. 11 est question, dans Hérodote, de deux espèce*
schcepes ( 1 ),,étoit généralement .bien arrosé par le fleuve, quiy portoit en abondance
un limon fécondant. Un peu plus loin, il rapporte que les prêtres du
temple fle Vulcain à Memphis, auprès desquels il recueilloit ses matériaux historiques,
lui racqntoient q u e , neuf cents ans auparavant, sous le roi Moeris, toutes
les fois que le fleuve croissoit de huit coudées, il.arrosoit l’Egypte au-dessus de
Memphis; et il observe qu’à l’époque de son voyage, toutes les fois que le fleuve
ne montoit pas à seize coudées ou au moins à quinze, il ne se répândoit pas sur
les terres (2).
Hérodote parle aussi d’une colonne qu’on avoit élevée dans un endroit de l’île
Delta pour servir de*Nilomètre. Quelques auteurs ont pris ce Nilomètre pour
celui que l’on voit encore de nos jours, confondant ainsi l’île Delta avec celle
de Roudah, dont il n’existoit probablement pas la moindre partie du temps d’Hé-
rodote, et qui paroît avoir été formée dans des temps postérieurs par les attéris-
seraens successifs que produisent chaque année les eaux du Nil (3).
C H A P I T R E III.
Des Nilomètres sous les Perses.
C ambyse, fils de Cyrus, vint subjuguer l’Egypte avec une armée considérable
qu il leva dans ses états, et à laquelle il joignit les troupes des Ioniens et des
Éoliens, qu’il regardoit comme esclaves de son père (4).
Après, ce prince, les rois de Perse ses successeurs possédèrent cette contrée
pendant un assez grand nombre d’années, jusqu’au règne de Darius; mais ils pa-
roissent s’être plus occupés de détruire què de construire : les Nilomètres, ainsi
que tout ce qui pouvoit importer à l’administration intérieure et au bonheur de
l’Egypte, devoient donc bien certainement être indifférens à des monarques qui,
ne considérant que comme un pays conquis et tributaire cette contrée éloignée
du centre de leur immense empire, en avoient abandonné le gouvernement aux
satrapes (5) qu’ils y envoyoient, et ne savoient y lever que des impositions arbitraires,
sans aucune base fixe, saris aucune proportion avec les produits annuels ,
de stades. Le petit avoit 51 toises [environ 99™]; il en
falloit quarante-neuf plus une toise, pour une lieue de 2500
toises. Le stade Olympique, ou le grand stade, contenant
cent orgyies ou six cents pieds Grecs, avoit 94 toises
et demie [environ 184*"]; et vingt-sept de ces stades
moins cinquante-une toises et demie équivalent à une de
nos îiéues.
( 1 ) Hérodote parle souvent du schcene, mesure Égyptienne.
Quoiqu’il y en eût de différentes dimensions, il
évalue le schoene à soixante stades.
(2) Voyez les textes Grecs rapportés dans la sixième
partie de ce Mémoire.
(3) Voye^, ci-après, la seconde partie de ce Mémoire.
(4) Herodot. Hist. Iib. 11, cap. 1.
(j) Le mot satrape, <ru.T&e.mlç, est un mot de l’ancien
persan que les Grecs ont copié sans le traduire. II y a
plusieurs opinions sur l’origine de ce mot. Je ne rapporterai
pas celle de la Bibliothèque Orientale, qui est trop
évidemment dénuée de fondement. Suivant M. Anquetil
(Mém. de I’Acad. des inscript, tom. X X X I , pag. 416),
« satrapa, -nom du gouverneur de la province de Baby-
» l°nÇ> répond à satter-pae : c’est ainsi que les Perses
»appellent le ciel des étoiles fixes, qu’ils croient infé-
» rieur aux cieux des planetes. En Orient, les vice-rois
» prennent quelquefois ce surnom, et réservent au prince
» le titre de khorschid-pae, c’est-à-dire, ciel du soleil.
» Le mot satter-pae peut-'encore signifier sous Vétoile,
» c'est-à-dire, inférieur au. roi. »
M. Silvestre de Sacy donne de ce nom une étymologie
bien moins hasardée, et qui semble s’appuyer sur
des fondemens plus solides. Voye^ les Mémoires de littérature,
tome I I , pag. 2j+ et suiv.