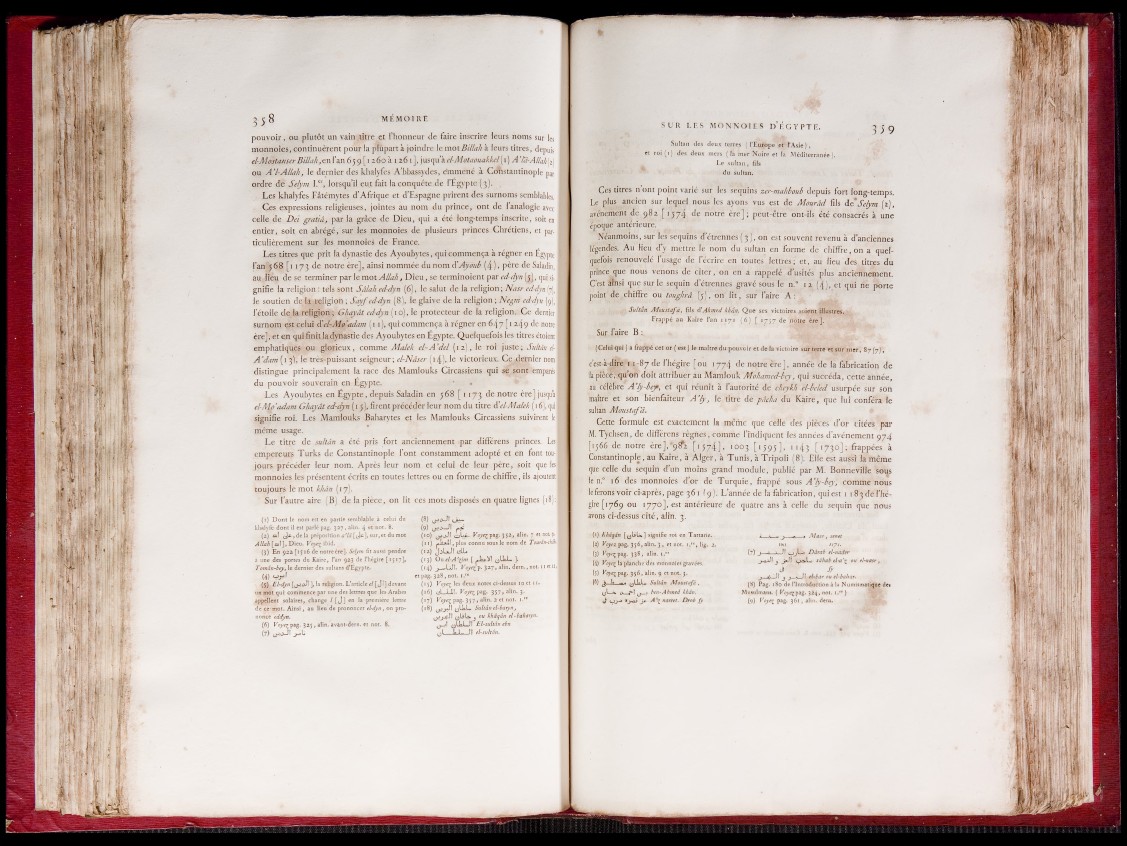
2 ^ 8 M É M O I R E
pouvoir, ou plutôt un vain titre et l’honneur de faire inscrire leurs noms sur 1« I
monnoies, continuèrent pour la plupart à joindre le mot Billah à leurs titres, depuis I
el-Mostanser Billah , t nl’an 65 9 [1 260 à 1 26 t], jusqu’à el-Motaouakkel(1) A ’l'à-Allah^ I
ou A ’l-Allah, le dernier des khalyfes A ’hbassydes, emmené à Conistantinople par I
ordre de Selym I.£r, lorsqu’il eut fait la conquête de l’Egypte (3). ,
Les khalyfes Fâtémytes d’Afrique et d’Espagne prirent des surnoms semblables, I
Ces expressions religieuses, jointes au nom du prince, ont de 1 analogie avec I
celle de Det gratta, par la grâce de Dieu, qui a été long-temps inscrite, soit en I
entier, soit en abrégé, sur les monnoies de plusieurs princes Chrétiens, et par- I
ticulièrement sur les monnoies de France.
Les titres que prit la dynastie des Ayouhytes, qui commença à régner en Egypte I
l’an y 68 [1 173 de notre ère], ainsi nommée du nom SAyoub (4 ), père de Saladin, I
au lieu de se terminer par le mot Allah, Dieu, se terminoient par ed-dyn (y), qui s¡. I
gnifie la religion : tels sont Sâlah ed-dyn (6), le salut de la religion ; Nasr ed-dyn (7), I
le soutien de la religion ; Sayf ed-dyn (8), le glaive de la religion ; Negrn ed-dyn (9), !
l'étoile de la religion ; Ghayât ed-dyn ( 1 o), le protecteur de la religion. Ce dernier I
surnom est celui Sel-M o’adain (n ) , qui commença à régner en 64/ [ 1 ^49 d e notre I
ère], et en qui finit la dynastie des Ayoubytes en Egypte. Quelquefois les t it r e s é t o ie n t l
emphatiques ou glorieux, comme Malek e l-A ’del (12), le roi juste; Sultán ti-1
A ’dam (13], le très-puissant seigneur; cl-Nâscr ( i4 )> Ie victorieux. Ce .d e r n ie r nom '
distingue principalement la race des Mamlouks Circassiens qui se sont emparés 1
du pouvoir souverain en Egypte. • .
Les Ayoubytes en Égypte, depuis Saladin en y 68 [ 1 173 de notre ère] jusqu’i l
el-M.o’adam Ghayât ed-dyn ( 1 y), firent précéder leur nom du titre d’el-Malek ( 16], quil
signifie roi. Les Mamlouks Baharytes et les Mamlouks Circassiens suivirent le l
même usage.
Le titre de sultan a été pris fort anciennement par différens princes. Les
empereurs Turks de Constantinople font constamment adopté et en font to u -.
jours précéder leur nom. Après leur nom et celui de leur père, soit que les !
monnoies les présentent écrits en toutes lettres ou en forme de chiffre, ils ajoutent*
toujours le mot khân (17).
Sur l’autre aire (B) de la pièce, on lit ces mots disposés en quatre lignes (18):
(1) Dont le nom est en partie semblable à celui du (8)
khalyfe dont il est parlé pag. 327 , alin. 4 et not. 8. (9) —Il
(2) «il J * ,d e la préposition sur,et du mot (10) ^ o J f Voyezptg' 352> alin. 7 et not.9. ■
Allah [ail], Dieu. Voyez ibid. (11) jJi*II, plus connu sous le nom de Tourân-châhM
(3) En 922 [1516 de notre ère]. Selym fit aussi pendre (12) J_>LJ| cdJL*
à une des portes du Kaire, l’an 923 de l’hégire [1517], (13) Ou el-A\ïm [ ^JifiVI y lk L . ].
Tomân-bey, le dernier des sultans d’Egypte. (14) Voyez p. 327 > a^n> dern., not. 11 etiiiH
(4) VJ**' et pag. 328, not. i.rc
(5) El-dyn [^jjoJI], la religion. L’article e/[JI] devant (15) Voyez les deux notes ci-dessus toet 11.
un mot qui commence par une des lettres que les Arabes (16) cfLLU. Voyez pag. 357, alin. 3.
appellent solaires, change / [ J ] en la première lettre (17) Voyez pag. 357, alin. 2 et not. i.,e
de ceamot. Ainsi, au lieu de prononcer el-dyn, on pro- (18) ^ ^ J l ^ILL. Sultanel-baryn,
nonce eddyn. j^j^jîJI ylàU. j ou khâqân el-baharyn.
(6) Voyez pag. 325, alin. avant-dern. et not. 8. «¡y-íl (jUaJLJI El-sultânebn
(7> ^yjo-îl |j$ L L - J I el-sultân.
S U R L E S M O N N O I E S d ’É G Y P T E . 3 5 9
Sultan des deux terres ( l’Europe e t 't fA s ie ) ,
et roi (^1 ) dés deux mers ( fa mer Noire et la Méditerranée ),
Le sultan, fils
du sultan.
Ces titres n ont point varié sur les seejuins zer-mahboub depuis fort long-temps.
Le plus ancien sur lequel nous les ayons vus est de Mourâd fils A*Selym II),
avènement de 982 [ r y 74 de notre ère] ; peut-être ont-ils été consacrés à une
époque antérieure.
Néanmoins, sur les sequins d’étrennes ( 3 ), on est souvent revenu à d’anciennes
légendes. Au Heu d’y mettre le nom du sultan en forme de chiffre, on a quelquefois
renouvelé l’usage de lecrire en toutes lettres; et, au lieu des titres du
prince que nous venons de citer, on en a rappelé d’usités plus anciennement.
C’est âinsi que sur le sequin d’étrennes gravé sous le n.° 12 (4 ), et qui ne porte
point de chiffre ou toughrâ (y), on lit, sur l’aire A :
Sultan AToustafà, fils cl 'Ahmed khân. Q u e ses victoires soient illustres.
Frappé au Kaire l’an i 17.1 (6 ) [ 1 7 5 7 de notre ère] .
Sur faire B :
! (Celui qui ) a frappé cet or ( est ) le maître du.pouvoir et de la victoire sur terre et sur nier, 87 (7 ) ,
c’est-à-dire 11-87 de l’hégire [ou 1774 de notre ère], année de la fabrication de
la pièce]-qu’on doit attribuer au Mamlouk Mohamed-hey, qui succéda, cette année,
au célèbre A ’iy-bef, et qui réunit à l’autorité de cheykh el-bcled usurpée sur son
maître et son bienfaiteur A ’iy, le titre de pâcha du Kaire, que lui conféra le
sultan Moustaf'à.
Cette formule est exactement la même que celle des pièces d’or citées par
M. Tychsen, de différens règnes, comme l’indiquent les années d’avénement 974
[1566 de notre è re],*9^2 [ 1 y 7 4 ] . 1003 [ l y ç y ] , 1143 [ 1730]; frappées à
Constantinople, au Kaire, à Alger, à Tunis, à Tripoli (8). Elle est aussi la même
que celle du sequin d’un moins grand module, publié par M. Bonneville sous
le n.° 16 des monnoies d’or de Turquie, frappé sous A ’/y-ley, comme nous
leferons voir ci-après, page 361 (9). L ’année de la fabrication, qui est 1 183 de l’hégire
[1769 ou 1770], est antérieure de quatre ans à celle du sequin que nous
avons ci-dessus cité, alin. 3.
(1) Khâqân [qU'Ü*] signifie roi en Tartarie.. ¿ 1 _ j . Masr, senet
(2) Voyez pag. 356, alin. 3, et not. i . re, lig. 2. iivi , nyt.
(3) Voy^ pag. 338, alin. 1 ." Í7Í j — Â-Jf Dârab el-nader
(4) Voyezla planche des monnoies gravées. _>a-JI j sâhab el-a z ou el-nasr,
(5) pag. 35«. alin. 9 et not. 3. y. JK, ^ J | M dr Í à-buhar.
(6) j - L — a 'M - SuUi" S lo u s ta fii , (8) Pag. 180 de l’Introduction à la Numismatique de.
t)L_a. <x—^1 ^y—j ben-Ahmed khân. Musulmans. ( Voyez pag. 324, not. i.,e)
J uâj-• j« A \ nasret. Drob jÿ (o ) Voyez pag. 361, alin. dern.