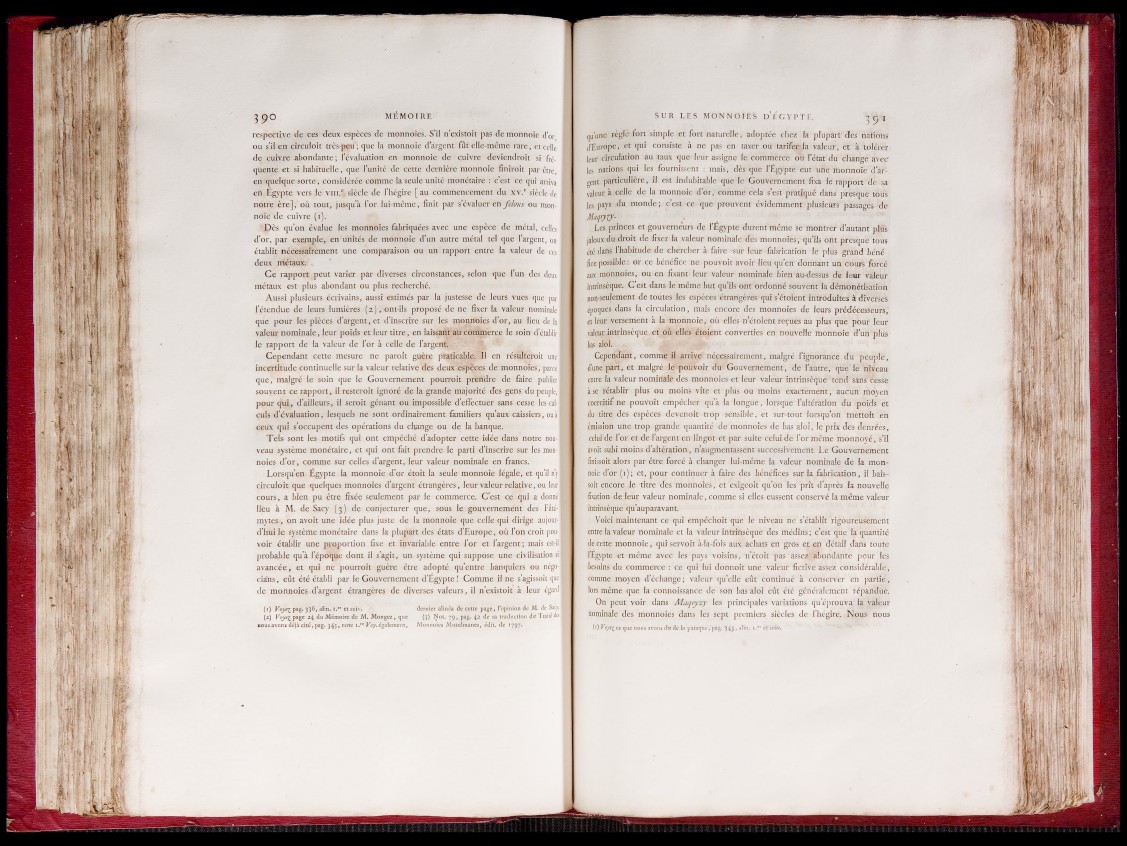
respective de ces deux espèces de monnoies. S’il n’existoit pas de monnoie d’or I
ou s’il en circuloit très-peu; que la monnoie dargent fût elle-même rare, et celle I
de cuivre abondante ; l’évaluation en monnoie de cuivre deviendroit si fié- I
quente et si habituelle, que l’unité de cette dernière monnoie fîniroit par être I
en quelque sorte, considérée comme la seule unité monétaire : c’est ce qui arriva I
en Egypte vers le vin .' siècle de l’hégire [ au commencement du x v .' siècle de I
notre ère], où tout, jusqu’à l’or lui-même, finit par s’évaluer en félons ou mon- I
noie de cuivre (i).
Dès qu’on évalue les monnoies fabriquées avec une espèce de métal, celles I
d’or, par exemple, en unités de monnoie d’un autre métal tel que l’argent, on I
établit nécessairement une comparaison ou un rapport entre la valeur de ces I
deux métaux. .
C e rapport peut varier par diverses circonstances, selon que l’un des deux I
métaux est plus abondant ou plus recherché.
Aussi plusieurs écrivains, aussi estimés par la justesse de leurs vues que par I
l’étendue de leurs lumières (2 ), ont-ils proposé de ne fixer la valeur nominale I
que pour les pièces d’argent, et d’inscrire sur les monnoies d’or, au lieu de la I
valeur nominale, leur poids et leur titre, en laissant au commerce le soin d’établir I
le rapport de la valeur de l’or à celle de l’argent.
Cependant cette mesure ne paroît guère praticable. Il en résulteroit une!
incertitude continuelle sur la valeur relative des deux espèces de monnoies, parce I
que, malgré le soin que le Gouvernement pourroit prendre de faire publier!
souvent ce rapport, il resteroit ignoré de la grande majorité des gens du peuple,!
pour qui, d’ailleurs, il seroit gênant ou impossible d’effectuer sans cesse les cal-1
culs d’évaluation, lesquels ne sont ordinairement familiers qu’aux caissiers, oui ;
ceux qui s’occupent des opérations du change ou de la banque.
Tels sont les motifs qui ont empêché d’adopter cette idée dans notre nou-l
veau système monétaire, et qui ont fait prendre le parti d’inscrire sur les mon-1
noies d’o r, comme sur celles d’argent, leur valeur nominale en francs.
Lorsqu’en Egypte la monnoie d’or étoit la seule monnoie légale, et qu’il n’y■
circuloit que quelques monnoies d’argent étrangères, leur valeur relative, ou leur!
cours, a bien pu être fixée seulement par le commerce. C ’est ce qui a donné!
lieu à M. de Sacy (3) de conjecturer que, sous le gouvernement des Fâté-1
mytes., on avoit une idée plus juste de la monnoie que celle qui dirige aujour-l
d’hui le système monétaire dans la plupart des états d’Europe, où l’on croit pou-l
voir établir une proportion fixe et invariable entre l’or et l’argent ; mais est-il I
probable qu’à l’époque dont il s’agit, un système qui suppose une civilisation si 1
avancée, et qui ne pourroit guère être adopté qu’entre banquiers ou négo-|
cians, eût été établi par le Gouvernement d’Egypte ! Comme il ne s’agissoit quel
de monnoies d’argent étrangères de diverses valeurs, il n’existoit à leur égardI
(1) Voyt£ pag. 336, alin. i.er et süiv, dernier alinéa de cette page, l’opinion de M. de Sacy.I
(2) Voytç page 24 du Mémoire de M. Mongez, que (3) Not. 79, pag. 42 de sa traduction dtf Traité des!
nous avons déjà cité, pag. 345, note i.,e Voy.également, Monnoies Musulmanes, édit. de 1797.
qu’une règle fort simple et fort naturelle, adoptée chez la plupart des nattons
d’Europe, et qui consiste à ne pas en taxer ou tarifer la valeur, et à tolérer
leur circulation au taux que leur assigne le commerce ou l’état du change avec
[es nations qui les fournissent ; mais, dès que l’Égypte eut une monnoie d’argent
particulière, il est indubitable que le Gouvernement fixa le rapport de sa
valeur à celle de la monnoie d’or, comme cela s’est pratiqué dans presque tous
les pays du monde ; c’est ce que prouvent évidemment plusieurs passages de
Maqryzy-
Les princes et gouverneurs de l’Égypte durent même se montrer d’autant plus
jaloux du droit de fixer la valeur nominale des monnoies, qu’ils ont presque tous
été dans l’habitude de chercher à faire sur leur fabrication le plus grand béné
lice possible : or ce bénéfice ne pouvoit avoir lieu qu’en donnant un cours forcé
aux monnoies, ou en fixant leur valeur nominale bien au-dessus de leur valeur
intrinsèque. C ’est dans le même but qu’ils ont ordonné souvent la démonétisation
norj-seulement de toutes les espèces étrangères qui s’étoient introduites à diverses
époques dans la circulation, mais encore des monnoies de leurs prédécesseurs,*
et leur* versement à la monnoie, où elles n’étoient reçues au plus que pour leur
valeur intrinsèque et où elles étoient converties en nouvelle monnoie d’un plus
bas aloi.
Cependant, comme il arrive nécessairement, malgré l’ignorance du peuple,
d’une part, et malgré le pouvoir du Gouvernement, de l’autre, que le niveau
entre la valeur nominale des monnoies et leur valeur intrinsèque tend sans cesse
à se rétablir plus ou moins vite et plus ou moins exactement, aucun moyen
coercitif ne pouvoit empêcher qu’à la longue, lorsque l’altération du poids et
du titre des espèces devenoit trop sensible, et sur-tout lorsqu’on mettoit en
émission une trop grande quantité de monnoies de bas aloi, le prix des denrées,
celui de l’or et de l’argent en lingot et par suite celui de fo r même monnoyé, s’il
avoit subi moins d’altération, n’augmentassent successivement. Le Gouvernement
finissoit alors par être forcé à changer lui-même la valeur nominale de la monnoie
d’or (1); et, pour continuer à faire des bénéfices sur la fabrication, il bais-
soit encore le titre des monnoies, et exigeoit qu’on les prît d après la nouvelle
fixation de leur valeur nominale, comme si elles eussent conservé la même valeur
intrinsèque qu’auparavant.
Voici maintenant ce qui empêchoit que le niveau ne s’établît rigoureusement
entre la valeur nominale et la valeur intrinsèque des médins; c’est que la quantité
de cette monnoie, qui servoit à-la-fois aux achats en gros et en détail dans toute 1 Egypte et même avec les pays voisins, n’étoit pas assez abondante pour les
besoins du commerce : ce qui lui donnoit une valeur fictive assez considérable,
comme moyen d’échange; valeur qu’elle eût continué à conserver en partie,
lors même que la connoissance de son bas aloi eût été généralement répandue.
On peut voir dans Maqryzy les principales variations qu’éprouva la valeur
nominale des monnoies dans les sept premiers siècles de l’hégire. Nous nous
(0 Voyez ce que nous avons dit de la pataque, pag. 343, alin. 1." et süiv.