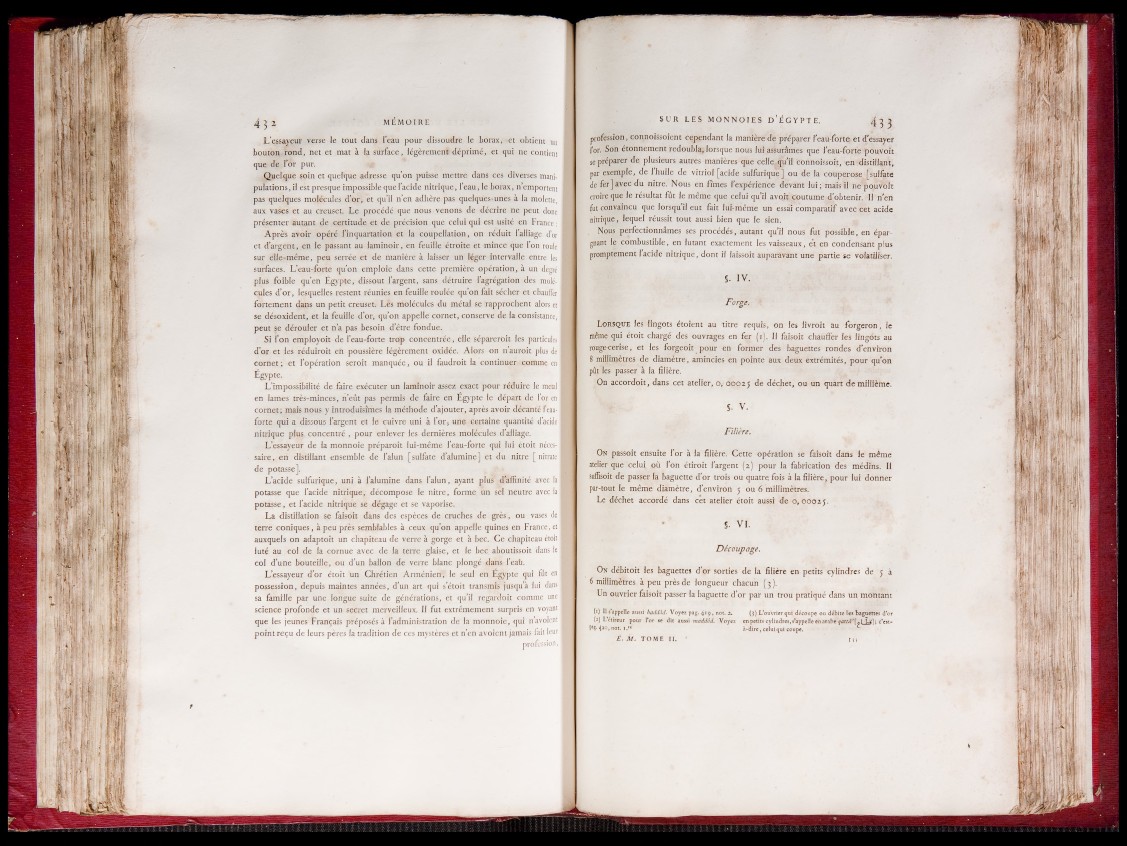
L ’essayeur verse le tout dans l’eau pour dissoudre le borax, et obtient un
bouton rond, net et mat à la surface, légèrement déprimé, et qui ne contient
que de l’or pur.
Quelque soin et quelque adresse qu’on puisse mettre dans ces diverses manipulations,
il est presque impossible que l’acide nitrique, l’eau, le borax, n’emportent
pas quelques molécules d’or, et qu’il n’en adhère pas quelques-unes à la molette,
aux vases et au creuset. Le procédé que nous venons de décrire ne peut donc
présenter autant de certitude et de précision que celui qui est usité en France :
Après avoir opéré ]%iquartation et la coupellation, on réduit l’alliage d’or
et d’argent, en le passant au laminoir, en feuille étroite et mince que l’on roule
sur elle-même, peu serrée et de manière à laisser un léger intervalle entre les
surfaces. L ’eau-forte qu’on emploie dans cette première opération, à un degrc I
plus foible qu’en Egypte, dissout l’argent, sans détruire l’agrégation des molé- I
cules d’or, lesquelles restent réunies en feuille roulée qu’on fait sécher et chauffer I
fortement dans un petit creuset. Lés molécules du métal se rapprochent alors et I
se désoxident, et la feuille d’or, qu’on appelle cornet, conserve de la consistance, I
peut se dérouler et n’a pas besoin d’être fondue.
Si fon employoit de l’eau-forte trop concentrée, elle sépareroit les particules I
d’or et les réduiroit eh poussière légèrement oxidée. Alors on n’auroit plus de I
cornet ; et l’opération seroit manquée, ou il faudroit la continuer comme en I
Egypte.
L ’impossibilité de faire exécuter un laminoir assez exact pour réduire le métal I
en lames très-minces, n’eût pas permis de faire en Egypte le départ de l’or en I
cornet; mais nous y introduisîmes la méthode d’ajouter, après avoir décanté l’eau-1
forte qui a dissous l’argent et le cuivre uni à l’or, une certaine quantité d’acide I
nitrique plus concentré , pour enlever les dernières molécules d’alliage.
L ’essayeur de la monnoie préparoit lui-même l’eau-forte qui lui étoit néces- I
saire, en distillant ensemble de l’alun [sulfate d’alumine] et du nitre [nitratel
de potasse].
L ’acide sulfurique, uni à l’alumine dans l’alun, ayant plus d’àffinité avec lai
potasse que l’acide nitrique, décompose le nitre, forme un sel neutre avec la I
potasse, et l’acide nitrique se dégage et se vaporise.
La distillation se faisoit dans des espèces de cruches de grès, ou vases de I
terre coniques, à peu près semblables à ceux qu’on appelle quines en F ran ce, et I
auxquels on adaptoit un chapiteau de verre à gorge et à bec. Ce chapiteau étoit I
iuté au col de la cornue avec de la terre glaise, et le bec aboutissoit dans le I
col d’une bouteille, ou d’un ballon de verre blanc plongé dans l’eau.
L ’essayeur d’or étoit un Chrétien Arménien, le seul en Egypte qui fût en I
possession, depuis maintes années, d’un art qui s’étoit transmis jusqu’à lui dans I
sa famille par une longue suite de générations, et qu’il regardoit comme une I
science profonde et un secret merveilleux. Il fut extrêmement surpris en voyant
que les jeunes Français préposés à l’administration de la monnoie, qui navoient
point reçu de leurs pères la tradition de ces mystères et n’en avoient jamais fait leur
profession, I
profession, connoissoient cependant la manière de préparer l’eau-forte et d’essayer
for. Son etonnement redoubla, lorsque nous lui assurâmes que l’eau-forte pouvoit
se préparer de plusieurs autres manières que celle qu’il connoissoit, en distillant,
par exemple, de 1 huile de vitriol [acide sulfurique] ou de la couperose, [sulfate
de fer] avec du nitre. Nous en fîmes l'expérience devant lui ; mais il ne pouvoit
croire que le résultat fût le même que celui qu’il avoit coutume d’obtenir. Il n'en
fut convaincu que lorsqu il eut fait lui-même un essai comparatif avec cet acide
nitrique, lequel réussit tout aussi bien que le sien.
, Nous perfectionnâmes ses procédés, autant qu'il nous fut possible, en épargnant
le combustible, en lutant exactement les vaisseaux, e’t en condensant plus
promptement 1 acide nitrique, dont il laissoit auparavant une partie se volatiliser.
§. IV.
Forge.
Lor squ e les lingots éto ien t au titre requis, on les iiv ro it au fo r g e ro n , le
même qui é to it chargé des ouvrages en fe r (i). Il faisoit chauffer les lingots au
rouge-cerise, e t les fo rg eo it p o u r en forme r des baguettes rondes d ’environ
8 millimètres d e d iamètre, amincies en po in te aux deux extrémités, p ou r qu’on
pût les passer à la filière.
On accordoit, dans cet atelier, o, 00025 de déchet, ou un quart de millième.
S- v.
Filière.
On passoit ensuite l’or à la filière. Cette opération se faisoit dans le même
atelier que celui où l’on étiroit l’argent (2) pour la fabrication des médins. Il
suffisoit de passer la baguette d’or trois ou quatre fois à la filière, pour lui donner
par-tout le même diamètre, d’environ 5 ou 6 millimètres.
Le déchet accordé dans cet atelier étoit aussi de 0,00025.
S- VI.
Découpage.
On débitoit les baguettes d’or sorties de la filière en petits cylindres de 5 à
6 millimètres à peu près de longueur chacun ( 3 ).
Un ouvrier faisoit passer la baguette d’or par un trou pratiqué dans un montant
(1) II s appelle aussi haddâd. Voyez pag. 419, not. 2. (3) L’ouvrier qui découpe ou débite les baguettes d’or
(z)Létireur pour l'or se dit aussi maddâd. Voyez en petits cylindres.s'appelle en arabe uartd’ f - l L«1 ; c’est-
pag. 420, not. i . re aï-dire, celui qui coupe.
il M. TOME II. ' r i »