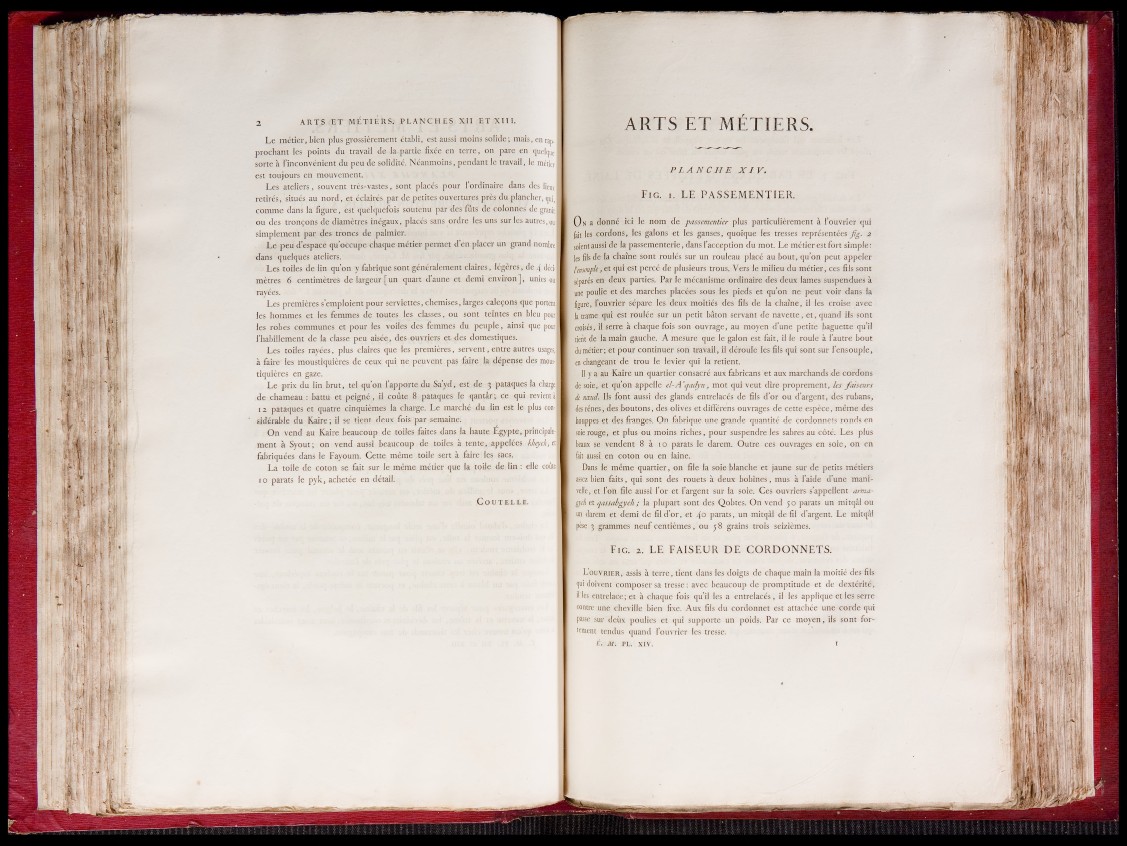
Le métier, bien plus grossièrement établi, est aussi moins solide; mais, enrap.I
prochant les points du travail de la partie fixée en terre, on pare en q u e lq u e I
sorte à l’inconvénient du peu de solidité. Néanmoins, pendant le travail, le m étierI
est toujours en mouvement.
Les ateliers, souvent très-vastes, sont placés pour l’ordinaire dans des lieuxI
retirés, situés au nord, et éclairés par de petites ouvertures près du plancher,qui,I
comme dans la figure, est quelquefois soutenu par des fûts de colonnes de granit!
ou des tronçons de diamètres inégaux, placés sans ordre les uns sur les autres, oui
simplement par des troncs de palmier.
L e peu d’espace qu’occupe chaque métier permet d’en placer un grand nombre I
dans quelques ateliers.
Les toiles de lin qu’on y fabrique sont généralement claires, légères, de 4 dcci-jj
mètres 6 centimètres de largeur [un quart d’aune et demi environ], unies oui
rayées.
Les premières s’emploient pour serviettes, chemises, larges caleçons que portent!
les hommes et les femmes de toutes les classes, ou sont teintes en bleu pourI
les robes communes et pour les voiles des femmes du peuple, ainsi que pourl
l’habillement de la classe peu aisée, des ouvriers et des domestiques.
Les toiles rayées, plus claires que les premières, servent, entre autres usages,I
à faire les moustiquières de ceux qui ne peuvent pas faire la dépense des mous-l
tiquières en gaze.
Le prix du lin brut, tel qu’on l’apporte du Sa’yd, est de 3 pataquès la charge!
de chameau : battu et peigné, il coûte 8 pataquès le qantâr; ce qui revient i l
12 pataquès et quatre cinquièmes la charge. Le marché du lin est le plus con-l
sidërable du Kaire ; il se tient deux fois par semaine.
On vend au Kaire beaucoup de toiles faites dans la haute Egypte, principale-l
ment à Syout; on vend aussi beaucoup de toiles à tente, appelées khtych, etl
fabriquées dans le Fayoum. Cette même toile sert à faire les sacs.
La toile de coton se fait sur le même métier que la toile de lin : elle coûte!
10 parats le pyk, achetée en détail.
C o u t e l l e .
P L A N C H E X I V .
Fig. 1. LE PASSEMENTIER.
On a donné ici le nom de passementier plus particulièrement à l’ouvrier qui
fait les cordons, les galons et les ganses, quoique les tresses représentées 2
soient aussi de la passementerie, dans l’acception du mot. Le métier est fort simple :
les fils de la chaîne sont roulés sur un rouleau placé au bout, qu’on peut appeler
l'tnsouplc, et qui est percé de plusieurs trous. Vers le milieu du métier, ces fils sont
séparés en deux parties. Par le mécanisme ordinaire des deux lames suspendues à
une poulie et des marches placées sous les pieds et qu’on ne peut voir dans la
ligure, l’ouvrier sépare les deux moitiés des fils de la chaîne, il les croise avec
la trame qui est roulée sur un petit bâton servant de navette, et, quand ils sont
croisés, il serre à chaque fois son ouvrage, au moyen d’une petite baguette qu’il
tient de la main gauche. A mesure que le galon est fait, il le roule à l’autre bout
du métier; et pour continuer son travail, il déroule les fils qui sont sur l’ensouple,
en changeant de trou le levier qui la retient. 11 y a au Kaire un quartier consacré aux fabricans et aux marchands de cordons
de soie, et qu’on appelle cl-A ’qaclyn, mot qui veut dire proprement, les faiseurs
dt noeud. Us font aussi des glands entrelacés de fils d’or ou d’argent, des rubans,
des rênes, des boutons, des olives et différens ouvrages de cette espèce, même des
houppes et des franges. On fabrique une grande quantité de cordonnets ronds en
soie rouge, et plus ou moins riches, pour suspendre les sabres au côté. Les plus
beaux se vendent 8 à 10 parats le darem. Outre ces ouvrages en soie, on en
fait aussi en coton ou en laine.
Dans le même quartier, on file la soie blanche et jaune sur de petits métiers
assez bien faits, qui sont des rouets à deux bobines, mus à l’aide d’une manivelle,
et l’on file aussi l’or et l’argent sur la soie. Ces ouvriers s’appellent arma-
gcli et qassabgyeli ; la plupart sont des Qobtes. On vend 50 parats un mitqâl ou
un darem et demi de fil d’or, et 4° parats, un mitqâl de fil d’argent. Le mitqâl
pèse 3 grammes neuf centièmes, ou y 8 grains trois seizièmes.
Fig. 2. LE FAISEUR DE CORDONNETS.
L ’o u v r i e r , assis à terre, tient dans les doigts de chaque main la moitié des fils
qui doivent composer sa tresse: avec beaucoup de promptitude et de dextérité,
il les entrelace; et à chaque fois qu’il les a entrelacés, il les applique et les serre
contre une cheville bien fixe. Aux fils du cordonnet est attachée une corde qui
passe sur deitx poulies et qui supporte un poids. Par ce moyen, ils sont fortement
tendus quand l’ouvrier les tresse.
É. M. P L . X IV . I