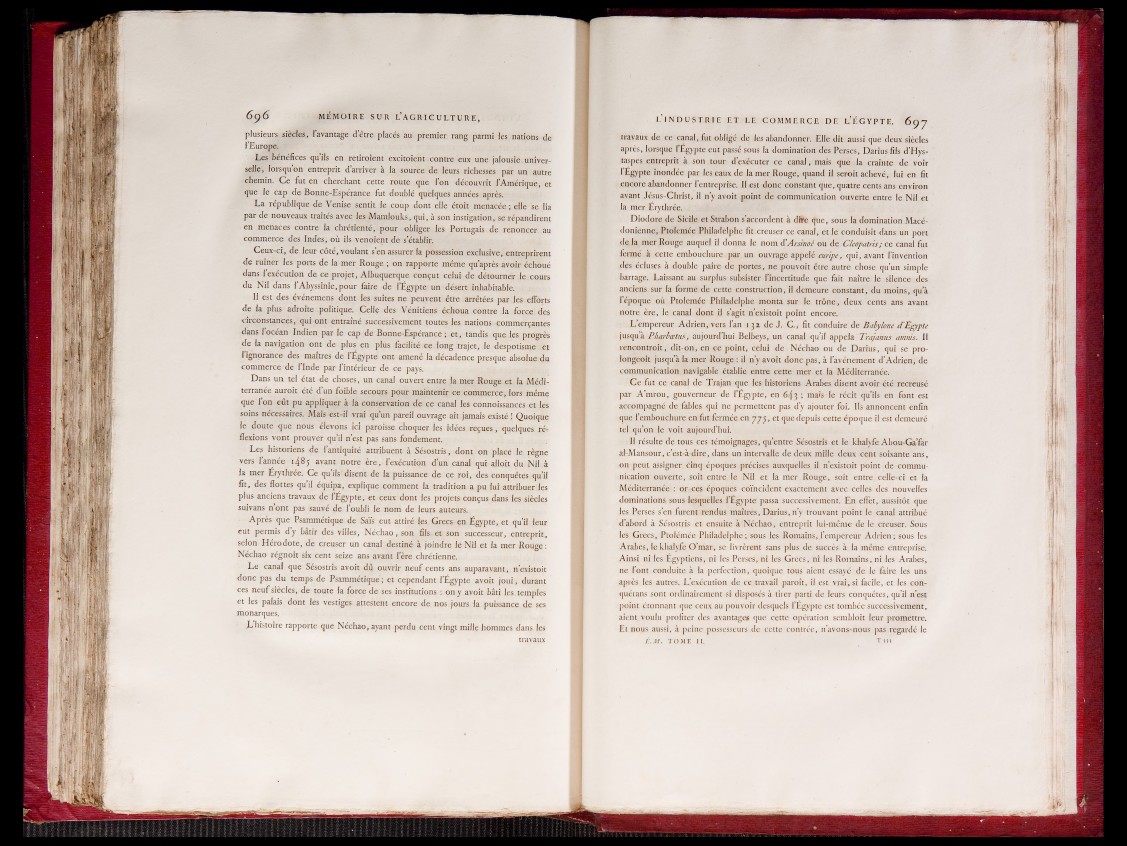
plusieurs siècles, 1 avantage detre placés au premier rang parmi les nations de
l’Europe.
Les bénéfices qu’ils en retiroient excitoient contre eux une jalousie universelle,
lorsqu on entreprit d arriver à la source de leurs richesses par un autre
chemin. Ce fut en cherchant cette route que l’on découvrit l’Amérique, et
que le cap de Bonne-Espérance fut doublé quelques années après.
La république de Venise sentit le coup dont elle étoit menacée ; elle se lia
par de nouveaux traites avec les Mamlouks, qui, à son instigation, se répandirent
en menaces contre la chrétienté, pour obliger les Portugais de renoncer au
commerce des Indes, où ils venoient de s'établir.
Ceux-ci, de leur côté, voulant s’en assurer la possession exclusive, entreprirent
de ruiner les ports de la mer Rouge ; on rapporte même qu’après avoir échoué
dans 1 exécution de ce projet, Albuquerque conçut celui de détourner le cours
du Nil dans 1 Abyssinie, pour faire de l'Egypte un désert inhabitable.
Il est des événemens dont les suites ne peuvent être arrêtées par les efforts
de la plus adroite politique. Celle des Vénitiens échoua contre la force des
circonstances, qui ont entraîné successivement toutes les nations commerçantes
dans 1 océan Indien par le cap de Bonne-Espérance ; et, tandis que les progrès
de la navigation ont de plus en plus facilité ce long trajet, le despotisme et
l’ignorance des maîtres de l’Égypte ont amené la décadence presque absolue du
commerce de l’Inde par l’intérieur de ce pays.
Dans un tel état de choses, un canal ouvert entre la mer Rouge et la Méditerranée
auroit été d’un foible secours pour maintenir ce commerce, lors même
que l’on eût pu appliquer à la conservation de ce canal les connoissances et les
soins nécessaires. Mais est-il vrai qu’un pareil ouvrage ait jamais existé .' Quoique
le doute que nous devons ici paroisse choquer les idées reçues, quelques, réflexions
vont prouver qu’il n’est pas sans fondement.
Le? historiens de l’antiquité attribuent à Sésostris, dont on place le règne
vers 1 année 14 85 avant notre ère, l’exécution d’un canal qui alloit du Nil à
la mer Erythrée. Ce qu’ils'disent de la puissance de ce roi, des conquêtes qu’il
fit, des flottes qu’il équipa, explique comment la tradition a pu lui attribuer les
plus anciens travaux de l’Égypte, et ceux dont les projets conçus dans les siècles
suivans n ont pas sauvé de l’oubli le nom de leurs auteurs.
Après que Psammétique de Sais eut attiré les Grecs en Egypte, et qu’il leur
eut permis d y bâtir des villes, Néchao, son fils et son successeur, entreprit,
selon Hérodote, de creuser un canal destiné à joindre lé Nil et la mer Rouge :
Néchao régnoit six cent seize ans avant l’ère chrétienne.
Le canal que Sésostris avoit dû ouvrir neuf cents ans auparavant, n’existoit
donc pas du temps de Psammétique ; et cependant l’Égypte avoit joui, durant
ces neuf siècles, de toute la force de ses institutions : on y avoit bâti les temples
et les palais dont les vestiges attestent encore de nos jours la puissance de ses
monarques.
E histoire rapporte que Néchao, ayant perdu cent vingt mille hommes dans les
travaux
travaux de ce canal, fut obligé de les abandonner. Elle dit aussi que deux siècles
après, lorsque l’Egypte eut passé sous la domination des Perses, Darius fils d’Hys-
taspes entreprit à son tour d’exécuter ce canal, mais que la crainte de voir
■ Egypte inondée par les eaux de la mer Rouge, quand il seroit achevé, lui en fit
encore abandonner l’entreprise. Il est donc constant que, quatre cents ans environ
avant Jésus-Christ, il n’y avoit point de communication ouverte entre le Nil et
la mer Erythrée.
Diodore de Sicile et Strabon s’accordent à dite que, sous la domination Macédonienne,
Ptolemée Philadelphe fit creuser ce canal, et le conduisit dans un port
de la mer Rouge auquel il donna le nom d’Arsmoé ou de Cleopatris; ce canal fut
fermé a cette embouchure par un ouvrage appelé euripe, qui, avant 1 invention
des écluses à double paire de portes, ne pouvoit être autre chose qu’un simple
barrage. Laissant au surplus subsister l’incertitude que fait naître le silence des
anciens sur la forme de cette construction, il demeure constant, du moins, qu’à
l’époque où Ptolemée Philadelphe monta sur le trône, deux cents ans avant
notre ère, le canal dont il s’agit n’existoit point encore.
L ’empereur Adrien, vers l’an 132 de J. C., fit conduire de Bnlylone d ’Egypte
jusqua Pharboetus, aujourd’hui Belbeys, un canal qu’il appela Tni)anus munis. Il
rencontroit, dit-on, en ce point, celui de Néchao ou de Darius, qui se pro-
longeoit jusqu’à la mer Rouge : il n’y avoit donc pas, à l’avénement d’Adrien, de
communication navigable établie entre cette mer et la Méditerranée.
C e fut ce canal de Trajan que les historiens Arabes disent avoir été recreusé
par A ’mrou, gouverneur de l’Égypte, en 643 ; mais le récit qu’ils en font est
accompagné de fables qui ne permettent pas d’y ajouter foi. Ils annoncent enfin
que l’embouchure en fi.it fermée en 773, et que depuis cette époque il est demeuré
tel qu’on le voit aujourd’hui.
Il résulte de tous ces témoignages, qu’entre Sésostris et le khalyfe Abou-Ga’far
al-Mansour, c’est-à-dire, dans un intervalle de deux mille deux cent soixante ans,
on peut assigner cinq époques précises auxquelles il n’existoit point de communication
ouverte, soit entre le Nil et la mer Rouge, soit entre celle-ci et la
Méditerranée : or ces époques coïncident exactement avec celles des nouvelles
dominations sous lesquelles l’Égypte' passa successivement. En effet, aussitôt que
les Perses s’en furent rendus maîtres, Darius, n’y trouvant point le canal attribué
d’abord à Sésostris et ensuite à Néchao, entreprit lui-même de le creuser. Sous
les Grecs, Ptolémée Philadelphe; sous les Romains, l’empereur Adrien; sous les
Arabes, le khalyfe O ’mar, se livrèrent sans plus de succès à la même entreprise.
Ainsi ni les Égyptiens, ni les Perses, ni les Grecs, ni les Romains, ni les Arabes,
ne l’ont conduite à la perfection, quoique tous aient essayé de le faire les uns
après les autres. L ’exécution de ce travail paroît, il est vrai, si facile, et les con-
quérans sont ordinairement si disposés à tirer parti de leurs conquêtes, qu’il n’est
point étonnant que ceux au pouvoir desquels l’Egypte est tombée successivement,
aient voulu profiter des avantages que cette opération sembloit leur promettre.
Et nous aussi, à peine possesseurs de cette contrée, n’avons-nous pas regardé le