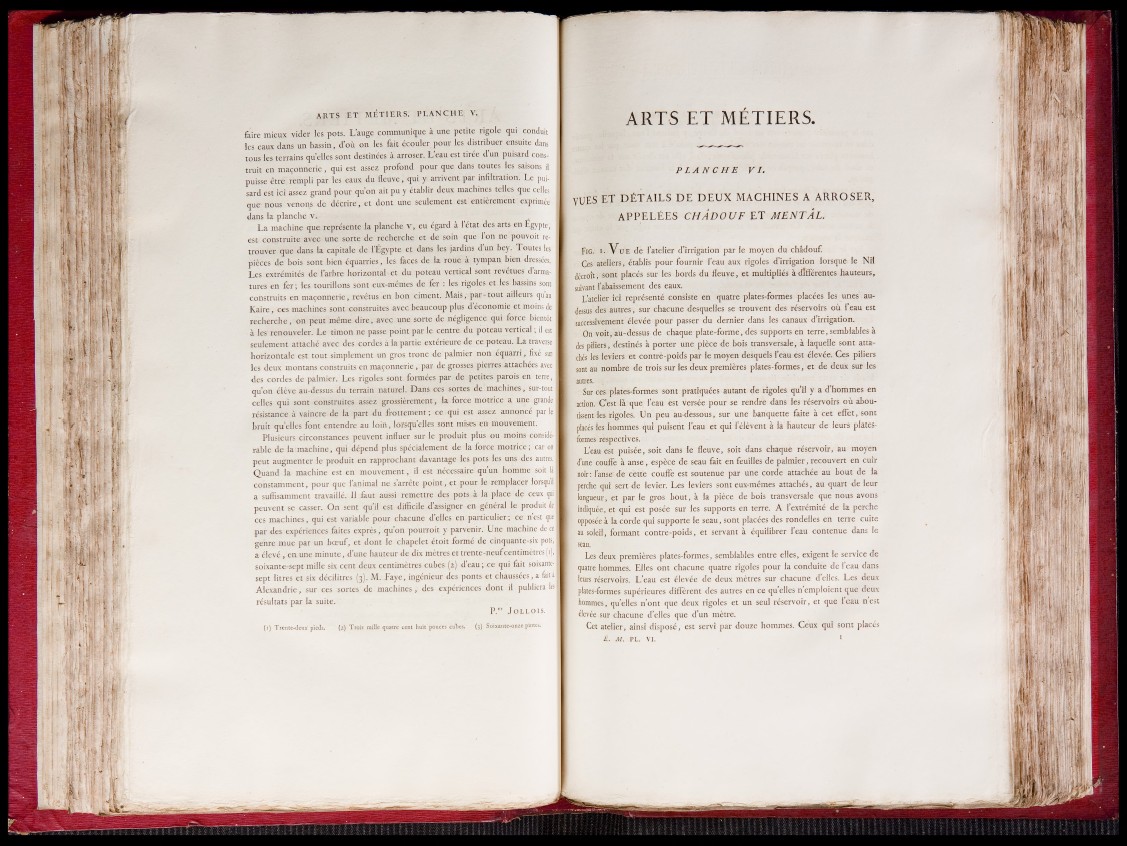
¿ ire mieux vider les pots. L ’auge communique à une petite rigole qui conduit
les eaux dans un bassin, d’où on les fait écouler pour les distribuer ensuite dans
tous les terrains qu’elles sont destinées à arroser. L ’eau est tirée d’un puisard construit
en maçonnerie, qui est assez profond pour que dans toutes les saisons il I
puisse être rempli par les eaux du fleuve, qui y arrivent par infiltration. Le puisard
est ici assez grand pour qu’on ait pu y établir deux machines telles que celles I
que-nous venons de décrire, et dont une seulement est'entièrement exprimée
dans la planche v.
La machine que représente la planche V , eu égard a 1 état des arts en Egypte, 1
est construite avec une sorte de recherche et de soin que Ion ne pouvoit re- I
trouver que dans la capitale de l’Egypte et dans les jardins d un hey. Toutes les I
pièces de bois sont bien équarries, les faces de la roue a tympan bien dressces. I
Les extrémités de l’arbre horizontal - et du poteau vertical sont revetues darma- I
tures en fer ; les tourillons sont eux-mêmes de fer : les rigoles et les bassins sont I
construits en maçonnerie, revêtus en bon ciment. Mais, par-tout ailleurs qu au I
Kaire, ces machines sont construites avec beaucoup plus d économie et moins de I
recherche, on peut même dire, avec une sorte de négligence qui force bientôt I
à les renouveler. Le timon ne passe point par le centre du poteau vertical, il est I
seulement attaché avec des cordes à la partie extérieure de ce poteau. La traverse I
horizontale est tout simplement un gros tronc de palmier non equarri, fixé sur I
les deux montans construits en maçonnerie, par de grosses pierres attachées avec I
des cordes de palmier. Les rigoles sont formées par de petites parois en terre, I
qu’on élève au-dessus du terrain naturel. Dans ces sortes de machines, sur-tout I
celles qui sont construites assez grossièrement, la force motrice a une grande I
résistance à vaincre de la part du frottement ; ce qui est assez annonce par le I
bruit qu’elles font entendre au loin, lorsqu’elles sont mises en mouvement.
Plusieurs circonstances peuvent influer sur le produit plus ou moins considé-1
rahle de la machine, qui dépend plus spécialement de la force motrice; car oui
peut augmenter le produit en rapprochant davantage les pots les uns des autres. I
Quand la machine est en mouvement, il est nécessaire quun homme soit làI
constamment, pour que l’animal ne s arrête point, et pour le remplacer loi squ il j
a suffisamment travaillé. 11 faut aussi remettre des pots a la place de ceux qui!
peuvent se casser. On sent qu’il est difficile d’assigner en général le produit de I
ces machines, qui est variable pour chacune d’elles en particulier; ce n’est quel
par des expériences faites exprès, qu’on pourroit y parvenir. Une machine de ceI
genre mue par un boeuf, et dont le chapelet était formé de cinquante-six pots, I
a élevé, en. une minute, d’une hauteur de dix mètres et trente-neuf centimètres (i), I
soixante-sept mille six cent deux centimètres cubes (2) d eau ; ce qui fait soixante-1
sept litres et six décilitres (3). M. Faye, ingénieur des ponts et chaussées, a fait il
Alexandrie, sur ces sortes de machines, des expériences dont il publiera les j
résultats par la suite.
P." J o l l o i s .
(j) Trente-deux' pieds. (2) Trois mille quatre cent huit pouces cubes. (3) Soixante-onze pintes.
P L A N C H E Vf .
VUES ET DÉTAILS DE DEUX MACHINES A ARROSER,
APPELÉES CHÂ D O U F ET MENTAL.
F i g . 1 . V u e d e l ’ a t e l i e r d ’ i r r i g a t i o n p a r l e m o y e n d u c h â d o u f .
Ces ateliers, établis pour fournir l’eau aux rigoles d’irrigation lorsque le Nil
décroît, sont placés sur les bords du fleuve, et multipliés à différentes hauteurs,
suivant l’abaissement des eaux.
L ’ a t e l i e r i c i r e p r é s e n t é c o n s i s t e e n q u a t r e p l a t e s - f o r m e s p l a c é e s l e s u n e s a u -
dessus d e s a u t r e s , s u r c h a c u n e d e s q u e l l e s s e t r o u v e n t d e s r é s e r v o i r s o ù l ’ e a u e s t
s u c c e s s i v e m e n t é l e v é e p o u r p a s s e r d u d e r n i e r d a n s l e s c a n a u x d ’ i r r i g a t i o n .
On voit, au-dessus de chaque plate-forme, des supports en terre, semblables à
des piliers, destinés à porter une pièce de bois transversale, à laquelle sont attachés
les leviers et contrè-poids par le moyen desquels l’eau est élevée. Ces piliers
sont au nombre de trois sur les deux premières plates-formes, et de deux sur les
autres.
Sur ces plates-formes sont pratiquées autant de rigoles qu’il y a d hommes en
action. C’est là que l’eau est versée pour se rendre dans les réservoirs où aboutissent
les rigoles. Un peu au-dessous, sur une banquette faite à cet effet, sont
placés les hommes qui puisent l’eau et qui i’élèvent à la hauteur de leurs plates-
formes respectives.
L’eau est puisée, soit dans le fleuve, soit dans chaque réservoir, au moyen
d’une couffe à anse, espèce de seau fait en feuilles de palmier, recouvert en cuir
noir : l’anse de cette couffe est soutenue par une corde attachée au bout de la
perche qui sert de levier. Les leviers sont eux-mêmes attachés, au quart de leur
longueur, et par le gros bout, à la pièce de bois transversale que nous avons
indiquée, et qui est posée sur les supports en terre. A 1 extrémité de la perche
opposée à la corde qui supporte le seau, sont placées des rondelles en terre cuite
au soleil, formant contre-poids, et servant à équilibrer leau contenue dans le
seau.
Les deux premières plates-formes, semblables entre elles, exigent le service de
quatre hommes. Elles ont chacune quatre rigoles pour la conduite de I eau dans
leurs réservoirs. L ’eau est élevée de deux mètres sur chacune d’elles. Les deux
plates-formes supérieures diffèrent des autres en ce qu’elles n emploient que deux
hommes, quelles n’ont que deux rigoles et un seul réservoir, et que leau nest
élevée sur chacune d’elles que d’un mètre.
Cet atelier, ainsi disposé, est servi par douze hommes. Ceux qui sont placés
Ê . M . P L . VI. |