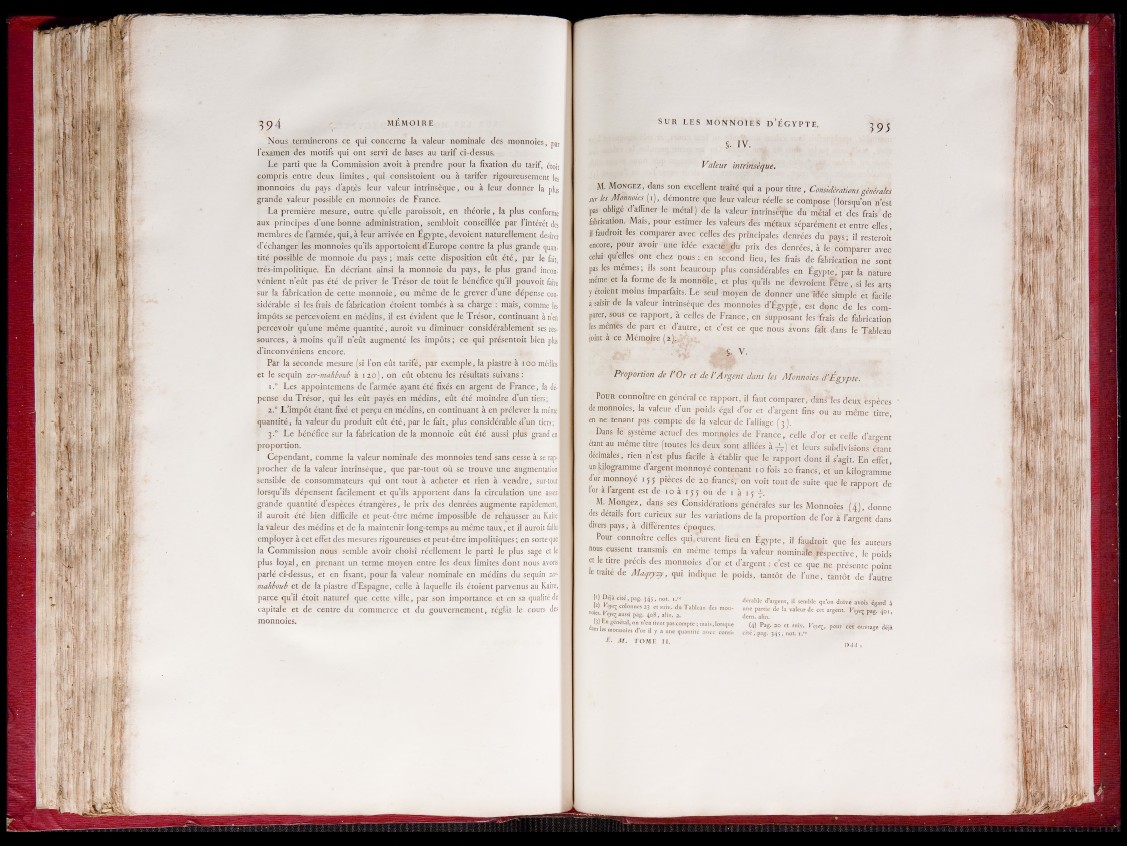
3 9 4 ' M É M O I R E
Nous terminerons ce qui concerne la valeur nominale des monnoies, par
l’examen des motifs qui ont servi de bases au tarif ci-dessus.
Le parti que la Commission avoit à prendre pour la fixation du tarif, étoit I
compris entre deux limites, qui consistoient ou à tarifer rigoureusement les j
monnoies du pays d’apnès leur valeur intrinsèque, ou à leur donner la plus
grande valeur possible en monnoies de France.
La première mesure, outre qu’elle paroissoit, en théorie, la plus conforme I
aux principes d’une bonne administration, sembloit conseillée par l’intérêt des I
membres de l’armée, qui, à leur arrivée en Egypte, dévoient naturellement desirer I
d’échanger les monnoies qu’ils apportoient d’Europe contre la plus grande quan-1
tité possible de monnoie du pays ; mais cette disposition eût é té, par le fait I
très-impolitique. En décriant ainsi la monnoie du pays, le plus grand incon-1
vénient n’eût pas été de priver le Trésor de tout le bénéfice qu’il pouvoit faire I
sur la fabrication de cette monnoie, ou même de le grever d’une dépense con-1
sidérable si les frais de fabrication étoient tombés à sa charge : mais, comme les I
impôts se percevoient en médins, il est évident que le Trésor, continuant à n’en I
percevoir qu’une même quantité, auroit vu diminuer considérablement ses res-1
sources, à moins qu’il n’eût augmenté les impôts ; ce qui présentoit bien plus I
d’inconvéniens encore.
Par la seconde mesure (si l’on eût tarifé, par exemple, la piastre à 100 médinsI
et le sequin zer-mahboub à 120), on eût obtenu les résultats suivans :
1.° Les appointemens de farinée ayant été fixés en argent de France, la dé-l
pense du Trésor, qui les eût payés en médins, eût été moindre d’un tiers;
2.° L ’impôt étant fixé et perçu en médins, en continuant à en prélever la même I
quantité, la valeur du produit eût été, par le fait, plus considérable d’un tiers; I
3.0 Le bénéfice sur la fabrication de la monnoie eût été aussi plus grand enl
proportion.
Cependant, comme la valeur nominale des monnoies tend sans cesse à se rapprocher
de la valeur intrinsèque, que par-tout où se trouve une augmentationI
sensible de consommateurs qui ont tout à acheter et rien à vendre, sur-toutI
lorsquils dépensent facilement et qu’ils apportent dans la circulation une assez I
grande quantité d’espèces étrangères, le prix des denrées augmente rapidement,!
il auroit été bien difficile et peut-être même impossible de rehausser au K a ir e l
la valeur des médins et de la maintenir long-temps au même taux, et il auroit falluI
employer à cet effet des mesures rigoureuses et peut-être impolitiques ; en sorte quel
la Commission nous semble avoir choisi réellement le parti le plus sage et le ■
plus loyal, en prenant un terme moyen entre les deux limites dont nous avons!
parlé ci-dessus, et en fixant, pour la valeur nominale en médins du sequin zer-1
mahboub et de la piastre d’Espagne, celle à laquelle ils étoient parvenus au Kaire,
parce qu’il étoit naturel que cette ville, par son importance et en sa qualité (le I
capitale et de. centre du commerce et du gouvernement, réglât le cours des!
monnoies.
S U R L E S M Ô N N O Î E S d ’ É G Y P T E . 5 r > f i y )
Valeur intrinsèque.
M . M o n g e z , dans son excellent traité qui a pour titre, Considérations générales
sur les Monnoies (1), démontre que leur valeur réelle se compose (lorsqu’on n’est
pas obligé d affiner le métal ) de la valeur intrinsèque du métal et des frais de
fabrication. Mais, pour estimer les valeurs des métaux séparément et entre elles
il faudroit les comparer avec celles des principales denrées du pays; il resterait
encore, pour avoir une idée exacte* du prix des denrées, à le comparer avec
celui qu’elles ont chez nous : en second lieu, les frais de fabrication ne sont
pas les mêmes; ils sont beaucoup plus considérables en Egypte, par la nature
même et la forme de la monnoie, et plus qu’ils ne devraient î’être. si les arts
y étoient moins imparfaits. Le seul moyen de donner une ‘idée simple et facile
à saisir de la valeur intrinsèque des monnoies d’Egypte, est donc de les comparer,
sous ce rapport, à celles de France, en supposant les •frais de fabrication
les menfès de part et d’autre, et c’est ce que nous avons fait dans le Tableau
joint à ce Mémoire (2).,
A k v '
Proportion de l ’ Or et de l ’Argent dans les Monnoies d'Égypte.
P o u r connoître en général ce rapport, il faut comparer, dansées deux espèces '
de monnoies, la valeur d’un poids égal d’or et d’argent fins ou au même titre,
en ne tenant pas compte de la valeur de l’alliage (3 ).
Dans le système actuel des monnaies de France, celle d’or et celle d’argent
était au même titre (toutes lès deux sont alliées à j& f et leurs subdivisions étant
décimales, rien nest plus facile à établir que le rapport dont il s’agit. En effet,
un kilogramme d’argent monnoyé contenant 1 o fois 20 francs, et un kilogramme”
d or monnoyé 1 55 pièces de 20 francs? on voit tout de suite que le rapport de
l’or à l’argent est de 10 à i 55 ou de 1 à 1 5 4.
M. Mongez, dans ses Considérations générales sur les Monnoies (4 ), donne
des détails fort curieux sur les variations de la proportion de l’or à l’argent dans
divers pays, a différentes époques.
Pour connoître celles qui* eurent lieu en Egypte, il faudroit que les auteurs
nous eussent transmis en même temps la valeur nominale respective, le poids
et le utre précis des monnoies d’or et d’argent : c’est ce que ne présente point
le traité de Maqryzy, qui indique le poids, tantôt de l’une, tantôt de l’autre
colonnes 23 et suiv. du Tableau des mon- une partie de la valeur de cet argent. m 3 pag 4 0 ,,
! | c' Ia’ 3dS> Mot* '• dérable d’argent, il semble qu’on doive avois égard à
ma. V,n aussi pag. 408, alin. 2. dern. alin. 4
W & n ir'• ' T V'l " ent pasCOn’P" : maiS’ Iors1,,e M) PaS- a° « ” iv- ponr cet ouvrage déjà
“ “ annotes d or il y a une quantité assez consi- cité ; pag. 345, not. 1 ."
ü M . T O M E II.
L/ d d a