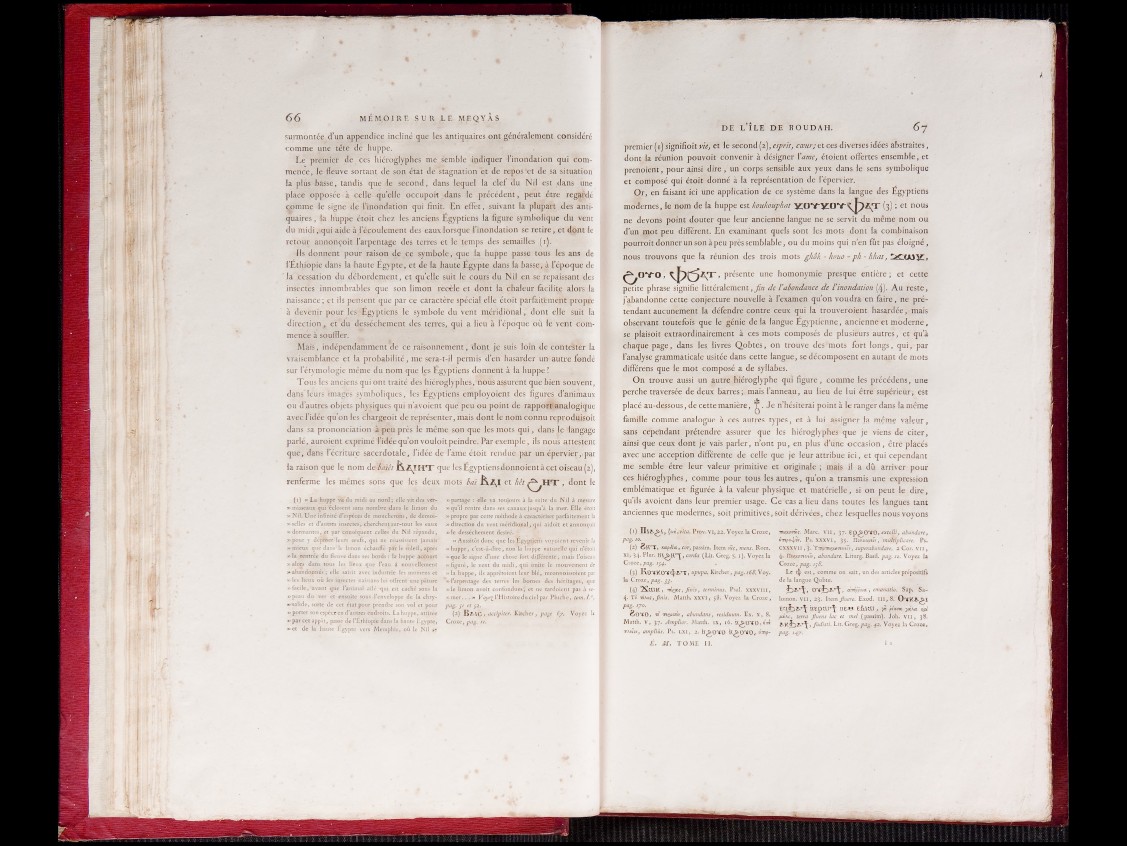
surmontée d’un appendice incliné que les antiquaires ont généralement considéré
comme une tête de huppe.
Le premier de ces hiéroglyphes me semble indiquer l’inondation qui commence,
le fleuve sortant de son état de stagnation et de repos *et de sa situation
la plus basse, tandis que le second, dans lequel la clef du Nil est dans une
place opposée à celle qu’elle occupoit dans le précédent, peut être regardé
comme le signe de l’inondation qui finit. En effet, suivant la plupart des antiquaires
, la huppe étoit chez les anciens Égyptiens la figure symbolique du vent
du midi ,.qui aide à l’écoulement des eaux lorsque l’inondation se retire, et dont île
retour annonçoit l’arpentage des terres et le temps des semailles (i).
Ils donnent pour raison de ce symbole, que la huppe passe tous les ans de
l’Éthiopie dans la haute Egypte, et de la haute Egypte dans la hasse, à l’époque de
' la cessation du débordement, et qu’elle suit le cours du Nil en se repaissant des
insectes innombrables que son limon recèle et dont la chaleur facilite alors la
naissance; et ils pensent que par ce caractère spécial elle étoit parfaitement propre
à devenir pour les-Égyptiens le symbole du vent méridional, dont elle suit la
direction, et du dessèchement des terres, qui a lieu à l’époque où le vent commence
à souffler.
Mais, indépendamment de ce raisonnement, dont je suis loin de contester la
vraisemblance et la probabilité, me sera-t-il permis d’en hasarder un autre fondé
sur 1 étymologie même du nom que les Égyptiens donnent à la huppe î
Tous les anciens qui ont traité des hiéroglyphes, nous assurent que bien souvent,
dans leurs images symboliques, les Égyptiens employoient des figures d’animaux
ou d’autres objets physiques qui n’avoient que peu ou point de rapporpianalogique
avec l’idée qu’on les chargeoit de représenter, mais dont le nom connu reproduisoit
dans sa prononciation à peu près le même son que les mots q u i, dans le langage
parlé, auroient exprimé l’idée qu’on vouloit peindre. Par exemple, ils nous attestent
que, dans l’écriture sacerdotale, l’idée de l’ame étoit rendue par un épervier,.par
la raison que le nom de baïci R X I H T que les Égyptiens donnoient à cet oiseau (2),
renferme les mêmes sons que les deux mots bai et hél , dont le
(1) « La huppe va du midi au nord; elle vit des ver-
» ruisseaux qui "éclosent sans nombre dans le limon du
» Nil.Une infinité d’espèces de moucherons, de demoi-
» selles et d’autres insectes, cherchent sur-tout les eaux
»dormantes, et par conséquent celles du Nil répandu,
»pour y déposer leurs oeufs, qui ne réussissent jamais
»mieux que dans'le limon échauffé par le soleil, après
» la rentrée du fleuve dans ses bords : la huppe accourt
» alors dans tous les lieux que Peau i nouvellement
>» abandonnés ; elle saisit avec industrie les momens et
» les lieux où les iqsectes naissans lui offrent une pâture
» facile, avant que l’animal ailé qui est caché sous la
» peau du ver et ensuite sous l’enveloppe de la chry-
»salide, sorte de cet état pour prendre son vol et pour
» porter son espèce en d’autres endroits. La huppe, attirée
» par cet appât, passe de l’Ethiopie dans la haute Egypte,
»et de la haute Egypte vers Memphis, où le Nil se
»partage : elle va toujours à la suite du Nil à mesure
» qu’il rentre dans ses canaux jusqu’à la mer. Elle étoit
» propre par cette méthode à caractériser parfaitement la
»direction du vent méridional,,qui aidoit et annonçoit
» le dessèchement désiré. rr
» Aussitôt donc que les Egyptiens voyoient revenir la
»huppe, c’est-à-dire, non la hùppe naturelle qüi n’étoit
»que le signe d’une chose fort différente, mais l’oiseau
»figuré, le vent du midi, qui imite le mouvement de
»la huppe, ils apprêtoient leur blé, reconnoissoient par
» l’arpentage d.es terres les bornes des héritages, que
» le limon avoit confondues^ et ne taTdoient pas à se*
» m er.. . » Voye^ l’Histoire du ciel par Pluche, tom, I " ,
pag. y et | J
(2) Bm C, accipiter. Kircher, page 67, Voyez la
Croze, pag. //.
premier ( i ) signifioit vie, et le second (2), esprit, coeur; et ces diverses idées abstraites,
dont la réunion pouvoit convenir à désigner l'ame, étoient offertes ensemble, et
prenoient, pour ainsi dire , un corps sensible aux yeux dans le sens symbolique
et composé qui étoit donné à la représentation de lêpervier.
Or, en faisant ici une application de ce système dans la langue des Égyptiens
modernes, le nom de la huppe est koukouphat X O T V O Y ' ^ Z T (3) ; et nous
ne devons point douter que leur ancienne langue ne se servît du même nom ou
d’un mot peu différent. En examinant quels sont les mots dont la combinaison
pourroit donner un son à peu près semblable, ou du moins qui n’en fût pas éloigné,
nous trouvons que la réunion des trois mots ghok - houo - ph - hhat, ÜCCAJ3C»
0 0 Y 0 ’ , présente une homonymie presque entière ; et cette
petite phrase signifie littéralement ,fin de l’abondance de l ’inondation (4). Au reste,
j’abandonne cette conjecture nouvelle à l’examen qu’on voudra en faire, ne prétendant
aucunement la défendre contre ceux qui la trouveroient hasardée, mais
observant toutefois que le génie delà langue Égyptienne, ancienne et moderne,
se plaisoit extraordinairement à ces mots composés de plusieurs autres, et qu’à
chaque page, dans les. livres Qobtes, on trouve des mots fort longs, qui, par
l’anajyse grammaticale usitée dans cette langue, se décomposent en autant de mots
différens que le mot composé a de syllabes.
On trouve aussi un autre hiéroglyphe qui figure, comme les précédens, une
perche traversée de deux barres; mais l’anneau, au lieu de lui être supérieur, est
placé au-dessous, de cette manière, T . Je n’hésiterai point à le ranger dans la même
famille comme analogue à ces autres types, et à lui assigner la même valeur,
sans cependant prétendre assurer que les hiéroglyphes que je viens de citer,
ainsi que ceux dont je vais parler, n’ont pu, en plus d’une occasion, être placés
avec une acception différente de celle que je leur attribue ic i, et qui cependant
me semble être leur valeur primitive et originale ; mais il a dû arriver pour
ces hiéroglyphes, comme pour tous les autres, qu’on a transmis une expression
emblématique et figurée à la valeur physique et matérielle, si on peut le dire,
qu’ils avoient dans leur premier usage. Ce cas a lieu dans toutes les langues tant
anciennes que modernes, soit primitives, soit dérivées, chez lesquelles nous voyons
(*) UsSygS, fat,vita. Prov. VI,22. Voyez la Croze,
pag. 10. •
(2) 2 k t , xa-pJia, cor, passim. Item vS?, mens. Rom.
x i, 34. Plur. , corda (Lit. Greg. §. i). Voyez la
Croze, pag, ij j ,
(3) Rq'XKO'X'c^ZsT , upupa, Kircher, pag. ¡68. Voy.
la Croze, p a g . j j .
(4) 2£tt\K> •ni& if, f i n i s , terminus. Psal. XXXVIII,
4* To TtAof, finis. Matth. x x v i , 58. Voyez la Croze,
pag. 170.
¿O'tfO, to TH&iojoi', abundans, residuum. Ex. x , 8.
Matth. V, 37. Amplior. Matth. IX, 16.
TAsioK, amplius. Ps. LXI, 2. ¿ay-
¿ . M . T O M E II.
•meAfftraç. Marc, v u , 37. Ç .p ^ O Y O , extolli, abundare,
íayiAj,». Ps. XXXVI, 3)• noÂuûict«', multiplicare. Ps.
CXXXVII, 3. 'TmpTnçjLcoivurt superabundare. 2 Cor. V I I , 4* niejurotviir, abundare. Liturg. Basil, pag. 10. Voyez la
Croze, pag. jj8.
Le c|> est, comme on sait, un des articles prépositifs
de la langue Qobte.
. àntppoict, emanado. Sap. Salomon.
VII, 23. Item fluere. Exod. 111,8.
îtEpCU'"^' ÎIE-W- E & i tU > >» /rtVfftt yetxa. xsft
pÀKi, terra fluens lac et niel (passim). Joh. V II, 38.
£-Kjb*>-r^’> fudisti. Lit. Greg.pag. 42. Voyez la Croze,
pag. 147.