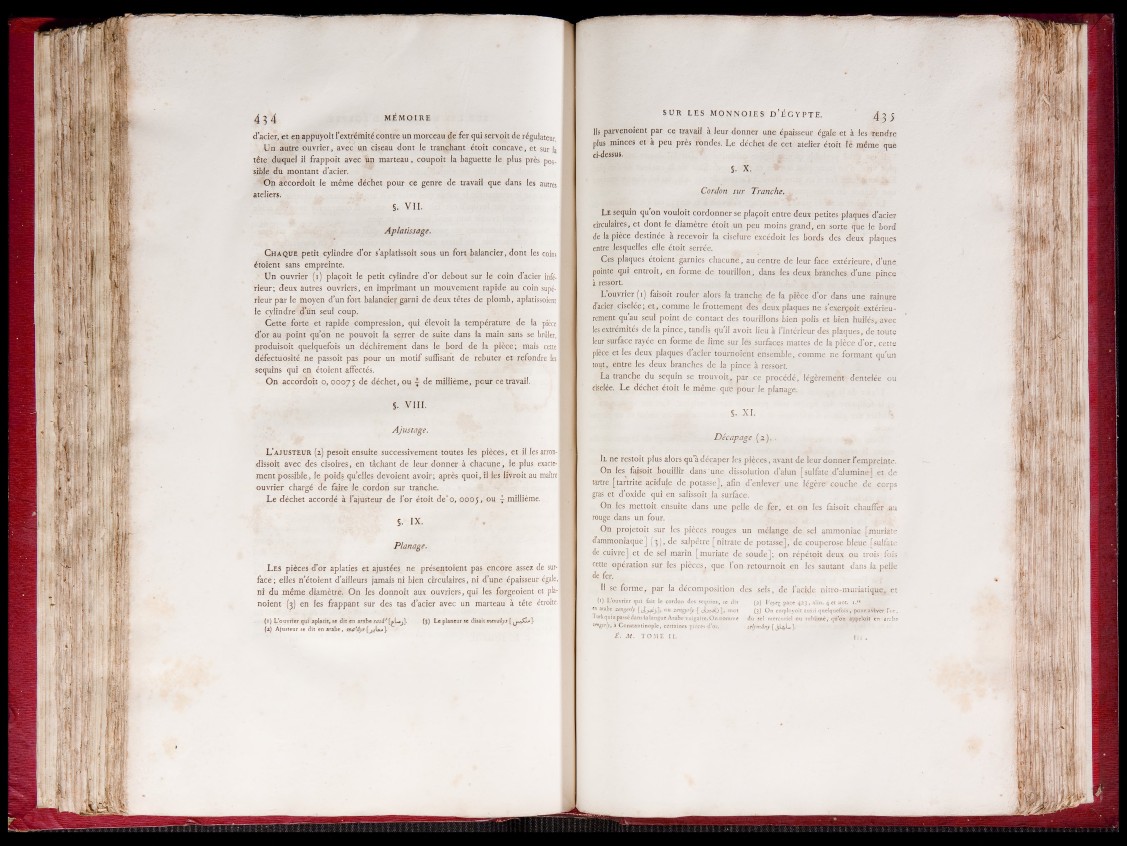
d’acier, et en appuyoit l’extrémité contre un morceau de fer qui servoit de régulateur
Un autre ouvrier, avec un ciseau dont le tranchant étoit concave, et sur la
tête duquel il frappoit avec un marteau, coupoit la baguette le plus près possible
du montant d’acier.
On accordoit le même déchet pour ce genre de travail que dans les autres
ateliers.
§. V I I .
Aplatissage.
C h a q u e petit cylindre d’or s’aplatissoit sous un fort balancier, dont les coins
étoient sans empreinte.
Un ouvrier (i) plaçoit le petit cylindre d’or debout sur le coin d’acier inférieur;
deux autres ouvriers, en imprimant un mouvement rapide au coin supérieur
par le moyen d’un fort balancier garni de deux têtes de plomb, aplatissoient
le cylindre d’un seul coup.
Cette forte et rapide compression, qui élevoit la température de la pièce j
d’or au point qu’on ne pouvoit la serrer de suite dans la main sans se brûler,
produisoit quelquefois un déchirement dans le bord de la pièce; mais cette
défectuosité ne passoit pas pour un motif suffisant de rebuter et refondre les:
sequins qui en étoient affectés.
On accordoit o, 00075 de déchet, ou -j de millième, pour ce travail.
§. V I I I .
Ajustage.
L ’a ju s t e u r (2) p e soit ensuite successivement toutes les p iè c e s , e t il les arron-
dissoit a v e c des cisoires, en tâchant de leur donner à ch a cu n e , le plus exactem
en t pos sib le, le poids qu’elles d e v o ien t a vo ir ; après q u o i, il les liv ro it au maître
o u v r ie r chargé de faire le co rd on sur tranche.
Le déchet accordé à l’ajusteur de l’or étoit de'o, 0005, ou - millième.
§. IX.
Planage.
L e s pièces d’or aplaties et ajustées ne présentoient pas encore assez de surface;
elles n’étoient d’ailleurs jamais ni bien circulaires, ni d’une épaisseur égale,
ni du même diamètre. On les donnoit aux ouvriers, qui les forgeoient et pla-
noient (3) en les frappant sur des tas d’acier avec un marteau à tête étroite.
(1) L’ouvrier qui aplatit, se dit en arabe rasâ* [ e L j] . (3) Le planeur se disait mtnahyi [
(a) Ajusteur se dit en arabe, rrur'dyr [jaUe].
Ils parvenoient par ce travail a leur donner une épaisseur égale et à les rendre
plus minces et à peu près rondes. Le déchet de cet atelier étoit lé même que
ci-dessus.
§. X.
Cort/on sur Tranche.
Le sequin qu’on vouloit cordonner se plaçoit entre deux petites plaques d’acier
circulaires, et dont le diamètre étoit un peu moins grand, en sorte que le bord
de la pièce destinée à recevoir la ciselure excédoit les bords des deux plaques
entre lesquelles elle étoit serrée.
Ces plaques etoient garnies chacune, au centre de leur face extérieure, d’une
pointe q.ui entroit, en forme de tourillon, dans les deux branches d’une pince
à ressort.
L ouvrier ( i ) faisoit rouler alors la tranche de la pièce d’or dans une rainure
dacier ciselee; et, comme le frottement des deux plaques ne s’exerçoit extérieurement
qu’au seul point de contact des tourillons bien polis et bien huilés, avec
les extrémités de la pince, tandis qu il avoit lieu à l’intérieur des plaques, de toute
leur surface rayee en forme de Jime sur les surfaces mattes de la pièce d’or, cette
piece et les deux plaques d acier tournoient ensemble, comme ne formant qu’un
tout, entre les deux branches de la pince à ressort.
La tranche du sequin se trouvoit, par ce procédé, légèrement dentelée ou
ciselée. Le déchet étoit le même qu’e pour le planage.
§. XI.
Décapage (2). .
Il ne restoit plus alors qû a décaper les pièces, avant de leur donner l’empreinte.
On les^ faisoit bouillir dans une dissolution d’alun [sulfate d’alumine] et de
tartre [tartrite acidulé de potasse], afin d’enlever une légère couche de corps
gras et d’oxide qui en salissoit la surface.
On les mettoit ensuite dans une pelle de fer, et on les faisoit chauffer au
rouge dans un four.
On projetoit sur les pièces rouges un mélange de sel ammoniac [muriate
¿ammoniaque] (3), de salpêtre [nitrate de potasse], de couperose bleue [sulfate
de cuivre] et de sel marin [muriate de soude]; on répétoit deux ou trois fois
cette opération sur les pièces, que l’on retournoit en les sautant dans la pelle
de fer.
Il se forme, par la décomposition des sels, de l’acide nitro-muriatique,, et
(1) L'ouvrier qui fait le cordon des sequins, se dit (a) Koyrç pa»e 403, alin. 4 et not. t ."
en arabe zengerly [ ¡ J ], ou zengyrljt [ ci-ro-Ei], nict (3) On employoit aussi quelquefois, pour aviver for.
Turkquia passedansia langue Arabe vulgaire. On nomme du sel mercuriel ou sublimé, qu’on appeloit en arabe
lengyrly, à Constantinople, certaines pièces d’or. ithmâny
Ü M. TOME I h