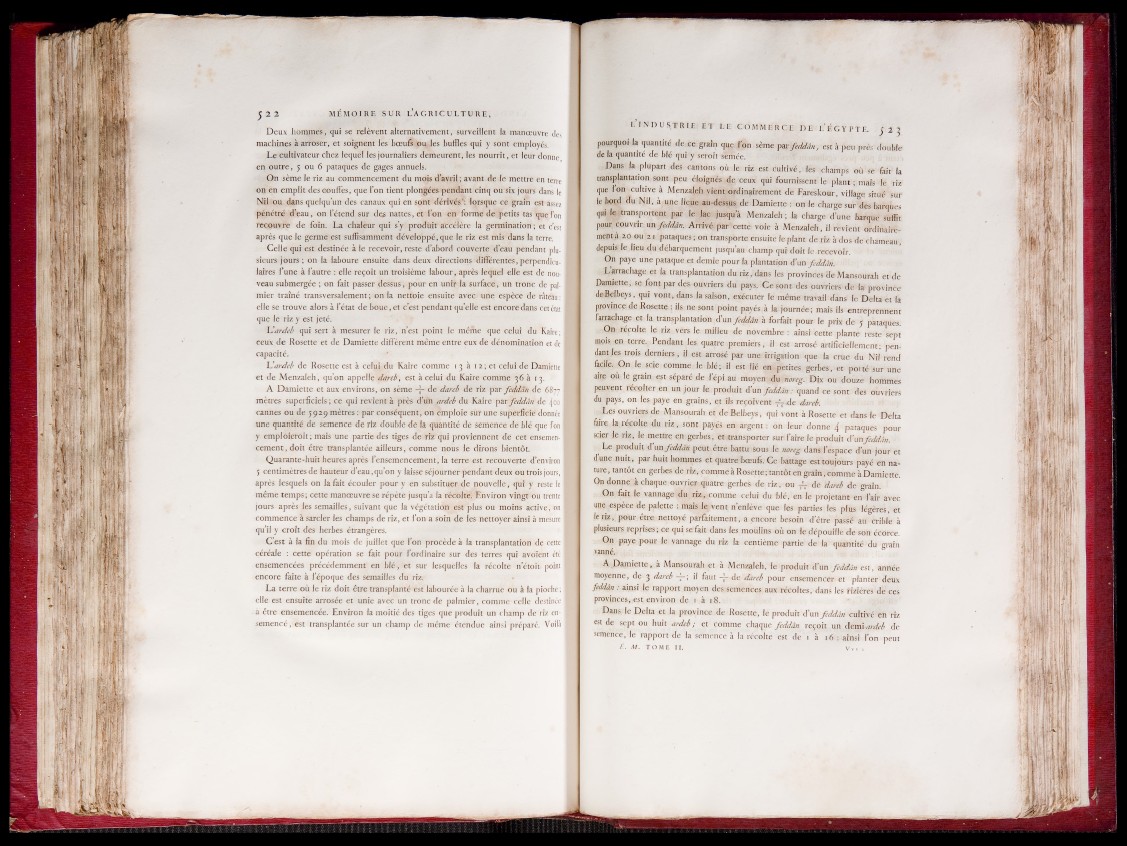
f 2 2 MÉMO I R E S U R L’A G R I C U L T U R E ,
Deux liommes, qui se relèvent alternativement, surveillent la manoeuvre des
machines à arroser, et soignent les boeufs ou les buffles qui y sont employés.
Le cultivateur chez lequel les journaliers demeurent, les nourrit, et leur donne
en outre, y ou 6 pataquès de gages annuels.
On sème le riz au commencement du mois d’avril ; avant de le mettre en terre
on en emplit des couffes, que l’on tient plongées pendant cinq ou six jours dans le
Nil ou dans quelqu’un des canaux qui en sont dérivés': lorsque ce grain est assez
pénétré d’eau, on l’étend sur des nattes, et l’on en forme de petits tas que l’on
recouvre de foin. La chaleur qui s’y produit accélère la germination ; et c’est
après que le germe est suffisamment développé, que le riz est mis dans la terre.
Celle qui est destinée à le recevoir, reste d’abord couverte d’eau pendant plusieurs
jours; on la laboure ensuite dans deux directions différentes,perpendiculaires
l’une à l’autre ; elle reçoit un troisième labour, après lequel elle est de nouveau
submergée ; on fait passer dessus, pour en unir la surface, un tronc de palmier
traîné transversalement ; on la nettoie ensuite avec une espèce de râteau :
elle se trouve alors à l’état de boue, et c’est pendant qu’elle est encore dans cet état
que le riz y est jeté.
L ’ardeb qui sert à mesurer le riz, n’est point le même que celui du Kaire;
ceux de Rosette et de Damiette diffèrent même entre eux de dénomination et de
capacité.
L 'ardeb de Rosette est à celui du Kaire comme 13 à 12 ; et celui de Damiette
et de Menzaleh, qu’on appelle dareb, est à celui du Kaire comme 36 à 13.
A Damiette et aux environs, on sème -5- de dareb de riz par feddân de 6877
mètres superficiels ; ce qui revient à près d’un ardeb du Kaire par feddân d e 4oo !
cannes ou de 5929 mètres : par conséquent, on emploie sur une superficie donnée
une quantité de semence de riz double de la quantité de semence de blé que l’on '
y emploierait; mais une partie des tiges de riz qui proviennent de cet ensemencement,
doit être transplantée ailleurs, comme nous le dirons bientôt.
Quarante-huit heures après l’ensemencement, la terre est recouverte d’environ
5 centimètres de hauteur d’eau,qu’on y laisse séjourner pendant deux ou trois jours,
après lesquels on la fait écouler pour y en substituer de nouvelle, qui y reste lei
même temps; cette manoeuvre se répète jusqu’a la récolte. Environ vingt ou trente
jours après les semailles, suivant que la végétation est plus ou moins active, on
commence à sarcler les champs de riz, et l’on a soin de les nettoyer ainsi à mesure
qu’il y croît des herbes étrangères.
C ’est à la fin du mois de juillet que l’on procède à la transplantation de cette
céréale : cette opération se fait pour l’ordinaire sur des terres qui avoient été
ensemencées précédemment en blé , et sur lesquelles la récolte n’étoit- point
encore faite à l’époque des semailles du riz.
La terre où le riz doit être transplanté est labourée à la charrue ou à la pioche ;
elle est ensuite arrosée et unie avec un tronc de palmier, comme celle destinée
à être ensemencée. Environ la moitié des tiges que produit un champ de riz ensemencé,
est transplantée sur un champ de même étendue ainsi préparé. Voilà
pourquoi la quantité de ce grain que-l’on sème par feddân, est à peu près double
de la quantité de blé qui y seroit semée.
Dans la plupart des cantons où le riz est cultivé, les champs où se fait la
transplantation sont peu éloignés de ceux qui fournissent le plant ; mais le riz
que Ion cultive à Menzaleh vient ordinairement de Fareskour, village situé sur
le bord du Nil, à une lieue au-dessus de Damiette : on le charge sur des barques
qui le transportent par le lac jusqu’à Menzaleh ; la charge d’une barqué suffit
pour couvrir un feddân. Arrivé par cette voie à Menzaleh, il revient ordinaire-
menta,20 ou 21 pataquès ; on transporte ensuite le plant de riz à dos de chameau,
depuis, le lieu du débarquement jusqu’au champ qui doit le.recevoir.
On paye une pataque et demie pour la plantation d’un feddân.
L ’arrachage et la transplantation du riz, dans les provinces de Mansourah et de
Damiette,,se font par des ouvriers du pays. C e sont, des ouvriers de la province
deBelbeys, qui vont, dans la saison, exécuter le même travail dans le Delta et la
province de Rosette : ils ne sont point payés à la journée; mais ils entreprennent
1 arrachage et la transplantation d’un feddân à forfait pour le prix de y pataquès.
On récolte le riz vers le milieu de novembre : ainsi cette plante reste sept
mois, en terre. Pendant les quatre premiers, il est arrosé artificiellement; pendant
les trois derniers , il est arrosé par une irrigation que la crue du Nil rend
facile. On le scie comme le blé; il est lié en petites gerbes, et porté sur une
aire ou le grain est séparé de l’épi au moyen du noreg. Dix ou douze hommes
peuvent récolter en un jour le produit d’un feddân: quand ce sont des ouvriers
du pays, on les paye en grains, et ils reçoivent -i-.de dareb.
i.Les ouvriers de Mansourah et de Belbeys, qui vont à Rosette et dans le Delta
faire la récolte du riz „„sont payés en argent: on leur donne 4 pataquès pour
scier le riz, Je mettre en gerbes, et transporter sur faire le produit d’un feddân.
; P10iuiÇ <f un feddân peut être battu sous le noreg dans l’espace d’un jour et
d’une nuit, par huit hommes et quatre boeufe. Ce battage est toujours payé en nature,
tantôt en gerbes de riz, comme à Rosette ; tantôt en grain, comme à Damiette.
On donne à chaque ouvrier quatre gerbes de riz, ou i de dareb de grain.
On fait le vannage du riz, comme celui du blé, en le projetant en l’air avec
une espèce de palette : mais Je vent n’enlève que les parties les plus légères, et
le riz, pour être nettoyé parfaitement, a encore besoin d’être passé au crible à
plusieurs reprises; ce qui se fait dans les moulins où on le dépouille de son écorce.
On paye pour le vannage du riz la centième partie de la quantité du grain
vanné.
A Damiette, a Mansourah et à Menzaleh, le produit d’un feddân est, année
moyenne, de 3 dareb — ; il faut -j- de dareb pour ensemencer et planter deux
feddân : ainsi le rapport moyen des semences aux récoltes, dans les rizières de ces
provinces, est environ de 1 à 18.
Dans le Delta et la province de Rosette, le produit d’un feddân cultivé en riz
est de sept ou huit ardeb; et comme chaque feddân reçoit un àtmi-ardeb de
semence, le rapport de la semence à la récolte est de 1 à 16 : ainsi l’on peut
Ê. M. T OM E II. v v v ,