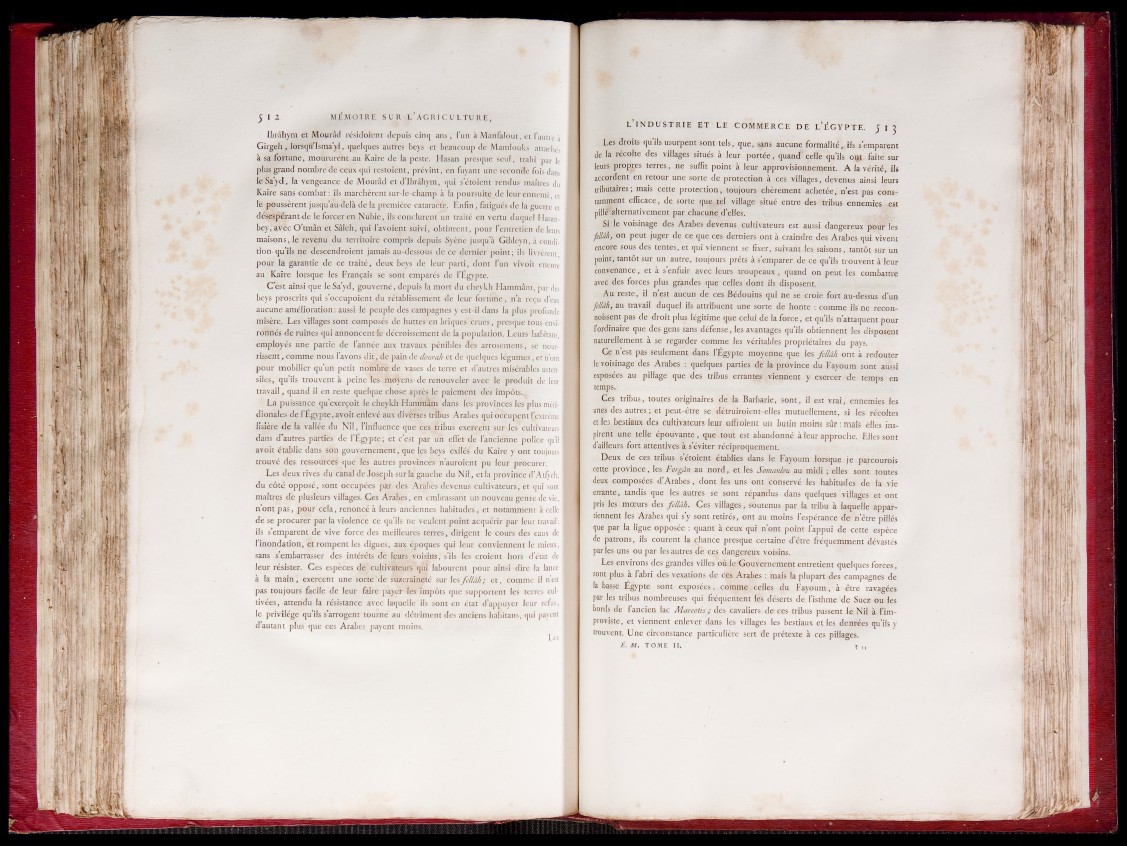
5 I 2. MÉM O I R E S U R L ’ A G R I C U L T U R E ,
» Ibrâhym et Mourâd résidoient depuis cinq ans, l’un à Manfalout, et l’autre à I
Girgeh, lorsqfi'Isma’y l , quelques autres beys et beaucoup de Mamlouks attaches
a sa fortune, moururent au Kaire de la peste. Hasan presque seul, trahi par le I
plus grand nombre de ceux qui restoient, prévint, en fuyant une seconde fois dans I
leSa’yd, la vengeance de Mourâd et d’Ibrâhym, qui s’étoient rendus maîtres du I
Kaire sans combat : ils marchèrent sur-le-champ à la poursuite de leur ennemi, et I
le poussèrent jusqu’au-delà de la première cataracte. Enfin, fatigues de la guerre et I
désespérant de le forcer en Nubie, ils conclurent un traité en vertu duquel Hasan- I
bey, avec O ’tmân et Sâleh, qui l’avoient suivi, obtinrent, pour l’entretien de leurs I
maisons, le revenu du territoire compris depuis Syène jusqu’à Gibleyn, à condi- I
non- qu’ils ne descendroient jamais au-dessous de ce dernier point ; ils livrèrent I
pour la garantie de ce traité, deux beys de leur parti, dont l’un vivoit encore I
au Kaire lorsque les Français se sont emparés de l’Egypte.
C’est ainsi que le Sa’yd, gouverné, depuis la mort du cheykh Hammam, par des I
beys proscrits qui s’occupoient du rétablissement de leur fortune, n’a reçu d’eux I
aucune amélioration : aussi le peuple des campagnes y est-il dans la plus profonde I
misère. Les villages sont composés de huttes en briques crues, presque tous envi- I
ronnés de ruines qui annoncent le décroissement de la population. Leurs habitans, I
employés une partie de l’année aux travaux pénibles des arrosemens, se nour- I
rissent, comme nous 1 avons dit, de pain de dourah et de quelques légumes, et n’ont I
pour mobilier qu’un petit nombre de vases de terre et d’autres misérables usten- I
siles, qu’ils trouvent à peine les moyens'de renouveler avec le produit de leur I
travail, quand il en reste quelque chose après le paiement des impôts.,.
La puissance qu’exerçoit le cheykh Hammam dans les provinces les plus méri- I
dionales de l ’Egypte, avoit enlevé aux diverses tribus Arabes qui occupent l'extrême I
lisière de la vallée du N il, l’influence que ces tribus exercent sur les cultivateurs I
dans d’autres parties de l’Egypte; et c’est par un effet de l’ancienne police qu’il I
avoit établie dans son gouvernement, que les beys exilés du Kaire y ont toujours I
trouvé des ressources que les autres provinces n’auroient pu leur procurer.
Les deux rives du canal de Joseph sur la gauche du Nil., et la province d’Atfÿeh, ■
du côté opposé, sont occupées par des Arabes devenus cultivateurs, et qui sont I
maîtres de plusieurs villages. Ces Arabes, en embrassant un nouveau genre de vie, I
n’ont pas, pour cela, renoncé à leurs anciennes habitudes, et notamment à celle I
de se procurer par la violence ce qu’ils ne veulent point acquérir par leur travail: I
ils s’emparent de vive force des meilleures terres, dirigent le cours des eaux de ■
l’inondation, et rompent les digues, aux époques qui leur conviennent le mieux, I
sans s’embarrasser des intérêts de leurs voisins,' s’ils les croient hors d’état de ■
leur résister. Ces espèces de cultivateurs qui labourent pour ainsi dire la lance ■
à la main, exercent une sorte de suzeraineté sur lesfcllâh; e t, comme il n’est I
pas toujours facile de leur faire payer les impôts que supportent les terres cul- I
tivées, attendu la résistance avec laquelle ils sont en état d’appuyer leur refus, ■
le privilège qu’ils s’arrogent tourne au détriment des anciens habitans, qui payent I
d autant plus que ces Arabes payent moins.
Les I
L I NDUSTRIE ET L,E COMMERCE DE l ’ÉGYPTE. j I 5
Les droits qu’ils usurpent sont tels, que, sans aucune formalité, iis s’emparent
de la récolte des villages situés à leur portée, quand celle qu’ils ont faite sur
leurs propres terres, ne suffit point à leur approvisionnement. A la vérité, ils
accordent en retour une sorte de protection à ces villages, devenus ainsi leurs
tributaires; mais cette protection, toujours chèrement achetée, n’est pas constamment
efficace, de sorte que tel village situé entre des tribus ennemies est
pillé alternativement par chacune d’elles.
Si le voisinage des Arabes devenus cultivateurs est aussi dangereux pour les
fellâh, on peut juger de ce que ces derniers ont à craindre des Arabes qui vivent
encore sous des tentes, et qui viennent se fixer, suivant les saisons, tantôt sur un
point, tantôt sur un autre, toujours prêts à s'emparer de ce qu’ils trouvent à leur
convenance, et à s’enfuir avec leurs troupeaux , quand on peut les combattre
avec des forces plus grandes que celles dont ils disposent.
Au reste, il n’est aùcun de ces Bédouins qui ne se croie fort au-dessus d’un
ftllâh, au travail duquel ils attribuent une sorte de honte : comme ils ne recon-
noissent pas de droit plus légitime que celui de la force, et qu’ils n’attaquent pour
l’ordinaire que des gens sans défense, les avantages qu’ils obtiennent les disposent
naturellement à se regarder comme les véritables propriétaires du pays.
Ce n’est pas seulement dans l’Egypte moyenne que les fellâh ont à redouter
le voisinage des Arabes : quelques parties de la province du Fayoum sont aussi
exposées au pillage que des tribus errantes viennent y exercer de temps en
temps.
Ces tribus, toutes originaires de la Barbarie, sont, il est vrai, ennemies les
unes des autres ; et peut-être se détruiroient-elles mutuellement, si les récoltes
et les bestiaux des cultivateurs leur offfoient un butin moins sûr : mais elles inspirent
une telle épouvante , que tout est abandonné à leur approche. Elles sont
d’ailleurs fort attentives à s’éviter réciproquement.
Deux de ces tribus s’étoient établies dans le Fayoum lorsque je parcourois
cette province, les Foi-gân au nord, et les Somanlou au midi ; elles sont toutes
deux composées d’Arabes, dont les uns ont conservé les habitudes de la vie
errante, tandis que les autres se sont répandus dans quelques villages et ont
pris les moeurs des fellâh. Ces villages, soutenus par la tribu à laquelle appartiennent
les Arabes qui s’y sont retirés, ont au moins l’espérance de n’être pillés
que par la ligue opposée : quant à ceux qui n’ont point l’appui de cette espèce
de patrons, ils courent la chance presque certaine d’être fréquemment dévastés
parles uns ou par les autres de ces dangereux voisins.
Les environs des grandes villes où le Gouvernement entretient quelques forces,
sont plus a iabri des vexations de ces Arabes : mais la plupart des campagnes de
la basse Egypte sont exposées, comme celles du Fayoum, à être ravagées
par les tribus nombreuses qui fréquentent les déserts de l’isthme de Suez ou les
bords de 1 ancien lac Mareoùs ; des cavaliers de ces tribus passent le Nil à l’im-
proviste, et viennent enlever dans les villages les bestiaux et les denrées qu’ils y
trouvent. Une circonstance particulière sert de prétexte à ces pillages.
É . M . T O M E I I . T t l