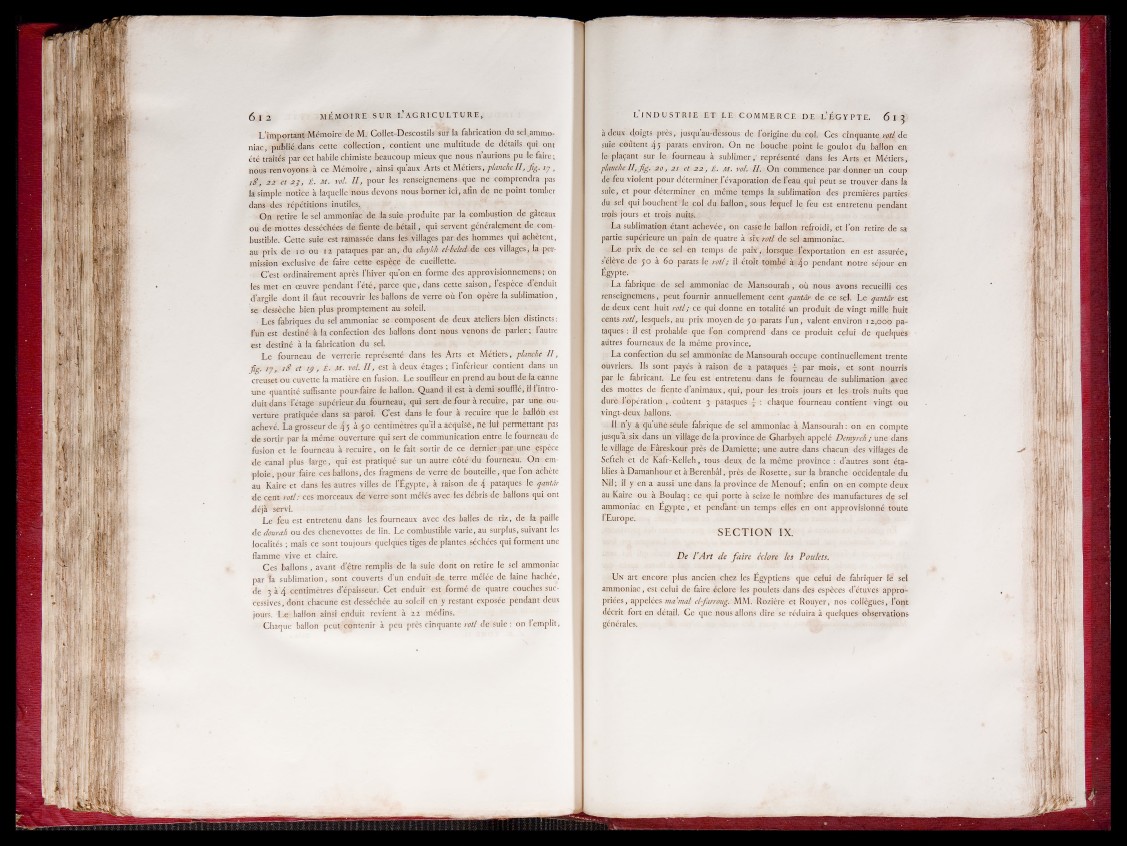
L ’important Mémoire de M. Collet-Descostils sur la fabrication du sel ammoniac,
publié dans cette collection, contient une multitude de détails qui ont
été traités par cet habile chimiste beaucoup mieux que nous n’aurions pu le faire ;
nous renvoyons à ce Mémoire, ainsi qu’aux Arts et Métiers, flan ch e II, fig . ¡y |
1 8 , 2 2 et 2 3 , É . m . vol. I I , pour les renseignemens que ne comprendra pas
la simple notice à laquelle nous devons nous borner ici, afin de ne point tomber
dans des répétitions inutiles.
On retire le sel ammoniac de la suie produite par la combustion de gateaux
ou de mottes desséchées de fiente de bétail, qui servent généralement de combustible.
Cette suie est ramassée dans les villages par des hommes qui achètent,
au prix de 10 ou 12 pataquès par an, du clieykh el-beled de ces villages, la permission
exclusive de faire cette espèce de cueillette.
C ’est ordinairement après l’hiver qu’on en forme des approvisionnemens ; on
les met en oeuvre pendant l’été, parce que, dans cette saison, l’espèce d’enduit
d’argile dont il faut recouvrir les ballons de verre où 1 on opere la sublimation ,
se dessèche bien plus promptement au soleil.
Les fabriques du sel ammoniac se composent de deux ateliers bien distincts :
l’un est destiné à la confection des ballons dont nous venons de parler ; 1 autre
est destiné à la fabrication du sel,
Le fourneau de verrerie représenté dans les Arts et Métiers, planche I I ,
fig. i / , 18 et ij) , É . m . vol. I I , est à deux étages ; l’inférieur contient dans un
creuset ou cuvette la matière en fusion. Le souffleur en prend au bout de la canne
une quantité suffisante pour-faire le ballon. Quand il est à demi soufflé, il 1 introduit
dans l’étage supérieur du fourneau, qui sert de four a recuire, par une ouverture
pratiquée dans sa paroi. C est dans le four a recuire que le ballon est
achevé. La grosseur de 45 à 50 centimètres qu’il a acquise, ne lui permettant pas
de sortir par la même ouverture qui sert de communication entre le fourneau de
fusion et le fourneau à recuire, on le fait sortir de ce dernier par une espèce
de canal plus large, qui est pratiqué sur un autre côté du fourneau. On emploie
, pour faire ces ballons, des fragmens de verre de bouteille, que 1 on achète
au Kaire et dans les autres villes de l’Egypte, à raison de 4 pataquès le qantâr
de cent rot/: ces morceaux de verre sont mêlés avec les débris de ballons qui ont
déjà servi.
Le feu est entretenu dans les fourneaux avec des balles de riz, de la paille
de dourah ou des chenevottes de lin. Le combustible varie, au surplus, suivant les
localités ; mais ce sont toujours quelques tiges de plantes séchées qui forment une
flamme vive et claire.
Ces ballons , avant d’être remplis de la suie dont on retire le sel ammoniac
par la sublimation, sont couverts d'un enduit de terre mêlée de laine hachée,
de 3 à 4 centimètres d’épaisseur. Cet enduit est formé de quatre couches successives,
dont chacune est desséchée au soleil en y restant exposée pendant deux
jours. L e ballon ainsi enduit revient à 22 médins.
Chaque ballon peut contenir à peu près cinquante ro tl de suie : on l’emplit.
à deux doigts près, jusqu’au-dessous de l’origine du col. Ces cinquante rotl de
suie coûtent 45 parats environ. On ne bouche point le goulot du ballon en
le plaçant sur le fourneau à sublimer,' représenté dans les Arts et Métiers,
planche II, fig . 2 0 , 2 1 et 2 2 , É . m . vol. II. On commence par donner un coup
de feu violent pour déterminer l’évaporation de l’eau qui peut se trouver dans la
suie, et pour déterminer en même temps la sublimation des premières parties
du sel qui bouchent le col du ballon, sous lequel le feu est entretenu pendant
trois jours et trois nuits.
La sublimation étant achevée, on casse le ballon refroidi, et l’on retire de sa
partie supérieure un pain de quatre à -six rotl de sel ammoniac.
Le prix de ce sel en temps de paix , lorsque l’exportation en est assurée,
seleve de 50 a 60 parats le rotl ; il étoit tombé à 4 0 pendant notre séjour en
Égypte.
La fabrique de sel ammoniac de Mansourah , où nous avons recueilli ces
renseignemens, peut fournir annuellement cent qantâr de ce sel. Le qantâr est
de deux cent huit rotl; ce qui donne en totalité un produit de vingt mille huit
cents rotl, lesquels, au prix moyen.de 50 parats l’un, valent environ 12,000 pataquès
: il est probable que l’on comprend dans ce produit celui de quelques
autres fourneaux de la même province.
La confection du sel ammoniac de Mansourah occupe continuellement trente
ouvriers. Us sont payés à raison de 2 pataquès ig par mois, et sont nourris
par le fabricant. Le feu est entretenu dans le fourneau de sublimation avec
des mottes de fiente d’animaux, qui, pour les trois jours et les trois nuits que
dure 1 opération coûtent 3 pataquès 7 : chaque fourneau contient vingt ou
vingt-deux ballons.
11 ny a quunç seule fabrique de sel ammoniac à Mansourah: on en compte
jusquà six dans un village de la. province de Gharbyeh appelé Demyreh; une dans
le village de Fâreskour près de Damiette; une autre dans chacun des villages de
Sefteh et de Kafr-Kelleh, tous deux de la même province : d’autres sont établies
à Damanhour et à Berenbâl, près de Rosette, sur la branche occidentale du
Nil; il y en a aussi une dans la province de Menouf ; enfin on en compte deux
au Kaire ou à Boulaq : ce qui porte à seize le nombre des manufactures de sel
ammoniac en Egypte, et pendant un temps elles en ont approvisionné toute
l'Europe.
S E C T I O N I X .
De l ’A rt de fa ir e éclore les Poulets.
Un art encore plus ancien chez les Égyptiens que celui de fabriquer le sel
ammoniac, est celui de faire éclore les poulets dans des espèces d’étuves appropriées,
appelées marnai d-farroug. MM. Rozière et Rouyer, nos collègues, l’ont
décrit fort en détail. Ce que nous allons dire se réduira à quelques observations
générales.