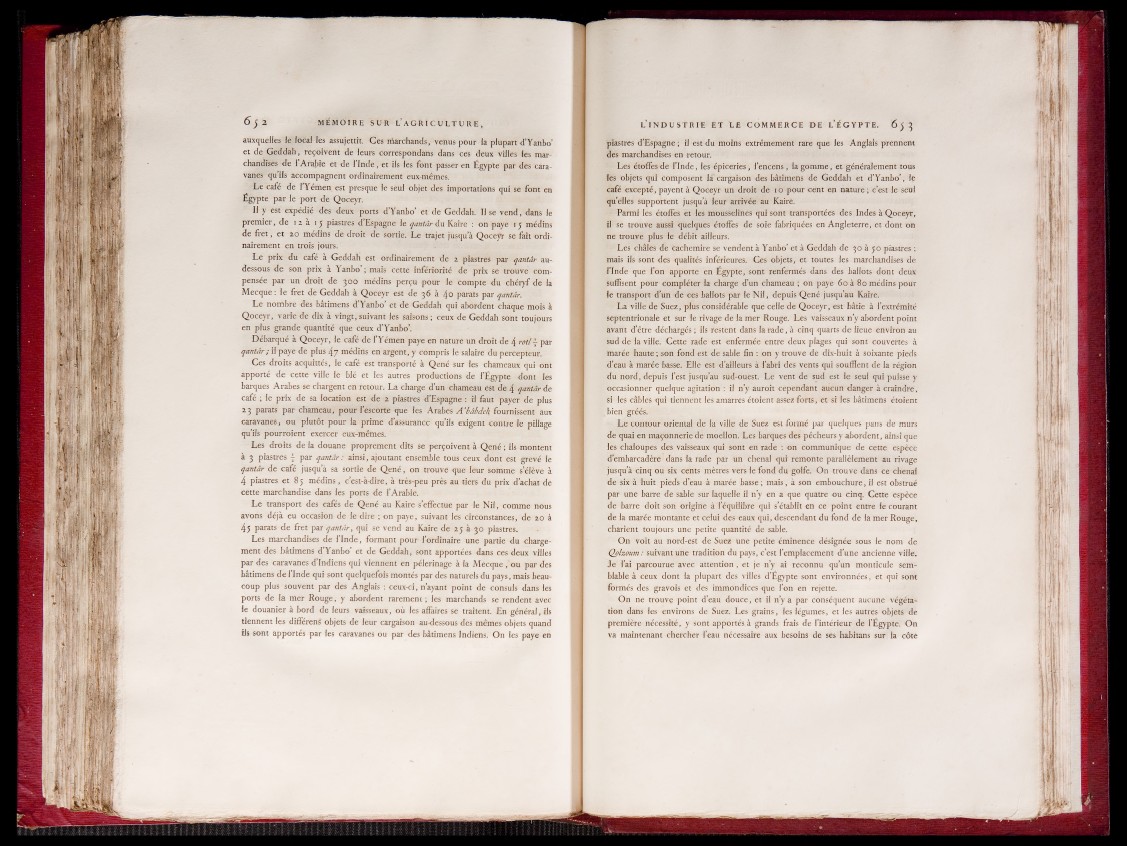
auxquelles le local les assujettit. Ces marchands, venus pour la plupart d’Yanbo'
et de Geddah, reçoivent de leurs correspondans dans ces deux villes les marchandises
de 1 Arabie et de l’Inde, et ils les font passer en Égypte par des caravanes
quils accompagnent ordinairement eux-mêmes.
Le cafe de 1 Yémen est presque le seul objet des importations qui se font en
Égypte par le port de Qoceyr.
Il y est expédié des deux ports d’Yanbo’ et de Geddah. Il se vend, dans le
premier, de 12 a 1 y piastres d Espagne le qantâr du Kaire : on paye 1 y médins
de fre t, et 20 medins de droit de sortie. Le trajet jusqu’à Qoceyr se fait ordinairement
en trois jours.
Le prix du café à Geddah est ordinairement de 2 piastres par qantâr au-
dessous de son prix a Yanbo ; mais cette infériorité de prix se trouve compensée
par un droit de 300 médins perçu pour le compte du chéryf de la
Mecque : le fret dè Geddah à Qoceyr est de 36 à 4o parats par qantâr.
L e nombre des bâtimens d’Yanbo’ et de Geddah qui abordent chaque mois à
Qoceyr, varie de dix à vingt, suivant les saisons ; ceux de Geddah sont toujours
en plus grande quantité que ceux d’Yanbo’.
Débarqué à Qoceyr, le café de l’Yémen paye en nature un droit de 4 Ü f l par
qantâr; il paye de plus 47 médins en argent, y compris le salaire du percepteur.
Ces droits acquittés, le café est transporté à Qené sur les chameaux qui ont
apporté de cette ville le blé et les autres productions de l’Égypte dont les
barques Arabes se chargent en retour. La charge d’un chameau est de 4 qantâr de
café ; le prix de sa location est de 2 piastres d’Espagne : il faut payer de plus
23 parats par chameau, pour l’escorte que les Arabes A'bâbdeh fournissent aux
caravanes, ou plutôt pour la prime d’assurance qu’ils exigent contre le pillage
qu’ils pourroient exercer eux-mêmes.
Les droits de la douane proprement dits se perçoivent à Qené ; ils montent
à 3 piastres 7 par qantâr : ainsi, ajoutant ensemble tous ceux dont est grevé le
qantâr de café jusqu’à sa sortie de Qené, on trouvé que leur somme s’élève à
4 piastres et 8y médins, c’est-à-dire, à très-peu près au tiers du prix d’achat de
cette marchandise dans les ports de l’Arabie.
L e transport des cafés de Qené au Kaire s’effectue par le Nil, comme nous
avons déjà eu occasion de le dire ; on paye, suivant les circonstances, de 20 à 4y parats de fret par qantâr, qui se vend au Kaire de 2y à 30 piastres.
Les marchandises de l’Inde, formant pour l’ordinaire une partie du chargement
des bâtimens d Yanbo et de Geddah, sont apportées dans ces deux villes
par des caravanes d’indiens qui viennent en pèlerinage à la Mecque , ou par des
bâtimens de l’Inde qui sont quelquefois montés par des naturels du pays, mais beaucoup
plus souvent par des Anglais : ceux-ci, n’ayant point de consuls dans les
ports de la mer Rouge, y abordent rarement; les marchands se rendent avec
le douanier à bord de leurs vaisseaux, où les affàires se traitent. En général, ils
tiennent les différeni objets de leur cargaison au-dessous des mêmes objets quand
ils sont apportés par les caravanes ou par des bâtimens Indiens. On les paye eh
piastres d’Espagne ; il est du moins extrêmement rare que les Anglais prennent
des marchandises en retour.
Les étoffes de l’Inde, les épiceries, l’encens, la gomme, et généralement tous
les objets qui composent là cargaison des bâtimens de Geddah et d’Yanbo’ , le
café excepté, payent à Qoceyr un droit de 10 pour cent en nature ; c’est le seul
qu’elles supportent jusqu’à leur arrivée au Kaire.
Parmi les étoffes et les mousselines qui sont transportées des Indes à Qoceyr,
il se trouve aussi quelques étoffes de soie fabriquées en Angleterre, et dont on
ne trouve plus le débit ailleurs.
Les châles de cachemire se vendent à Yanbo’ et à Geddah de 30 à yo piastres :
mais ils sont des qualités inférieures. Ces objets, et toutes les marchandises de
l’Inde que l’on apporte en Egypte, sont renfermés dans des ballots dont deux
suffisent pour compléter la charge d’un chameau; on paye 60 à 80 médins pour
Je transport d’un de ces ballots par le N il, depuis Qené jusqu’au Kaire.
La ville de Suez, plus considérable que celle de Qoceyr, est bâtie à l’extrémité
septentrionale et sur le rivage de la mer Rouge. Les vaisseaux n’y abordent point
avant d’être déchargés ; ils restent dans la rade, à cinq quarts de lieue environ au
sud de la ville. Cette rade est enfermée entre deux plages qui sont couvertes à
marée haute ; son fond est de sable fin : on y trouve de dix-huit à soixante pieds
d’eau à marée basse. Elle est d’ailleurs à l’abri des vents qui soufflent de la région
du nord, depuis l’est jusqu’au sud-ouest. Le vent de sud est le seul qui puisse y
occasionner quelque agitation : il n’y auroit cependant aucun danger à craindre,
si les câbles qui tiennent les amarres étoient assez forts, et si les bâtimens étoient
bien gréés.
Le contour oriental de la ville de Suez est formé par quelques pans de murs
de quai en maçonnerie de moellon. Les barques des pêcheurs y abordent, ainsi que
les chaloupes des vaisseaux qui sont en rade : on communique de cette espèce
d’embarcadère dans la rade par un chenal qui remonte parallèlement au rivage
jusqu’à cinq ou six cents mètres vers le fond du golfe. On trouve dans ce chenal
de six à huit pieds d’eau à marée basse; mais, à son embouchure, il est obstrué
par une barre de sable sur laquelle il n’y en a que quatre ou cinq. Cette espèce
de barre doit son origine à l’équilibre qui s’établit en ce point entre le courant
de la marée montante et celui des eaux qui, descendant du fond de la mer Rouge,
charient toujours une petite quantité de sable.
On voit au nord-est de Suez une petite éminence désignée sous le nom de
Qolzoum : suivant une tradition du pays, c’est l’emplacement d’une ancienne ville.
Je l’ai parcourue avec attention, et je n’y ai reconnu qu’un monticule semblable
à ceux dont la plupart des villes d’Egypte sont environnées, et qui sont
formés des gravois et des immondices que l’on en rejette.
On ne trouve point d’eau douce, et il n’y a par conséquent aucune végétation
dans les environs de Suez. Les grains, les légumes, et les autres objets de
première nécessité, y sont apportés à grands frais de l’intérieur de l’Égypte. On
va maintenant chercher l’eau nécessaire aux besoins de ses habitans sur la côte