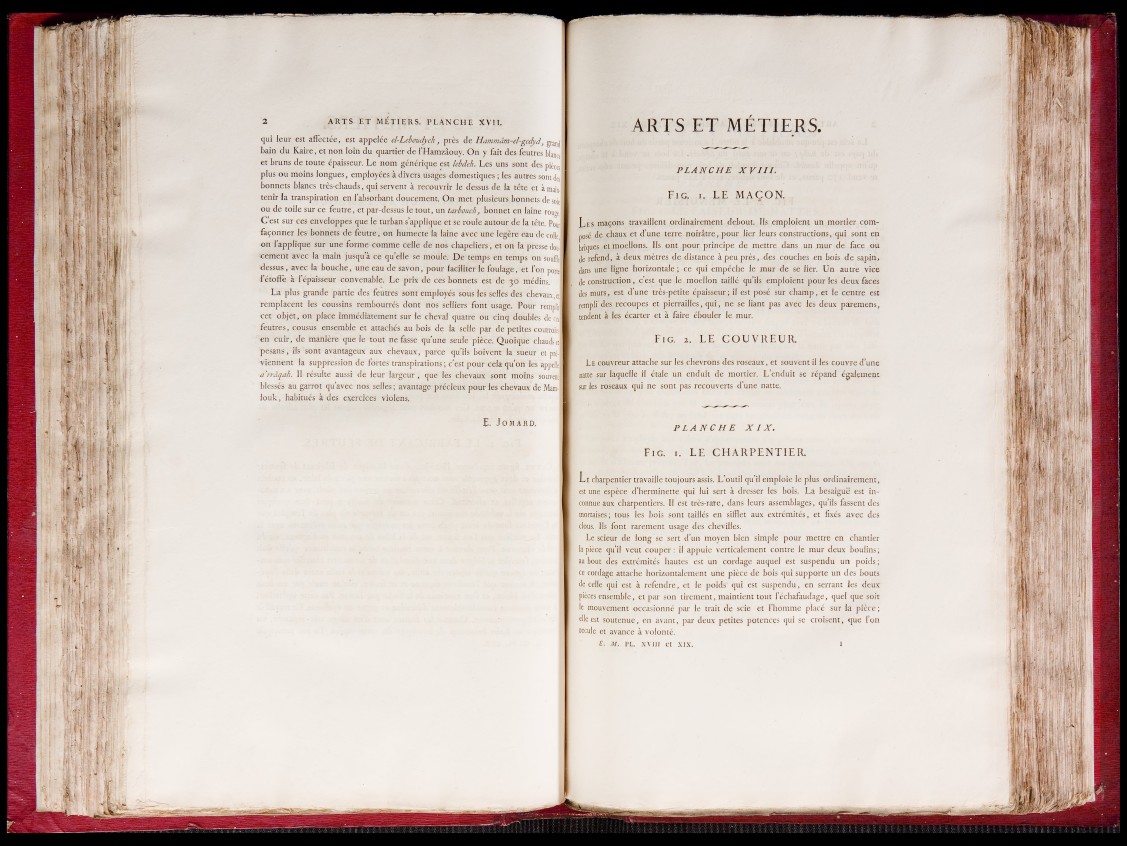
qui leur est affectée, est appelée el-Lcboudyeli, près de Hammâm-el-gcdyd, grandi
bain du Kaire, et non loin du quartier de l’Hamzâouy. On y fait des feutres blancs!
et bruns de toute épaisseur. Le nom générique est lebdeh. Les uns sont des pièceJ
plus ou moins longues, employées à divers usages domestiques ; les autres sont des
bonnets blancs très-chauds t qui servent à recouvrir le dessus de la tête et à main,
tenir la transpiration en 1 absorbant doucement. On met plusieurs bonnets de soie
ou de toile sur ce feutre, et par-dessus le tout, un tarbouch, bonnet en laine rouge|
C ’est sur ces enveloppes que le turban s’applique et se roule autour de la tête. PonJ
façonner les bonnets de feutre, on humecte la laine avec une légère eau de colle I
on l’applique sur une forme comme celle de nos chapeliers, et on la presse dou-l
cernent avec la main jusqu’à ce qu’elle se moule. De temps en temps on souille
dessus, avec la bouche, une eau de savon, pour faciliter le foulage, et l’on porte
l’étoffe à l’épaisseur convenable. Le prix de ces bonnets est de 30 médins.
La plus grande partie des feutres sont employés sous les selles des chevaux,« I
remplacent les coussins rembourrés dont nos selliers font usage. Pour rempli
cet objet, on place immédiatement sur le cheval quatre ou cinq doubles decej
feutres, cousus ensemble et attachés au bois de la selle par de petites courroies)
en cuir, de manière que le tout ne fasse qu’une seule pièce. Quoique chauds«
pesans, ils sont avantageux aux chevaux, parce qu’ils boivent la sueur et pré-l
viennent la suppression de fortes transpirations; c’est pour cela qu’on les appelle!
arrâqàh. Il résulte aussi de leur largeur , que les chevaux sont moins souveml
blessés au garrot qu’avec nos selles; avantage précieux pour les chevaux de Mam-|
louk, habitués à des exercices violens.
E. J o m a rd.
P L A N CHE X V I I I .
Fie . 1. LE MAÇON.
L e s maçons travaillent ordinairement debout. Ils emploient un mortier composé
de chaux et d’une terre noirâtre, pour lier leurs constructions, qui sont en
briques et moellons. Ils ont pour principe de mettre dans un mur de face ou
de r e f e n d , à deux mètres de distance à peu près, des couches en bois de sapin,
dans une ligne horizontale ; ce qui empêche le mur de se lier. Un autre vice
de construction, c’est que le moellon taillé qu’ils emploient pour les deux faces
des murs, est d’une très-petite épaisseur ; il est posé sur champ, et le centre est
r e m p l i des recoupes et pierrailles, qui, ne se liant pas avec les deux paremens,
tendent à les écarter et à faire ébouler le mur.
F ig. 2. LE C O U V R E U R .
L e couvreur attache sur les chevrons des roseaux, et souvent il les couvre d’une
natte sur laquelle il étale un enduit de mortier. L ’enduit se répand également
sur les roseaux qui ne sont pas recouverts d’une natte.
P L A N C H E X I X .
F ig. 1. LE CHA R P EN T IE R .
L e charpentier travaille toujours assis. L ’outil qu’il emploie le plus ordinairement,
est une espèce d’herminette qui lui sert à dresser les bois. La besaiguë est inconnue
aux charpentiers. Il est très-rare, dans leurs assemblages, qu’ils fassent des
mortaises; tous les bois sont taillés en sifflet aux extrémités, et fixés avec des
clous. Us font rarement usage des chevilles.
Le scieur de long se sert d’un moyen bien simple pour mettre en chantier
la pièce qu’il veut couper: il appuie verticalement contre le mur deux boulins;
au bout des extrémités hautes est un cordage auquel est suspendu un poids ;
ce cordage attache horizontalement une pièce de bois qui supporte un des bouts
ne celle qui est à refendre, et le poids' qui est suspendu, en serrant les deux
pièces ensemble, et par son tirement, maintient tout l’échafaudage, quel que soit
le mouvement occasionné par le trait de scie et l’homme placé sur la pièce;
elle est soutenue, en avant, par deux petites potences qui se croisent, que l’on
recule et avance à volonté.