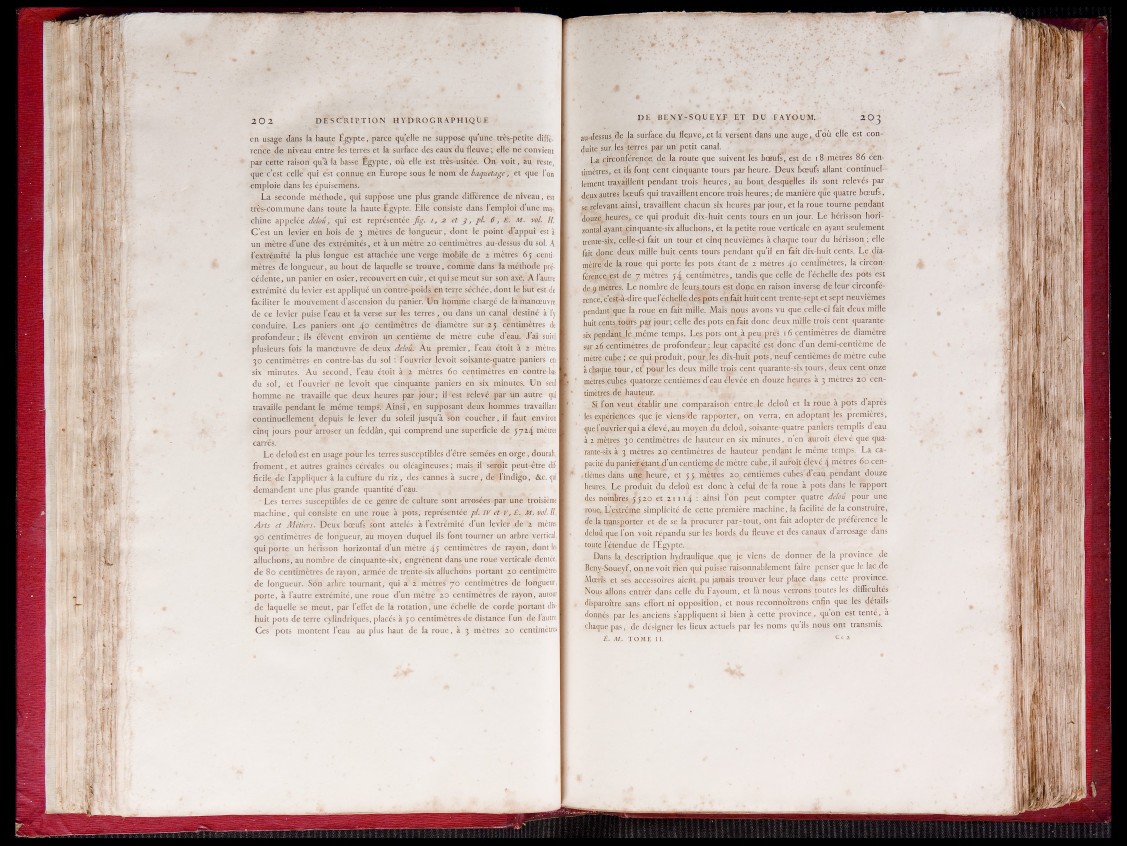
en usage dans la haute Egypte, parce quelle ne suppose qu’une très-petite différence
de niveau entre les terres et la surface des eaux du fleuve ; elle ne convient
par cette raison qu’à la basse Egypte, où elle 'est très-usitée. On voit, au reste,
que c’est celle qui est connue en Europe sous le nom de baquetage, et que l’on
emploie dans les épuisemens.
La seconde méthode, qui suppose une plus grande différence de niveau, est
.très-commune dans toute la haute Egypte. Elle consiste dans l’emploi d’une machine
appelée deloû, qui est représentée fig. 1 , 2 et 3 , pl. 6 , È. M. vol. I l
C ’est un levier en bois de 3 mètres de longueur, dont le point d’appui est à
un mètre d’une des extrémités, et à un mètre 20 centimètres au-dessus du sol. A
l’extrémité la plus longue est attachée une verge mobile de 2 mètres 65 centimètres
de longueur, au bout de laquelle se trouve, comme dans la méthode précédente
, un panier en osier, recouvert en cuir, et qui se meut sur son axe. A l’autre
extrémité du levier est appliqué un contre-poids en terre séchée, dont le but est de
faciliter le mouvement d’ascension du panier. Un homme chargé de la manoeuvre
de ce levier puise l’eau et la verse sur les terres, ou dans un canal destiné à l’y
conduire. Les paniers ont 4o centimètres de diamètre sur 25 centimètres de
profondeur ; ils élèvent environ un centième de mètre cube d’eau. J’ai suivi
plusieurs fois la manoeuvre de deux deloû.. Au premier, l’eau étoit à 2 mètres
30 centimètres en contre-bas du soi : l’ouvrier levoit soixante-quatre paniers en
six minutes. A u second, l’eau étoit à 2 mètres 60 centimètres en contre-bas
du sol, et l’ouvrier ne levoit que cinquante paniers en six minutes. Un seul
homme ne travaille que deux heures par jour.; il - est relevé par un autre qui
travaille pendant le même temps. A insi, en supposant deux hommes travaillant
continuellement depuis le lever du soleil jusqu’à son coucher, il faut environ
cinq jours pour arroser un feddân, qui comprend une superficie de 5724 mètres
carrés.
Le deloû est en usage pour les terres susceptibles d’être semées en o rge, dourah,
froment, et autres graines céréales ou oléagineuses; mais il serôit peut-être difficile
de l’appliquer à la culture du riz , des cannes à sucre, de . l’indigo, &c. qui
demandent une plus grande quantité d’eau.
Les terres susceptibles de ce genre de culture sont arrosées par une troisième
machine, qui consiste en une roue à pots, représentée pl. iv et v, £■ m . vol. II,
Arts et Métiers. Deux boeufs sont attelés à l’extrémité d’un levier de 2 mètres
00 centimètres de longueur, au moyen duquel ils font tourner un arbre vertical,
qui porte un hérisson horizontal d’un mètre 45 centimètres de rayon, dont les
alluchons, au nombre de cinquante-six, engrènent dans une roue verticale dentée,
de 80 centimètres de rayon, armée de trente-six alluchons portant 20 centimètres
de longueur. Son arbre tournant, qui a 2 mètres 70 centimètres de longueur,
porte, à l’autre extrémité, une roue d’un mètre 20 centimètres de rayon, autour
de laquelle se meut, par l’effet de la rotation, une échelle de corde portant dix-
huit pots de terre cylindriques, placés à 50 centimètres de distance l’un de l’autre,
Ces pots montent l’eau au plus haut de la roue, à 3 mètres 20 centimètres
au-dessus de la surface du fleuve, e t la versent dans une a u g e d ’où elle est conduite
sur. les jerres par un petit canal.
La circonférence de la route que suivent les boeufs, est de 18 mètres 86 centimètres,
et ils fonî cent cinquante tours par heure. Deux boeufs allant continuellement
travaillent pendant trois heures, au bout desquelles ils sont relevés par
deux autres boeufs qui travaillent encore trois heures ; de manière que quatre boeufs,
se relevant ainsi, travaillent chacun six heures par jour, et la roue tourne pendant
douze heures, ce qui produit dix-huit cents tours en un jour. Le hérisson horizontal
ayant cinquante-six alluchons, ét la petite roue verticale en ayant seulement
trente-six, celle-ci fait un tour et cinq neuvièmes à chaque tour du hérisson ; elle
fait donc deux'mille huit cents tours pendant qu’il en fait dix-huit cents. Le diamètre
de la roue qui porte les pots étant de 2 mètres 4 ° centimètres, la circonférence,
est de 7 mètres y4 centimètres, tandis que celle de l’échelle des pots est
de 9 mètres. Le nombre de leurff,tours est donc en raison inverse de leur circonférence,’
c’esfeà-dire que l’échelle des pots en fait huit cent trente-sept et sept neuvièmes
pendant'-que la roue en fait mille. Mais nous avons vu que celle-ci fait deux mille
huit cents tours par jour; celle des pots en fait donc deux mille trois cent quarante-
six pendant le même temps. Les pots ont à peu.près 16 centimètres de diamètre
sur 26 centimètres de profondeur : leur capacité est donc d’un demi-centième de
mètre cube ; ce qui produit, pour,les,dix-huit pots, neuf centièmes de mètre cube
à chaque tour, et* pour les deux mille trois cent quarante-six tours, deux cent onze
mètres,cubes quatorze centièmes d’eau élevée en douze heures à 3 mètres 20 centimètres
de hauteur.
' Si l’on veut établir une comparaison entre le deloû et la roue à pots d après
les expériences que je viens de rapporter, on verra, en adoptant les premières,
que l’ouvrier qui a élevé, au moyen du deloû, soixante-quatre paniers remplis d eau
à 2 mètres 30 centimètres de hauteur en six minutes, n’en auroit élevé que quarante
six à 3 mètres 20 centimètres de hauteur pendant le même temps. La capacité
du panier qtant .d’un centième de mètre cube, il auroit élevé 4 mètres 60 centièmes
dans une; heure,1 et y y mètres 20 centièmes cubes deau pendant douze
heures. Le produit du deloû est donc à celui de la roue à pots dans le rapport
des nombres y y 20 et 21 114 : ainsi l’on peut compter quatre delou pour une
roue,,L’ejttrême simplicité de cette première machine, la facilité de la construire,
(Je la transporter et de se la procurer par-tout, ont fait adopter de preference le
deloû que 1 on voit répandu sur les bords du fleuve et des canaux d arrosage dans
toute l’étendue de l’Egypte.
Dans la description hydraulique que je viens de donner de la province de
Beny-Sôueyf, on ne voit rien qui puisse raisonnablement faire penser que le lac de
Moeris et ses accessoires aient pu jamais trouver leur place dans cette province.
Nous allons entrer dans celle du Fayoum, et là nous verrons toutes les difficultés
disparoître sans effort ni opposition, et nous reconnoîtrons enfin que les détails
donnés par les anciens s’appliquent si bien à cette province, quon est tenté, a
chaque pas, de désigner les lieux actuels par les noms qu ils nous ont transmis.
È . M . T O M E i l C c 2